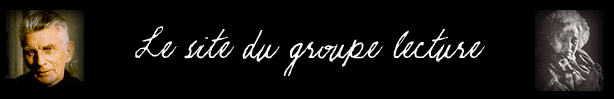
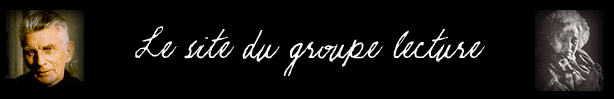 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième de couverture : À la Belle Époque, François-Ferdinand
fait partie de la jeunesse insouciante de Vienne. Entouré de ses
amis, il tourne en dérision l’amour et le temps qui passe,
s’amuse et s’instruit. Un autre François-Ferdinand, l’archiduc,
est assassiné. Les jeunes gens s’engagent avec enthousiasme
dans la guerre, sans deviner que le déclin de la monarchie austro-hongroise
aura bientôt raison de leurs illusions.
Si La Marche de Radetzky illustrait
la gloire et le déclin de l’Autriche-Hongrie au rythme enjoué
de la marche militaire de Johann Strauss, le titre même de La
Crypte des capucins, qui décrit le désordre de l’Autriche
disloquée, évoque une marche funèbre. Joseph Roth, né en Galicie austro-hongroise en
1894 de parents juifs, mène parallèlement à sa carrière
de journaliste à Vienne, Berlin, Francfort, Paris, celle de romancier
et nouvelliste. Opposant de la première heure au national-socialisme,
il quitte l’Allemagne dès janvier 1933 pour venir s’installer
à Paris, où il meurt en 1939. Rabats jaquette : Joseph Roth est né en Galicie austro-hongroise en 1894, de parents juifs. Après des études de philologie à Lemberg et à Vienne, en 1916, il s’engage dans l’armée autrichienne. Au sortir de la guerre, il se tourne vers le journalisme tout en menant une carrière de romancier. Opposant de la première heure au national-socialisme, Roth quitte l’Allemagne dès janvier 1933 pour venir s’installer à Paris, où il meurt en 1939. Il laisse une œuvre abondante et variée : treize romans, huit longs récits, trois volumes d’essais et de reportages, un millier d’articles de journaux. Blanche Gidon, confidente et amie de Joseph Roth, était professeur dans un lycée parisien et traductrice littéraire. De Roth, dont elle a défendu l’œuvre avec passion, elle a traduit plusieurs romans et nouvelles.
Les éditions de La Crype des capucins
: Et un film allemand de Johannes Schaaf, adapté du roman en 1971 : Trotta |
Joseph Roth (1894-1939)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DES
INFOS AUTOUR DU LIVRE • Repères biographiques • Livres écrits en français • Traducteurs • Radio • Sur et avec Joseph Roth • Pourquoi lire Joseph Roth |
Fanny![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
J'ai vite été happée par cette lecture, la thématique
me laissait penser que l'approche serait plus ardue.
J'ai aimé la dimension instructive de la peinture sociale qui traverse
le récit. Je trouve aussi qu'à plusieurs moments Roth donne
un regard décalé qui amène un angle de vue intéressant.
Par exemple sa définition de la guerre mondiale (p. 71, éd.
du Seuil) : "Non
parce qu'elle a été faite par le monde entier mais parce
qu'elle nous a tous frustrés d'un monde..."
Ou encore sur la vision des matins :"faux
ami, morose et doucereux, perfide bienfaiteur".
L'entrée dans la guerre marque un point de rupture avec un saut
dans le temps entre l'annonce du début de la guerre et une immersion
directement deux ans plus tard (p. 81).
Cette rupture se retrouve dans le basculement de la relation aux autres
des personnages principaux, en particulier dans leurs relations amoureuses.
Au début du chapitre 30, en quelques mots Roth dresse une peinture
du statut marital qui est très éloignée du romantisme
passionné et vient en quelque sorte répondre au positionnement
volage en début de roman et corroborer les craintes des jeunes
étudiants. Le glissement du "je" sur le "on"
au deuxième paragraphe embarque, je trouve, le lecteur dans cette
position ("Je
couchais donc dans notre maison aux côtés d’Élisabeth.
C’était ma maison. Elle était ma femme. En vérité,
le lit conjugal devient une maison secrète, au beau milieu de la
maison visible, ouverte. Et la femme qui nous
y attend a notre amour tout simplement parce qu’elle est là,
présente. Elle est là, présente à toute heure
de la nuit, quel que soit le moment où l’on rentre. Par conséquent,
on l’aime. On aime ce qui est sûr,
on aime tout particulièrement ce qui nous attend, ce qui se montre
patient.")
Quelques bémols cependant au niveau du style : je trouve
que régulièrement les chapitres se terminent sur des envolées
lyriques un peu lourdes. Heureusement que ce n'est pas davantage présent,
car je pense que j'aurais trouvé cela surfait, d'autant que cela
a parfois un côté poncif par exemple sur l'instinct
de maternité "qui
ne connaît pas de bornes" ou trop emphatique, par
exemple : "fardeau chéri
de nous tous".
J'ouvre aux ¾ et j'ai hâte de découvrir vos avis.
Laura![]()
Je suis dans la dernière ligne droite de mes partiels et de fait
je me suis peu plongée dans le livre même si on avait beaucoup
de temps pour le lire…
J'ai tout de même lu jusqu'à la page 78 (chapitre 17), mais
je n'ai pas du tout accroché. Je ne sais pas vraiment ce qui m'a
bloquée : son style d'écriture qui m'a semblé parfois
maladroit, l'idée d'avoir un narrateur à la première
personne et pourtant omniscient, ou le fait d'avoir l'impression que l'auteur
repoussait toujours le "vrai" sujet du livre à plus tard,
comme s'il y avait nécessairement des détails inintéressants
à raconter avant. J'ai vraiment eu l'impression qu'il cherchait
à cocher des cases : j'ai raconté l'histoire du cousin,
bon, maintenant il faut le marier, allez hop en une demi-page, c'est fait
! Ce survol m'a rapidement lassée, et m'a sincèrement empêchée
de m'attacher aux personnages. Et puis, c'est quoi cette manie de répéter
3 ou 4 fois en 78 pages "au-dessus
des verres où nous buvions ensemble, la mort croisait ses mains
décharnées", ce n'est pas le dernier vers
d'Apollinaire, non plus ! Je serai néanmoins charitable :
j'admets que le sujet aurait pu être intéressant s'il avait
été bien traité, le déclin et la décadence
d'une génération qui fait face à la réalité
de la guerre, c'est intriguant. Seulement, les romantiques y ont déjà
pensé. Conclusion : soit j'ai vraiment loupé quelque chose
- ce qui est possible vu mon rythme de lecture - soit le livre est bâclé,
maladroit, inabouti, et se veut de la bonne littérature sans parvenir
à l'être. Hâte de lire les avis de tout le monde, je
changerai peut-être d'avis.
Mais pour l'instant, je le ferme.
Nathalie![]()
Bonsoir, je ne peux pas être parmi vous ce soir et je vous envoie
quand même une petite participation en espérant que j'arriverai
à finir le livre ce week-end.
J'ai réussi à en lire à peu près la moitié.
J'avoue que j'ai un peu traîné la patte… les chapitres
sont courts, c'est agréable à lire, mais j'ai du mal à
comprendre sa programmation.
À mon stade de lecture, je trouve le texte trop simple et surtout
un peu répétitif.
Le narrateur ne cesse de faire des prolepses* qui nous conduisent après
la guerre et après la modification profonde d'une organisation
sociale et politique. C'est assez vite pénible.
La description de la jeunesse oisive et décadente (qui a un rapport
aux femmes assez particulier) et la mention de ses activités sont
répétées également plusieurs fois - de même
que la métaphore de la mort qui plane au-dessus d'eux.
Il me semble que certaines affirmations auraient pu être approfondies.
Par exemple, la construction identitaire d'une nation par les membres
qui en sont d'une certaine manière extérieurs - parce que
raccordés - est très intéressante. Cela va également
avec le costume qui semble pour le narrateur la garantie d'une âme
slave !
Bref pour le moment j'ouvre un quart. Je crois que je sature un peu des
œuvres nostalgiques et pour moi ce roman manque de dynamisme.
*Question à Nathalie
: peux-tu donner un exemple de "prolepse", car on risque de
ne pas comprendre ta critique et juste visualiser une maladie de peau.
Voir des éléments de réponse
›ici
Manuel![]() (en
Inde)
(en
Inde)
J'ai fini la lecture de La Crypte des capucins et j'enchaîne
la lecture de La Marche de Radetzky. Je ne comprenais pas pourquoi
le héros François-Ferdinand revenait de la guerre tel un
paria. C'est qu'il était déshonorant de ne pas avoir combattu.
Il est décrit comme un perdant. J'ai trouvé étonnant
le personnage de la femme tiraillée entre son mari et sa compagne
créatrice ou la mère seule qui est forcée de convertir
sa maison en pension. La Crypte est un livre crépusculaire
traversé de la nostalgie d'un empire perdu. D'ailleurs, j'ai parcouru
les pages Wi-Ki de l'histoire
de l'empire austro-hongrois et pour situer les pays qui le composaient.
Il y a tellement de choses apprises à l'école dont on ne
se souvient plus. Comme dans La Marche, on suit l'épopée
du héros lors de différentes situations et époques :
Joseph Roth nous fait passer d'une situation à une autre en une
phrase. La Guerre de 14 est survolée, on perd de vue le cousin
qui fait une rapide apparition au retour de Vienne. Le fils du cocher
rappelle le contexte politique.
Des tournures poétiques m'ont parfois paru alambiquées et
il y a beaucoup de répétitions : les mains de la mort.
J'ai beaucoup pensé aux Buddenbrook
qui est une espèce de pendant prussien du roman de Roth. Le passage
de la mort de Jacques est bouleversant ainsi que la scène dans
le café avec l'arrivée des nazis. J'ouvre aux ¾ en
recommandant La Marche qui donne l'impression d'un roman plus achevé,
travaillé et virtuose. Philip Roth a terminé la rédaction
de La Crypte à la fin de sa fin pendant son exil. Ce qui
explique cela je pense.
Etienne![]()
J'aime beaucoup les romans historiques, mais La Crypte des capucins
n'a emporté qu'une (petite) moitié de mon adhésion,
je dois avouer que je m'attendais à un peu mieux. Je vais commencer
par ce qui m'a plu :
- L'atmosphère globale du livre est très bien sentie ; on
arrive presque à palper cette ambiance de fin de règne et
la grande connaissance de l'auteur de son empire, ses ethnies, coutumes,
rend le récit assez poignant.
- La lecture est fluide ; l'écriture est ce qu'il faut de sophistiquée
pour avoir un charme désuet.
- L'effet de surprise total de la deuxième partie avec le ménage
à trois est cocasse.
Cependant, même s'il est sympathique, ce roman m'a paru avoir des
défauts gênants :
- de (très) nombreuses répétitions de tournures de
phrases, d'aphorismes donnent véritablement l'impression d'avoir
lu un brouillon. Je cite : "la
mort croisait ses mains décharnées", les
"blondes aux formes
généreuses", "nous
étions jeunes…" et j'en passe probablement,
répétées parfois 4 fois sur 40 pages. Joseph Roth
m'a souvent donné l'impression d'un gentil grand-père gâteux
qui rabâche… S'il-vous-plaît, dites-moi que je ne suis
pas le seul à avoir ressenti ça !
- Même amusante, son écriture faite d'hyperboles a fini par
me lasser et surtout m'a rendu complètement désincarnés
les personnages : impossible de ressentir de l'empathie pour François-Ferdinand,
Elisabeth, Joseph Branco et consorts.
- Des ellipses trop brutales, surtout que ces dernières ne me paraissaient
pas vraiment servir un propos.
En résumé je dirais que, même s'il possède
le charme d'avoir su retranscrire l'atmosphère de déliquescence
d'une époque, j'ai été déçu. Je pense
aussi qu'inconsciemment j'en attendais une sorte de Le
pont sur la Drina version
autrichienne et qu'il a souffert de la comparaison.
Je l'ouvre à moitié.
Catherine, entre
![]() et
et
![]() (à
Annecy)
(à
Annecy)
Je connaissais Joseph Roth de nom, mais n'avais
jamais lu ses livres. J'ai donc commencé par La marche de Radetzky,
avant de lire La Crypte des capucins, un peu dans l'idée
que l'un était la suite de l'autre, ce qui n'est pas vraiment le
cas en fait. Les périodes se chevauchent et il s'agit de deux branches
différentes de la famille Trotta. Dans les deux cas, on assiste
à la fin de l'empire austro-hongrois, mais l'ambiance est différente,
le style aussi. La Crypte des capucins est un récit à
la première personne ; j'ai apprécié le ton plutôt
nostalgique, et l'ambiance un peu funèbre, comme l'indique le titre,
d'un monde en train de sombrer. Cette fin est annoncée dès
la première page. La mort est régulièrement évoquée,
avec une phrase stéréotypée qui revient régulièrement
comme un leitmotiv, "la
mort croisait déjà ses mains décharnées au-dessus
des verres", contrastant avec le milieu dans lequel évolue
le personnage principal, de jeunes bourgeois, désenchantés,
oisifs et inconscients du fait que la guerre approche et qu'ils vont tout
perdre.
J'ai trouvé le personnage de François-Ferdinand attachant,
avec son côté un peu décalé. On est assez surpris
qu'il soit fasciné par son cousin Joseph, le vendeur de marrons
et de pommes cuites, et par Manès, le cocher de fiacre, au point
qu'il accepte de se faire plumer sans protester, et qu'il aille séjourner
sans hésiter à Zlotogrod. Cela permet à l'auteur
de nous expliquer, via le comte Chojnicki, le rôle essentiel dans
l'empire des États entourant l'Autriche. La vision de Vienne, donnée
par Joseph Roth, m'a parue très différente de celle donnée
par Zweig dans Le
monde d'hier.
Il y a très souvent des moments d'humour, la description des deux
Slovènes, les beignets de quetsches au moment du départ
de François-Ferdinand pour la guerre, le beau-père chapelier
qui se transforme en fabricant de képis lorsque la guerre éclate,
puis se lance dans le commerce des arts décoratifs, la mère
qui devient beaucoup plus gaie quand elle est sourde et qu'elle perd un
peu la tête. Le personnage d'Elisabeth, que l'on retrouve après
la guerre, vivant avec une femme, et qui finit par s'enfuir avec elle,
après être retournée plusieurs fois dans le lit de
son mari, est plus inattendu, surtout pour l'époque.
Le contexte historique m'a beaucoup intéressée, bien qu'il
ne soit qu'ébauché, vu uniquement à travers le vécu
du personnage principal. C'est parfois un peu frustrant mais ce n'est
pas un roman historique. Ça m'a donné l'occasion d'aller
réviser un peu. L'histoire est évoquée par petites
touches. La guerre se limite à une retraite et un séjour
plutôt bref dans un camp russe, la chute de la république
via l'enterrement du fils de Manès, presque incidemment et l'arrivée
des nazis par l'irruption d'un personnage bizarre dans le restaurant où
dînent François-Ferdinand et ses amis. Là encore,
le contraste entre son aspect assez ridicule (son chapeau ressemble à
un pot de chambre et on pourrait le confondre avec un préposé
aux lavabos) et la terreur qu'il inspire à tous les dîneurs
qui s'enfuient, est très réussi.
J'ouvre l'ensemble (Marche et Crypte) entre ½ et
¾.
Annick
L![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
S'engager dans la lecture de ce roman est un peu déroutant :
il faut s'habituer au point de vue très subjectif du narrateur
(dans lequel l'auteur s'est visiblement beaucoup projeté), avec
toutes ses lacunes. Le lecteur n'a pas forcément les repères
historiques et géographiques (où se trouvait la Galicie ?)
qui permettraient de contextualiser le récit. Et François-Ferdinand
von Trotta lui-même a un comportement erratique, comme s'il avait
perdu le sens de son existence et se laissait porter par les événements
: il se marie, il retrouve un lointain cousin, s'engage dans une division
militaire périphérique... Quelles sont ses motivations au
juste ?
Ce personnage de grand bourgeois oisif est d'ailleurs peu attachant, avec
son absence totale d'empathie, son cynisme, sa frivolité. Mais
il a une qualité essentielle : sa capacité d'auto-dérision
! Et cela en fait un observateur remarquable de cette époque de
fin de règne, de cette société en pleine décadence.
J'ai beaucoup pensé à un autre roman d'un auteur autrichien
qui se situe dans le même contexte : L'Homme
sans qualités de Robert Musil.
L'entrée en guerre précipite l'intrigue et ramène
FFVT à des enjeux essentiels : comment survivre ? Comment se reconstruire
quand les fondements même de sa vie antérieure se sont effondrés
: sa famille est ruinée, beaucoup de ses amis sont morts et l'empire
austro-hongrois n'existe plus, réduit à la seule Autriche.
J'ai été touchée par cette vision nostalgique, hantée
par la mort, d'un monde qui disparaît, mais aussi par l'évocation
de la confrontation d'un homme ordinaire avec la violence et l'absurdité
de la guerre, puis avec la barbarie du nazisme (la scène dans le
café est saisissante). Comme l'auteur, il ne reste plus à
FFVT que l'exil.
On ne peut rester indifférent au côté testamentaire
de ce dernier roman de Joseph Roth, un an avant sa mort à Paris.
Au-delà de ce roman il me reste une interrogation : comment Joseph
Roth a-t-il pu rester monarchiste, fidèle au mythe de l'empire
austro-hongrois salvateur ?
J'ouvre aux ¾ à cause de mes difficultés à
entrer en lecture.
Annick A![]() (en
direct pour les avis qui suivent)
(en
direct pour les avis qui suivent)
C'est
un livre historique profondément mélancolique sur la chute
de l'empire austro-hongrois et sa destruction jusqu'à l'Anschluss,
qui nous fait remarquablement ressentir le désespoir des personnages
et l'ambiance de l'époque. La mort est omniprésente avec
de beaux moments d'écriture. Par exemple : "à
mon retour de la guerre, et parce que je n'en revenais pas seulement mûri
mais foncièrement vieilli, les nuits de Vienne aussi me montrèrent
leurs rides, telles des femmes âgées, assombries par les
ans. […] La mort me gratifiait en somme d'un congé illimité,
mais il lui était loisible de l'interrompre à tout instant
et les affaires d'ici-bas ne me concernaient plus guère."
François-Ferdinand,
un Trotta, est un personnage très attachant, profondément
humain, qui s'attache aux gens différents de lui, tels son cousin
Joseph Branco le marchand de marron et Manès Reisiger, cocher.
La scène où il accompagne son serviteur Jacques mourant
est très émouvante. Il est clairvoyant quant à l'avenir.
J'ai beaucoup aimé le passage entre la mère et le fils,
très pudiques quant à leurs sentiments qui les lient ; leur
amour mutuel se dit à travers des petits riens et de bons petits
plats. J'aime le personnage de la mère. C'est une forte femme froide
et dure avec son fils, mais sachant lui montrer son amour et qui ne s'en
laisse pas conter. La description de sa mort est comique : "Faites
vite, mon père, le Bon Dieu n’a pas autant de loisir que l’Église
se l’imagine parfois […]
Si tu revois Élisabeth, mais je crois que cela n’arrivera
pas, dis-lui que je n’ai jamais pu la souffrir."
Très belle écriture poétique et très fine
dans ses descriptions. La fin est tragique. François-Ferdinand
se retire du monde : "Je
me trouvais exclu du circuit des vivants ! Exclu, oui, quelque chose
comme exterritorialisé. C’est bien cela, j’étais
exterritorialisé de la terre des vivants, voilà."
Dans ses derniers moments près de la crypte des Capucins où
il ne peut entrer, nous pouvons y lire l'amour de Joseph Roth pour les
Habsbourg.
C'est un bien beau roman qui m'a plongée dans un monde qui m'était
inconnu. Je ne l'ouvre qu'aux
¾ car quelques passages
m'ont ennuyée.
Brigitte![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
Nous avions lu dans le groupe La marche de Radetzky.
La Crypte des capucins se place aussi dans le contexte de la fin
de l'empire austro-hongrois, mais un peu différemment.
C'est un livre très pessimiste sur la fin d'un monde et l'échec
de l'ancienne classe aisée viennoise à s'y adapter. Mais
peut-on s'adapter à une société qui plonge dans le
totalitarisme ?
L'écriture est vraiment intéressante, même s'il s'agit
d'une traduction. Je suis très impressionnée par cette phrase
: "La mort croisait
déjà ses mains décharnées au-dessus des verres
que nous vidions." Elle revient comme un leitmotiv tout
au long de la description de la vie à Vienne avant le début
de la Guerre de 14. C'est un procédé littéraire que
je découvre ici, dont l'efficacité est redoutable pour produire
une ambiance plutôt macabre, comme les visites à la crypte
des Capucins, dans la seconde partie, au retour de la guerre.
Beaucoup de scènes sont à retenir : tout ce qui concerne
la relation du héros avec sa mère figée dans son
monde ancien, dont l'affection pour son fils est évidente, mais
peu manifeste ; la scène de la mort du vieux serviteur, à
qui François-Ferdinand sacrifie sa nuit de noces. Je passe sur
les péripéties de sa relation avec Élisabeth, pour
retenir la dernière scène, où un militant nazi intervient
dans un café, provoquant l'effondrement total et définitif
du monde viennois.
L'empire austro-hongrois n'était plus qu'un monde de pacotille,
qui finit balayé par les nazis.
Pour terminer, je citerai quelques phrases qui m'ont fait réfléchir
: il est question du vacarme spécial causé par "ces
individus qui n'ont plus de présent mais qui sont sur le chemin
menant du passé à l'avenir, d'un passé familier à
un avenir extrêmement incertain" (p. 58)
et dans la seconde partie : "Il
est dans la nature humaine de préférer au chagrin particulier
la calamité générale qui dévore tout."
(p. 145)
J'ouvre aux ¾.
Jérémy![]()
Avant la lecture
Je connaissais Joseph Roth de nom, mais ne l'avais jamais lu. Je dois
avouer que je ne savais même pas vraiment qu'il était autrichien,
je pensais plus à lui comme à un auteur allemand. J'étais
impatient de le lire. D'une part parce que je vais bientôt en Autriche
et ai découvert l'existence, en préparant mon voyage, de
la fameuse crypte des Capucins où sont enfermées les sépultures
des Habsbourg. La lecture de ce livre me semblait donc particulièrement
à-propos en guise "d'amuse-bouche". D'autre part, tant
l'époque, début du XXe siècle, que l'origine géographique
de l'auteur, la Mitteleuropa, m'attirent. J'étais enfin heureux
de pouvoir découvrir un nouvel auteur autrichien, n'ayant lu jusqu'à
présent que Zweig.
Après la lecture
J'ai lu ce livre presque entièrement sur une journée, le
1er mai, alors que je ne suis pas un lecteur particulièrement rapide.
La lecture est donc très fluide et agréable sans qu'on puisse
dire que Roth est un grand "styliste".
Je crois que si j'ai aimé ce livre, ce n'est pas tant ni pour son
style que pour l'empathie que j'ai ressentie envers François-Ferdinand,
représentant d'un monde sur le point de disparaître et qui
ne sent pas/plus à sa place, ni avant, et encore moins après
la guerre : "Je ne suis
pas fils des temps présents. Il me paraît même difficile
de ne pas me déclarer absolument leur ennemi."
J'ai aimé son côté intrinsèquement réactionnaire
et pourtant attachant, ainsi que la description, par touches, du monde
tel qu'il est et surtout tel qu'il vient, décadent, marqué
un renversement des valeurs et de l'ordre établi et qui est décrit
par le biais de ses représentants : Elisabeth, qui croise les jambes
de manière indécente, qui a des lectures frivoles pour ne
pas dire inconvenantes, qui fume et qui s'adonne au lesbianisme, qui se
met aux arts décoratifs (cf. mots de la mère du narrateur
sur ce point : "Si nous
nous mettons à fabriquer avec des matériaux sans valeur
des choses qui ont l'air d'en avoir, où cela nous mènera-t-il
?"), le professeur Yolande : "Où
est le vieux ?" (en parlant du père d'Elisabeth,
ce qui marque la perte du respect pour les anciens par la nouvelle génération).
Stettenheim qui parle fort, fait de grands gestes, est mal élevé,
grotesque, vulgaire.
Et pourtant le passé ne vaut pas mieux ; les aristocrates que le
narrateur fréquente sont décrits ainsi : frivolité
sceptique, mélancolie impertinente, laisser-aller coupable, air
de distraction hautaine, etc. Ils ne pensent qu'à s'amuser, se
complaisent dans leur cynisme. Sous le vernis du raffinement, il n'y a
que pourriture.
Les seuls à sauver sont Joseph, Manès et le Polonais qui
les recueille : simplicité, droiture, jovialité, solidarité,
une vie simple et laborieuse, au contact de la terre les caractérisent,
et non une vie faite d'oisiveté et de plaisirs faciles.
J'ai aussi aimé le livre pour les portes qu'il m'a ouvertes : je
ne connaissais pas du tout l'histoire de l'empire austro-hongrois. Je
me suis un minimum renseigné au moment où il est question
de la Cisleithanie (partie allemano-autrichienne) et de la Transleithanie
(partie hongroise) et ce livre m'a donné envie d'aller plus loin.
J'aime les livres qui amènent vers autre chose.
J'ai aimé le personnage de la mère que j'ai trouvé
à la fois touchant et très drôle : "Faites
vite, mon Père, le bon Dieu n'a pas autant de loisir que l'Église
se l'imagine parfois.", "Oh
! alors mon garçon n'insiste pas. Ces amitiés-là
je les connais de ouï-dire. Ça me suffit. J'ai pas mal lu,
mon petit ! Tu ne te doutes pas combien j'en sais, des choses ! Un amant
aurait mieux valu. Les femmes, à peine si on peut s'en débarrasser.
Et depuis quand y a-t-il des femmes professeurs ?"
J'aurais cependant préféré que le livre m'en donne
plus. Le narrateur qualifie l'aristocratie décadente plus qu'il
ne la donne à voir. J'aurais aussi aimé qu'il m'en dise
plus sur cet empire, sur sa substance, sur les raisons pour lesquelles
il y était tant attaché. J'ai l'impression qu'il est un
peu resté au milieu du gué. Par manque de temps ? D'énergie ?
Par volonté de produire un roman très ramassé ?
La fin du livre m'a particulièrement marqué. Le narrateur
dit que les affaires d'ici-bas ne le concernaient plus guère et
signe ainsi son renoncement et son apathie. Malgré tout, les affaires
d'ici-bas finissent par le rattraper, pour le pire : il se retrouve avec
une croix gammée sur les bras... Son renoncement et sa passivité
sont coupables. Pour moi, ce passage est très intéressant
et nous interroge aujourd'hui : on ne peut pas vivre de manière
"extraterritorialisée" comme le souhaite le narrateur
en se repliant sur sa vie d'individu privé et en délaissant
la chose publique et ses devoirs de citoyens. Cela m'a fait penser à
ce mot de Montalembert
: "Vous avez beau ne
pas vous occuper de politique, la politique s'occupe de vous tout de même."
Renée![]() (à
l'écran depuis Narbonne)
(à
l'écran depuis Narbonne)
On nous parle d'une une Europe avant la Guerre de 14. Toutes ces provinces
sont compliquées.
Ceci mis à part, j'ai lu ce livre avec plaisir.
Roth décrit parfaitement l'effondrement de l'Autriche, de la société,
des valeurs morales.
L'épisode entre Élisabeth et son amie m'ont rappelé
que début 20e il y a eu une libération des femmes qui ont
osé (voir l'exposition "Pionnières")
fumer, travailler et revendiquer leur homosexualité (pensons aux
amies de Colette). Malheureusement la guerre a arrêté cette
évolution.
Roth montre bien la destruction des hommes par la guerre ; les rescapés
envient quelquefois les morts car ils se sentent "inféconds",
"impropres à la mort".
Il y a des passages grotesques : la nuit de noce ou l'ami qui a rasé
sa moustache pour ressembler à son domestique, puisqu'il est réellement
son "propre domestique" et joue les deux personnages
en se donnant des ordres, c'est risible !
Le symbole du rideau baissé dans le bar à la fin est très
beau.
Le pessimisme de Roth m'a touchée, mais je n'ouvre le livre qu'à
moitié à cause de mon inculture historique...
Geneviève![]()
C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Il n'a pas la même
puissance, la même force que d'autres livres de Roth que j'ai lus,
mais il y a une finesse, une tendresse que j'ai appréciées.
Il commence ainsi : "Nous
nous appelons Trotta. Notre race est originaire de Sipolje, en Slovénie.
Je dis bien race, et non famille, car nous ne sommes pas une famille."
Et se termine par ces mots : "Où
aller à présent ? Où aller ? Moi, un Trotta ?"
Le livre commence et finit par ces questions d'identité. Cela m'a
beaucoup plu.
Un autre aspect du livre qui domine pour moi, c'est l'originalité
de ce personnage qui devient ami avec ceux qui ne sont pas de son monde.
Il choisit ces deux hommes qui incarnent des valeurs.
La relation avec sa mère est d'abord distante, mais elle bouge
énormément. C'est lui qui comprend ce qui se passe, c'est
lui qui la sauve, qui la comprend : "De
jour en jour d’ailleurs, ma mère devenait de plus en plus
injuste, particulièrement depuis que j’avais pris l’hypothèque
sur notre maison. Arts décoratifs, Élisabeth, dame professeur,
cheveux coupés, Tchèques, sociaux-démocrates, jacobins,
Juifs, viande en conserve, papier-monnaie, papiers en Bourse, beau-père,
toutes ces choses-là excitaient son mépris et son animosité."
Quant à sa judéité, il n'y attache pas vraiment d'importance
: c'est être Trotta qui compte.
J'ai aimé la finesse et la subtilité pour évoquer
la relation entre des personnes et des lieux, et la perplexité
de ces gens qui vivent cette période. J'ouvre aux ¾, contente
d'avoir lu ce livre.
Danièle
(qui a lu en allemand, puis en français pour découvrir la
traduction)
Je la trouve excellente ! J'avoue que je n'ai pas tout relu en entier.
Mais j'ai éprouvé un réel plaisir à lire alternativement
les deux. Rien à redire, sauf, pour pinailler, l'expression fréquenter,
qu'elle utilise en intransitif dans l'expression "des milieux
où je fréquentais". J'aurais dit "des
milieux que je fréquentais". Mais ce n'est rien
par rapport au style, aussi raffiné que celui de l'auteur. Je n'ai
pas vu de trahison dans la traduction. Bref, j'étais fort satisfaite.
Claire, qui avait eu vent de cette remarque et pour pinailler
J'ai vu dans le dictionnaire
que fréquenter est trans et intransitif, avec un exemple
pris chez Marcel : "Ce
n'est pas que la duchesse de Guermantes eût un salon plus aristocratique
que sa cousine. Chez la première fréquentaient des gens
que la seconde n'eût jamais voulu inviter" — construction
intransitive qui va bien avec la décadence...
Danièle entre ![]() et
et![]()
Merci pour cette recherche qui me fait d'autant plus admirer la traduction
: trouver l'équivalent du style de cette époque dans la
langue surannée de de Proust, c'est du grand art !
Je me sens proche de ce qu'a dit Annick A. C'est un livre touchant
et intéressant du point de vue historique, et parce qu'il livre
une atmosphère, celle de la fin d'une époque : et j'ai retrouvé
la nostalgie (plus ou moins justifiée !) du monde d'hier, comme
dans Stefan
Zweig.
Mais aussi la nostalgie d'un empire en décadence, comme l'empire
tsariste puis soviétique que défend tant Poutine... j'ai
donc été ramenée aussi à notre époque,
et cherché à comprendre le sentiment de perte et de dégradation
que peuvent éprouver les ressortissants d'un pays qui a connu une
certaine grandeur par l'étendue de son territoire mais aussi, par
l'assujettissement des populations qui le constituent, il ne faut pas
l'oublier. Or, le narrateur idéalise ce monde, pas si rose, pour
en avoir la nostalgie... !
Le livre nous fait entrer dans sa vie : il regrette la monarchie, l'empire
austro-hongrois. Il montre que les Juifs font partie intégrante
d'un monde qui n'a pas de frontières, comme si l'antisémitisme
n'existait pas à l'époque. Tolérant, il apprécie
la richesse de la diversité, tout en remarquant au passage que
tout le monde n'en profite pas de la même manière : "Les
tziganes de la plaine hongroise, les Houzoules subcarpathiques, les cochers
juifs de Galicie, mes propres parents, marchands de marrons à Sipolje,
les Souabes, planteurs de tabac de la Bacska, les éleveurs de chevaux
de la steppe, ceux de Bosnie et d’Herzégovine, les maquignons
de l’Hanakie en Moravie, les tisserands de l’Ersgebirg, les
meuniers et les marchands de corail de Podolie, tous, ils nourrissaient
généreusement l’Autriche. Plus ils étaient pauvres
et plus ils étaient généreux. Tant de souffrances,
tant de maux, volontairement offerts comme une chose toute naturelle,
avaient été nécessaires afin que le cœur de
la monarchie pût passer dans le reste du monde pour la patrie de
la grâce, de la gaieté, du génie !"
C'est donc une vision finalement assez subtile qu'il nous livre des rapports
entre les populations de l'Empire.
Une certaine veine romantique apparaît aussi dans sa déclaration
de se sentir plus en communion avec son cousin Joseph Branco, vendeur
de marrons, et Manès Reisiger, cocher de fiacre, qu'avec ses relations
un peu dandy de l'époque d'avant. Un peu une constante dans la
littérature germanophone, et en particulier chez Goethe, dans Werther,
qui explique qu'il éprouve de la joie dans les petits plaisirs
simples de la vie, ou encore ce passage où il se sent en totale
empathie avec un paysan qui a les mêmes déboires amoureux
que lui.
Par ailleurs je me suis délectée de découvrir des
noms et des régions totalement inconnus de moi. Cette région
du monde a connu de tels bouleversements !
La guerre, il n'en parle pas, il a été prisonnier très
vite, et se déclare lui-même "impropre à la mort",
vivant pour constater avec amertume le déclin de l'Empire austro
hongrois et l'arrivée du nazisme.
Trotta lui-même est un personnage attachant, qui livre honnêtement
ses sentiments profonds envers les gens qui l'entourent, en particulier
les liens très ambigus avec sa mère, d'apparence froide,
mais qui cache ses sentiments pour lui. Mais c'est vers elle qu'il revient
en premier après la guerre. C'est elle qui le pousse à revoir
Élisabeth, malgré son antipathie pour sa belle-fille. Elle
le pousse à trouver une solution, devant la nouvelle situation
à laquelle il est affronté au retour de la guerre. Pragmatique
mais non pas insensible, elle ne cherche pas à savoir ce que son
fils a vécu pendant la guerre.
Lui a surtout perdu ses illusions : les amis qu'il s'est choisis en opposition
à sa classe sociale l'ont déçu, la vie qu'il a subie
pendant la guerre, ne lui a pas coûté la vie, il n'a même
pas été vraiment blessé, mais il a traversé
géographiquement et socialement cette époque sans y mettre
vraiment du sien. Seul son caractère trempé et son honnêteté
lui ont fait bénéficier d'avantages matériels
Élisabeth, sa femme par la force des circonstances, est un personnage
à part. En contraste avec le style traditionnel représenté
par la mère du narrateur, elle a adopté un style de vie
"moderne" pour l'époque (cheveux courts, vie de bohème…).
Elle mène sa vie comme elle le veut à l'intérieur
du couple, délaisse son enfant pour profiter de sa liberté
(de créer ?). La mère, qui semblait figée dans son
espace de vie, se met à apprécier sur le tard une vie plus
chaotique et moins routinière. Dans ce livre, les femmes bougent
! Et Trotta, conscient des manipulations exercées par les uns et
les autres, essaie de faire la part des choses. Il n'entrera en colère
qu'une seule fois, lors de la dépossession des biens de sa mère.
Il semble plutôt le reste du temps considérer cela avec humour.
Ce livre, dans un style très agréable à lire et une
langue riche et précise, fourmille de détails qui donnent
bien l'atmosphère de l'époque et fouille aussi la psychologie
des personnages. J'ai beaucoup aimé, sauf quelques longueurs à
la fin.
J'ouvre entre ¾ et grand ouvert.
Claire![]()
J'avais lu La marche de Radetsky dans le groupe il y a 34 ans,
donc je n'en ai aucun souvenir : mes vagues notes indiquent "quelques
scènes fortes", "des bouts de style dans une marée
de grisaille"... J'ai beaucoup aimé voir le film de 3h30 que
nous avons regardé en deux parties, plongeant agréablement
dans l'Histoire et dans l'histoire des Trotta, une bonne introduction
à notre livre, puisque le frère du grand-père de
notre narrateur était le héros était de la bataille
de Solférino qui sauva la vie de l’empereur François-Joseph
et qui d'obscur péquenot et petit lieutenant d’infanterie
devint baron — ce dont découle toute La marche de
Radetzky. Comme Manuel, j'ai pensé aux Buddenbrook
"transgénérationnel sur fond historique" qu'on
a lu l'été dernier. Bref !
La Crypte m'a bien plu. J'ai suivi avec un intérêt
constant :
- la description de sa bande d'aristocrates décadents avec ses
modes et conformismes intéressants : par exemple, notre narrateur
doit cacher qu'il est amoureux car c'est mal vu, mais il frime avec le
gilet à ramages acheté à son cousin slovène
vendeur de marrons
- les deux ploucs auxquels il s'attache, hauts en couleur
- le surgissement de la guerre et les aventures qui s'ensuivent, les nationalismes
qui montent dangereusement
- les relations avec les femmes (gratinée avec sa mère -
j'ai adoré - et surprenantes avec Élisabeth et la vilaine
Yolande) et celle avec le nouveau-né ("l'avoir
engendré ne suffisait plus. J'aurais voulu l'avoir porté
et mis en au monde. Il trottait dans la pièce, vif comme un furet.")
- et le narrateur auquel je me suis vraiment attachée, contrairement
à Annick L.
La fin est dramatique à souhait. Si je n'ouvre pas en grand, c'est
que j'aurais aimé moins d'ellipses à la fin pour bien tout
comprendre des événements politiques ; la crypte elle-même
m'a laissée un peu... froide.
Enfin, très important, car c'est la raison de la raison de l'intérêt,
j'ai vraiment apprécié l'écriture, la voix, le ton
mêlant :
- dérision ("Tous
auraient eu plaisir à m'acheter mon cousin tout entier, ma parenté,
mon cher Sipolje.")
- vague désespoir ("Nous
savourions notre tristesse avec la même étourderie que notre
plaisir.")
- ou carrément humour ("l'amour
passait pour un égarement, on considérait les fiançailles
comme une espèce d'attaque d'apoplexie, et le mariage comme une
maladie chronique").
Il y a une densité d'événements, de descriptions,
de réactions que j'ai lues avec un très grand plaisir.
Monique
L![]()
C'est un roman de la nostalgie irrépressible de la fin d'un monde,
de sa décomposition, de la désagrégation de la mosaïque
culturelle qu'a pu constituer aux temps de ses fastes la monarchie austro-hongroise.
Cela nous est relaté, non pas d'un point de vue historique ou guerrier,
mais au moyen de la biographie d'un jeune aristocrate qui passe d'une
vie de bourgeois insouciant de Vienne à celle d'un prisonnier dans
un camp de Sibérie, puis son retour dans un monde qu'il ne reconnaît
plus.
Le pouvoir d'évocation de l'auteur ressuscite avec talent cette
période et surtout la différence entre la Vienne d'avant
et après la Guerre de 14.
Pour le narrateur, mais également pour des personnes plus modestes,
comme le marchand de marrons, tout devient méconnaissable. Leur
monde est mort et ne reviendra plus.
Le narrateur se décrit comme un mort parmi les vivants : "Je
me trouvais exclu du circuit des vivants !"
L'intime se mêle ici à l'Histoire qui est juste évoquée,
comme les fusillades de février 1934 par l'enterrement du fils
révolutionnaire de Manès Reisiger.
L'auteur exprime son amertume, son regret et sa nostalgie du passé
mais aussi son pessimisme quant à l'avenir. Il regrette une Europe
cosmopolite qu'il oppose à une Europe des nations qui est bien
plus divisée (la réapparition des passeports).
Roth se montre conscient des problèmes futurs : le nazisme, la
question des nationalités, du nationalisme, des frontières,
des libertés.
Je comparerais ce roman à un tableau qui par touches nous décrit
une époque. L'écriture est élégante et la
mélancolie qui se dégage m'a beaucoup touchée.
Cet excellent roman m'a donné envie de lire La Marche de Radetzky
que je n'avais pas encore lu, que j'ai apprécié, mais
finalement j'ai une préférence pour La Crypte des capucins
que j'ouvre en entier.
Jacqueline![]()
Le livre, lu il y a un mois, m'avait bien plu, mais je l'avais
beaucoup oublié et ne savait plus guère comment en parler.
Je suis contente de vous avoir écouté pour le retrouver...
J'avais vu la deuxième partie du film La
Marche de Radetzky qui ne m'avait pas emballée
bien que ce soit joli — peut-être
était-ce parce que je n'avais pas vu la première. Cela m'a
amené à lire le roman, finalement très proche de
La Crypte des capucins, et j'ai du mal à séparer
les deux. Cependant, je préfère La Crypte dont le
narrateur est plus sympathique que le héros de La marche
— même
s'ils ont beaucoup de points communs…
Je me suis beaucoup retrouvée dans tout ce qui a été
dit. J'aurais aussi aimé que certains passages soient plus développés
notamment quand il est prisonnier en Sibérie. C'est très
ramassé et ça m'a laissée sur ma faim. Mais d'un
autre côté, le procédé est intéressant,
avec un livre court mais très dense.
J'ai commencé aussi un autre livre de Roth La
Toile d'araignée, l'histoire d'un jeune ambitieux dans
la montée du nazisme qui m'a rappelé L'Enfance
d'un chef de Sartre, mais je l'ai abandonné en cours de
route…
Je suis assez ignare en histoire mais, justement, j'ai aimé avoir
cet éclairage sur l'empire austro-hongrois — points
de vue légèrement complémentaires entre La Crypte
des capucins et La marche de Radetzky où il est question
de l'actuelle Hongrie. Sur une même période et avec un même
sentiment de perte, il m'a semblé que Roth parlait plus de l'empire
que Zweig dans Le
monde d'hier qui était centré sur
Vienne… J'ai pensé à d'autres livres que nous avions
lus sur cet empire et son éclatement, comme Le
pont sur la Drina d'Andric ; cela résonnait
aussi pour moi avec les figures ruthènes et les Carpathes de Appelfeld…
J'ouvre à moitié parce que j'avais beaucoup oublié,
mais j'ai été très intéressée par ce
que j'ai entendu ce soir.
Maëva![]() (à
l'écran depuis Toulouse)
(à
l'écran depuis Toulouse)
Cette œuvre est la première de Joseph Roth que je découvre
et j'avais peu de repères historiques avant de commencer. Pour
être honnête, j'ai eu du mal à entrer dans le récit.
Les répétitions et les images stéréotypées
de la mort ("la mort
croisait ses mains décharnées" p. 41
et p. 47 par exemple), assez prévisibles, me laissaient
à une distance respectueuse du narrateur.
Celui-ci
se présente comme sans ambition, il se laisse vivre oisivement
au début du roman et se délite au retour de la guerre. Il
semble impuissant et assiste simplement aux événements.
Cette passivité m'a un peu questionnée au départ.
Les mentions répétées de la mort à travers
le roman m'ont fait penser à une marche funèbre et on sait
très vite le délitement à venir. Cette présence
témoigne aussi des illusions de cette jeunesse qui ne s'attend
pas à la longueur et à la dureté de la guerre. Le
passage p. 64 en est un exemple, avant de
partir au front le narrateur dit à sa mère : "je
reviens bientôt" et elle lui répond simplement
: "je t'attends pour
déjeuner".
Par ailleurs, j'ai noté certains passages sur les femmes qui sont
décrites avec leurs "formes
généreuses" ou la description de Yolande
comme ayant un "fort
duvet ombrageant les lèvres" p. 123
ou encore celle de sa femme comme ayant un "goût
très prononcé pour ce qu'on appelle 'le ménage' et
la manie de l'ordre, de la propreté, comme bon nombre de femmes"
p. 167.
Je trouve que les points forts du livre sont :
- le délitement de la société austro-hongroise vécu
à travers celui du narrateur, ainsi que le personnage de la mère
;
- l'absence de récit de guerre (on évite le côté
cru des champs de bataille) ;
- l'épilogue, que je trouve particulièrement concis et efficace.
Comme beaucoup d'entre vous, j'ai été touchée et
marquée par la relation du narrateur avec sa mère. Je trouve
qu'elle symbolise à elle seule le délitement de la société,
tant elle transmet ces valeurs traditionnelles auxquelles le narrateur
est tant attaché. Le passage du retour après la guerre,
comme si les horreurs ou la destruction de la monarchie n'avaient pas
eu lieu, l'infirmité que la mère tente de cacher, sa lente
déchéance et sa mort, qui précède tout juste
l'arrivée des nazis au pouvoir, sont autant d'éléments
significatifs et particulièrement intéressants.
J'ai trouvé le décalage du monde de l'après-guerre
avec le narrateur saisissant, il y a une véritable fracture entre
deux périodes. Cette distinction est d'autant plus frappante que
le "monde d'après" s'est construit sans la présence
des combattants, ils n'ont plus de place : Zlotogrod a disparu, les marrons
sont véreux et le narrateur n'a aucun métier.
Si au début la posture du narrateur m'a un peu ennuyée,
je trouve, après avoir terminé le livre, qu'il fonctionne
avec cette émotion nostalgique et mélancolique qui traverse
le récit. Le traitement des personnages, que ce soit le narrateur,
la mère, Élisabeth ou l'amitié avec Branco et Manès,
montre avec subtilité les enjeux historiques.
C'est une bonne découverte et je pense lire La Marche de Radetzky
pour compléter ! Je l'ouvre aux ¾.
Claire
C'est l'écriture d'une
histoire, mais aussi l'histoire d'une écriture... Comment prendre
cette petite mise en abyme à deux moments, au ch. VII : "ll
me faut parler ici d'une chose importante et que j'avais espéré
pouvoir passer sous silence quand j'ai commencé
d'écrire ce livre. Il ne s'agit en effet de rien moins que
de la religion."
Et au ch. XX : "Il conviendrait
d'exposer ici les sentiments qui animent un prisonnier de guerre. Mais
je ne sais pas trop quelle grande indifférence rencontrerait actuellement
ce genre de récit. J'accepte volontiers
le destin d'être un disparu, mais je ne puis me résigner
à devenir le narrateur de choses disparues. À peine serais-je
compris si j'entreprenais de parler aujourd'hui de la liberté,
par exemple, ou de l'honneur, à plus forte raison de la captivité.
Mieux vaut se taire provisoirement. Je n'écris
que pour y voir clair en moi-même et aussi pro
nomine Dei. Qu'il
me pardonne le péché." Est-ce utile ? Quel
effet ça créé — me suis-je demandé :
une sorte de distance supplémentaire, et peut-être un après...
ce Trotta va écrire...
Comme le livre se termine sur les lieux d'un tombeau, j'en ai fait autant
et me suis livrée au fétichisme littéraire...
Je suis
d'abord allée non loin d'ici voir rue de Tournon où
il avait logé à l'hôtel, au-dessus du café
Tournon : |
|
Voilà la plaque
:  |
|
|
Pire que ça, après avoir lu le récit de son enterrement folko, je suis allée voir sa tombe, ce qui m'a permis de découvrir le cimetière parisien de Thiais, absolument gigantesque. Le livre La Crypte des capucins se termine par la visite d'une tombe, j'ai fait de même... Je voulais voir aussi les tombes de Paul Celan, Severo Sarduy et Zamiatine, mais c'est tellement étendu qu'il aurait fallu prévoir une randonnée de trois jours. Voilà la photo d'une allée au loin, les gens peuvent circuler en voiture tellement c'est grand : |
|
 |
Une
fois dans la division 63, j'ai cherché la tombe repérée
par une photo sur la fiche wikipedia de Roth :
Facile avec cette pierre grise à deux niveaux, et surtout avec ce petit arbuste, je vais la reconnaitre sans tarder... Et effectivement... J'ai alors éclaté de rire (intérieurement, étant donné la dignité des lieux) en découvrant l'arbuste... |
| 1=> Voici l'arbuste au pied de la tombe : | 2=> Et l'arbuste vu de l'autre côté de la tombe : |
 |
 |
|
J'ai trouvé que ce gag
allait très bien à Joseph Roth...
Son enterrement est commenté par plusieurs contributeurs au Cahier de L'Herne consacré à Roth : je ne peux résister à les citer... : |
|
| Paula Jacques -
Il y aura cet enterrement inénarrable. On se dispute la dépouille
spirituelle du mort. Il y a ceux qui veulent un rabbin et des prières
en hébreu et ceux qui disent : vous n'y êtes pas, il
s'était converti… Le problème, c'est qu'on ne trouve
pas le certificat de baptême… Bref, les juifs, les communistes,
les anarchistes - il avait écrit des articles sous le pseudonyme
de Joseph le Rouge - tous ceux qui le revendiquent sont furieux. Et
l'enterrement se termine comme une comédie à l'italienne. Florence Noiville - Une comédie qui se termine à Thiais… Pourquoi Thiais ? Personne ne sait vraiment très bien. Il voulait être enterré à Montmartre où reposait le grand Heine qu'il admirait beaucoup. Mais… c'était trop cher. Alors il a cette petite tombe à Thiais. Une petite tombe envahie par les herbes… La tombe se trouve dans la section catholique du cimetière. L'inscription sur la pierre tombale dit : "écrivain autrichien - mort à Paris en exil." Je ne crois pas que beaucoup d'admirateurs aujourd'hui viennent lui rendre visite de façon posthume [si si si, MOI, mes photos le prouvent !]. Mais ça aussi, Roth l'avait anticipé : "Ma mort, disait-il, sera aussi solitaire que l'aura été ma vie." Blanche Gidon, sa traductrice et amie, était présente aux funérailles à Thiais : voir ›son récit |
|
Jérémy, quant à lui, a filé directement à Vienne après la séance afin de faire un reportage photographique sur la crypte des Capucins où logent 149 Habsbourg, dont 12 empereurs et 19 impératrices et reines...
|
Au centre François-Joseph,
à gauche Rodolphe, à droite Sissi :
 |
|
Sissi...
(1854-1898) = Élisabeth de Wittelsbach, impératrice
d'Autriche,
reine de Hongrie, de Bohême et de Lombardie-Vénétie :  |
|
Rodolphe,
prince héritier (1858-1889), fils de François-Joseph
et Sissi :
 |
 |
|
L'entrée de la crypte des
Capucins (Kapuzinergruf) :
 |
|
La séance
se déroule dans le jardin plein de charme de Suzanne |
Brigitte![]() (avis transmis)
(avis transmis)
Ce roman inspiré de la vie de l'auteur Joseph Roth est plaisant
à lire. La préface
de la traductrice qui a connu l'auteur est très intéressante
pour situer le livre dans son époque. La lecture est facile alors
que, vu le sujet, je m'attendais à une lecture plus ardue. Facile
: je me dis que cela cache peut-être des éléments
que je n'ai pas vus... De plus ce livre est riche en références
historiques, ce que je trouve intéressant pour se replonger dans
l'Histoire.
Je vois trois parties dans le roman : la vie d'un jeune aristocrate
viennois avant, pendant et après la Première Guerre mondiale
et les conséquences de cette dernière sur la société
viennoise.
Dans la première partie je fais connaissance avec François
Ferdinand Trotta, le narrateur - même prénom que l'archiduc
François Ferdinand d'Autriche, héritier de l'Empire austro-hongrois
dont un ancêtre des Trotta a sauvé la vie à Solferino.
Je n'ai pas lu
La Marche de Radetzky, mais j'ai regardé la mini-série
allemande. L'atmosphère est sombre, avec la chute de l'empire
austro-hongrois au rythme de la musique militaire de Strauss. Je souligne
des répétitions imagées sur la mort… c'est,
je pense, un choix de l'auteur pour nous imprégner de l'atmosphère
viennoise du début du XXe et partager l'ambiguïté entre
la jeunesse aristocratique qui se noie dans un tourbillon de vie (surtout
festif et nocturne) et la mort qui plane.
Revenons à François Ferdinand. Ce jeune homme a de l'humour,
il m'est sympathique. C'est un homme bon, un grand noctambule, membre
de l'aristocratie viennoise à l'aube de la Grande Guerre, qu'il
qualifie à son retour de "fête de la mort". La
mort plane et Trotta s'étourdit dans des occupations frivoles et
coupables à la recherche d'une confirmation de la vie car la mort
menace : "au-dessus
de nos verres que nous vidions gaiement, la mort invisible croisait déjà
ses mains décharnées".
Puis Trotta se marie rapidement avec une sobriété militaire
et part de suite à la guerre. Alors, j'attendais un récit
chargé d'émotion. Mais c'est comme si, pour se protéger
ou pudiquement, le narrateur n'avait pas envie de partager ces mois/années
en Russie. Trotta survole son parcours de soldat captif. A-t-il honte
de ne pas avoir été un soldat combatif au front dans la
lignée de ses ancêtres, de ne pas être un héros
? Lorsque sa femme lui demande : "Et
toi qu'as qu'as-tu fait tout ce temps-là ?" Il
répond sobrement : "Je
me suis laissé pousser par les événements."
Il ne veut ou ne peut pas le lui raconter. Revenir pour lui c'est être
"impropre à la
mort". La blessure est forte.
Enfin, le retour (c'est la partie que je préfère) tant espéré
à Vienne arrive pour lui et ses amis sauvés des mains de
la mort. Mais la ruine, le désespoir sans borne les attendent.
Sa mère s'est ruinée en emprunts de guerre, mais d'autres
comme son beau-père ont tiré profit de la guerre et se sont
enrichis. Les titres de noblesse sont abolis. Il dit : "nous
avions tous perdu notre position, notre maison, notre argent, notre valeur,
notre passé, notre présent, notre avenir."
Leur vie perd de son sens et vivre leur donne un mal être et de
grandes souffrances morales. "Et
chacun de nous enviait ceux qui étaient tombés au champ
d'honneur". Arrivera-t-il à vivre sans illusion
? Il se dit aussi incapable de prendre des responsabilités : "je
ne craignais pas la mort mais un bureau, un notaire, un postier me faisaient
peur." Il apprend à se fâcher… :
trop drôle ! Mais l'Histoire ne l'épargne pas. Il reste seul,
perdu, abandonné face à la tentative d'hégémonie
allemande : même la crypte des Habsbourg ne sera pas un refuge.
J'ai bien aimé les personnages : sa mère vieillissante et
sourde, bien sévère pour son fils et elle-même, mais
qui se révèle séductrice et sociable, sa femme Elisabeth
(même prénom que la princesse Sissi, femme de Francois Joseph
Ier empereur d'Autriche), artiste et émancipée accompagnée
de son amie la vilaine Yolande, ses deux amis d'un autre milieu social,
surprenants hommes rustiques que sont son cousin Joseph Branco et le cocher
Manès Resiger… Les personnes sont souvent dépeintes
avec une pointe d'humour et force de qualificatifs. Chapitre XXX, je m'amuse
de sa vision du foyer conjugal.
Roth posent des questions autour des territoires, des unités linguistiques
et ethniques, des frontières et de la complexité de cohabitation
de multiples nationalités, à la fois source de richesses
et source de conflits. Guerre entre les peuples et souffrance d'hier,
d'aujourd'hui et de demain !?
Ce livre me ramène à une fresque historique que j'ai lue
l'été dernier, un roman qui a comme point de départ
l'exil d'un couple autrichien juif vers la République dominicaine
dans les années trente : Les
déracinés de Catherine Bardon. Je n'oublie pas un
clin d'œil à Thomas Mann et les
Buddenbrook.
Chantal![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Voici mon avis, pas très étoffé, j'ai oublié
mes notes à Houat. Acte manqué ? Peut-être, parce
que la chose qui me revient sans cesse de cette lecture, ce sont les menaces
de mort qui planent au-dessus des verres de ces jeunes gens insouciants
à la veille de la guerre de 1914. Quelquefois, j'ai peur qu'elles
ne planent au-dessus de nos verres !
J'ai lu ce livre il y a deux mois, beaucoup trop vite, et il m'en reste
peu d'impressions - enfin je le croyais - sinon d'une écriture
remarquable et d'une grande nostalgie du narrateur et de l'auteur de ce
temps passé, l'empire austro-hongrois où le peuple était
"gouverné", où l'ordre et la stabilité
régnaient.
Mais en relisant certains chapitres, je réalise un texte beaucoup
plus riche, plus profond que ce que j'en avais perçu.
La narration me semblait "froide", les faits , rien que les
faits, ce que Roth nomme "la réalité transformée",
avec pour moi pas assez d'émotion… les faits, le départ
à la guerre, les camps de prisonniers, le retour, les retrouvailles
avec les amis rescapés de la guerre, les faits, les faits... Mais
cette sobriété de narration met en relief, bien plus que
s'ils étaient étalés, l'amour de sa patrie, l'amour
de sa mère, de sa famille Trotta, et surtout sa douleur de l'explosion
de cette patrie !
Il y a de la poésie dans ces phrases concises, un moment, Dieu
sait pourquoi, j'ai pensé à l'écriture de contemporains,
Marguerite Duras.
Enfin le dernier chapitre, en 1939, dans le café de Vienne où
se retrouvent les amis, l'arrivée du jeune nazi, là c'est,
comment dire ? Après ces chapitres linéaires, le bouleversement
total ! Le mouvement, la précipitation, la peur, l'effroi même,
la fuite. Changement d'écriture, moi lectrice, j'ai peur.
Et le départ du narrateur avec le chien, vers la crypte des Capucins,
seul, le désespoir total. Quelle chute !
Et... dès l'arrivée des nazis au pouvoir, les livres de
Joseph Roth sont brûlés ! Bien sûr, juif, pacifiste.
Je l'ouvre aux ¾, le ¼ enlevé, c'est moi, ma lecture
trop superficielle.
Un auteur injustement méconnu. Merci Voix au chapitre !
Édith![]()
Mon avis est très proche de celui de Chantal.
Je me suis précipitée sur le texte sans regarder préface
ou post face : miam miam, une lecture qui coule toute seule. Mais une
écriture que j'ai eu envie de qualifier de blanche. J'étais
un peu déçue. Puis j'ai regardé le film La
Marche de Radetzky et ai eu beaucoup
de plaisir. J'ai saisi tout à coup l'émotion qui manquait.
Puis j'ai lu la documentation sur le site et tout s'est rassemblé.
J'ai alors repris le texte et corné presque toutes les pages, y
trouvant beaucoup d'humour, des dialogues superbes, une situation parfois
abracadabrante, des descriptions de scènes formidables comme la
nuit de noce.
Il m'a fallu tout ça (première lecture, film, documentation,
reprise du texte) pour pouvoir voir la force du texte.
Grâce à tous ces éléments, L'auteur et le narrateur
me semble très proches
Ce qui explique cette lecture "blanche" c'est mon rapport à
l'empire austro-hongrois, vague souvenir de la 5e et de la 4e ; autre
est une lecture concernant l'Algérie par exemple, dont l'histoire
me concerne plus émotionnellement.
Un seul lien unissait tous ces gens alors : la langue et l'empereur, relevant
de l'imaginaire.
J'ouvre aux ¾ avec le regret que la première lecture de
ce livre ne m'ait pas embarquée, mais du coup j'ai vécu
avec lui pendant un mois.
Suzanne![]()
Quand j'ai commencé, je me suis dit c'est bon, c'est comme Les
Buddenbrook, le déclin d'une famille.
Mais j'ai lu sur cette époque Elisabeth
Badinter.
Comme j'ai déjà lu cette histoire du déclin quand
on voit tous les peuples qui étaient dans cet empire sous la fascination
de l'empereur, j'aurais pu éviter de lire La Crypte des capucins,
que j'ai trouvé pas compliqué à lire, mais pas inoubliable.
J'ai cependant apprécié le leitmotiv sur la mort et j'ouvre
à moitié.
Marie-Thé![]()
J'ouvre ce livre aux ¾ et si je le ferme ¼, c'est à
cause d'un je ne sais quoi que je n'arrive donc pas définir...
J'ai aimé suivre François Ferdinand Trotta, depuis sa jeunesse
privilégiée insouciante à Vienne, jusqu'à
son errance tourmentée s'achevant devant la crypte des Capucins
(notre basilique Saint-Denis à nous...). À l'origine de
ce parcours, je vois la figure importante du père. "Mon
père, lui, fut un rebelle (...) un rebelle et un patriote."
Il fallait "réformer
l'empire et sauver les Habsbourg". "Dans
son testament, il me désigna comme l'héritier de ses idées."
J'ai été attentive à la préface de Dominique
Fernandez, nous rappelant l'intérêt de ce fils Trotta pour
"l'autre", sa sensibilité à celui qui est différent,
grand bourgeois accueillant le "déclassé" de sa
famille ou venant en aide à l'ami de celui-ci, l'humble cocher,
pour son fils Éphraïm. Je reconnais là Joseph Roth
tel qu'il est présenté dans la postface, attentif aux nécessiteux
"enfermés en Autriche". Désespéré,
il allait se suicider. Son Autriche d'autrefois avait disparu. Ceci me
ramène à la dernière ligne du texte de Joseph Roth
: "Où aller à
présent ? Où aller ? Moi, un Trotta ?"
Parallèle avec la monarchie austro-hongroise :
"La grandeur de l'empire,
selon Roth, ne tenait pas à sa capitale autrichienne, mais aux
nombreuses provinces hétérogènes dont il était
constitué (...). Toute la richesse était dans les marges."
Où est ce "métissage
intelligent entre peuples divers" qu'aurait souhaité
Joseph Roth ?
Joseph Roth était juif, Trotta, son personnage, ne l'était
pas, mais ils étaient proches.
Ce livre me fait penser à une marche funèbre, c'est aussi
une quête.
Insouciance et pressentiments, confusion des sentiments, antisémitisme,
amitiés pesantes, mère souveraine, portraits de femmes peu
flatteurs, hommes lâches, religion (pour le pardon ?), effondrement
d'un monde, de tous ("Nous
avions tous perdu... notre passé, notre présent, notre avenir.").
Tout y est.
Mort et amour sont mêlés (quand même, la nuit de noces,
il envoie un papier vierge juste signé à sa femme, tout
y est dit...) Est-ce drôle ? Tout comme l'échange de la mère
avec le conducteur de fiacre la menant au Prater : "Tous
ceux qui vivent sans travailler sont des capitalistes ",
sauf les mendiants...
J'ai beaucoup aimé les portraits, savoureux et parfois drôles
(le notaire, et même le redoutable M. von Stettenheim qui parle
très fort). La nature est belle, jusqu'au ciel étoilé
de Sibérie.
Effondrement d'un monde amenant à ceci : "c'est
probablement ainsi que les gens vivront un jour (...) embrassant comme
mère de la fécondité une terre en train de se dessécher"
Résonance avec aujourd'hui.
J'ai bien sûr pensé à Stefan
Zweig, à Robert Musil. Intéressant rapprochement avec
Le Guépard, mais Roth et Lampedusa sont
bien différents.
Manuel![]()
J'ai lu La Crypte des capucins puis La Marche de Radetzky.
Je ne comprenais pas pourquoi le héros François-Ferdinand
revenait de la guerre tel un paria. C'est qu'il était déshonorant
de ne pas avoir combattu. Il est décrit comme un perdant. J'ai
trouvé étonnant le personnage de la femme tiraillée
entre son mari et sa compagne créatrice ou la mère seule
qui est forcée de convertir sa maison en pension. La Crypte
est un livre crépusculaire traversé de la nostalgie d'un
empire perdu. D'ailleurs, j'ai parcouru les pages wikipédia de
l'histoire de
l'empire austro-hongrois et pour situer les pays qui le composaient.
Il y a tellement de choses apprises à l'école dont on ne
se souvient plus. Comme dans La Marche, on suit l'épopée
du héros lors de différentes situations et époques :
Joseph Roth nous fait passer d'une situation à une autre en une
phrase. La Guerre de 14 est survolée, on perd de vue le cousin
qui fait une rapide apparition au retour de Vienne. Le fils du cocher
rappelle le contexte politique.
Des tournures poétiques m'ont parfois paru alambiquées et
il y a beaucoup de répétitions : les mains de la mort.
J'ai beaucoup pensé aux Buddenbrookqui
est une espèce de pendant prussien du roman de Roth. Le passage
de la mort de Jacques est bouleversant ainsi que la scène dans
le café avec l'arrivée des nazis. J'ouvre aux ¾ en
recommandant La Marche qui donne l'impression d'un roman plus achevé,
travaillé et virtuose. Philip Roth a terminé la rédaction
de La Crypte à la fin de sa fin pendant son exil. Ce qui
explique cela je pense.
Etienne![]()
J'aime beaucoup les romans historiques, mais La Crypte des capucins
n'a emporté qu'une (petite) moitié de mon adhésion,
je dois avouer que je m'attendais à un peu mieux. Je vais commencer
par ce qui m'a plu :
- L'atmosphère globale du livre est très bien sentie ; on
arrive presque à palper cette ambiance de fin de règne et
la grande connaissance de l'auteur de son empire, ses ethnies, coutumes,
rend le récit assez poignant.
- La lecture est fluide ; l'écriture est ce qu'il faut de sophistiquée
pour avoir un charme désuet.
- L'effet de surprise total de la deuxième partie avec le ménage
à trois est cocasse.
Cependant, même s'il est sympathique, ce roman m'a paru avoir des
défauts gênants :
- de (très) nombreuses répétitions de tournures de
phrases, d'aphorismes donnent véritablement l'impression d'avoir
lu un brouillon. Je cite : "la
mort croisait ses mains décharnées", les
"blondes aux formes
généreuses", "nous
étions jeunes…" et j'en passe probablement,
répétées parfois 4 fois sur 40 pages. Joseph Roth
m'a souvent donné l'impression d'un gentil grand-père gâteux
qui rabâche… S'il-vous-plaît, dites-moi que je ne suis
pas le seul à avoir ressenti ça !
- Même amusante, son écriture faite d'hyperboles a fini par
me lasser et surtout m'a rendu complètement désincarnés
les personnages : impossible de ressentir de l'empathie pour François-Ferdinand,
Elisabeth, Joseph Branco et consorts.
- Des ellipses trop brutales, surtout que ces dernières ne me paraissaient
pas vraiment servir un propos.
En résumé je dirais que, même s'il possède
le charme d'avoir su retranscrire l'atmosphère de déliquescence
d'une époque, j'ai été déçu. Je pense
aussi qu'inconsciemment j'en attendais une sorte de Le
pont sur la Drina version
autrichienne et qu'il a souffert de la comparaison.
Je l'ouvre à moitié.
Jean![]()
Personnellement je n'ai pas trouvé d'intérêt à
ce livre qui n'est ni historique (manque de mise en perspective des événements
personnels du narrateur), ni empathique (la décadence de la famille
Trotta ne m'a fait ni chaud ni froid). Enfin l'Anschluss de Hitler ne
peut manquer de nous ramener à "l'Anschluss" du jour,
celui de Poutine... et sur ce qui semble "normal" : le règlement
des conflits pas la violence. Sur le temps long, la "démocratie"
grecque aura-t-elle été une parenthèse ? Cela aurait-pu
être la question du livre de Roth.
Intellectuel autrichien d'origine juive, Joseph Roth décrit dans
La Crypte des capucins la fin d'un monde, celui du vaste empire
Austro-Hongrois. Un empire qui s'écroule après la mort de
l'Empereur François Joseph et surtout après la défaite
de la première guerre mondiale. Pour Joseph Roth, c'était
un empire multiculturel comprenant
différentes langues et peuples (Hongrois, Slaves, Allemands, Tchèques,
Croates, Serbes, Bosniaques, Italiens, Slovènes…). Face à
la montée du nazisme, Joseph Roth sera contraint de s'exiler à
Paris en 1933. Il décédera en 1939 à l'âge
de 45 ans.
La crypte des Capucins se trouve à Vienne dans le sous-sol d'une
église. On y découvre les gisants d'une quinzaine d'Empereurs
et d'Impératrice ayant régné sur le vaste empire
Austro-Hongrois, depuis 1633. La "maison des Habsbourg" administrera
le saint Empire romain germanique (Autriche, Hongrie et Bohème)
jusqu'à François Joseph qui meurt en 1916. La Crypte
des capucins commence juste avant la guerre.
Le narrateur appelé François Ferdinand est un cousin des
"Trotta", famille dont l'histoire est relatée sur trois
générations un autre roman La marche de Radetzky".
C'est un riche bourgeois de Vienne qui mène une vie insouciante,
quand surgit la guerre et la mobilisation. A la recherche de ses origines
Slovène, il sera affecté dans un régiment de paysans
et d'artisans en Galicie Orientale, limite extrême de l'empire face
aux cosaques. Prisonnier des Russes et sera envoyé dans un camp
en Sibérie. De retour à Vienne, il retrouvera sa mère
vieillie, et sa femme sous influence d'une autre femme artiste et homosexuelle.
L'empire a disparu et c'est un monde nouveau dans lequel François
Ferdinand ne se reconnaîtra pas. L'ancienne Autriche, celle de Vienne,
capitale des arts, il la retrouve alors dans la crypte des capucins où
dorment "ses" empereurs oubliés. Une époque où
l'on pouvait être différent, être autrichien et citoyen
du monde… " j'ai perdu mon pays. J'appartiens à une époque,
en apparence ensevelie où l'on trouvait tout naturel qu'un peuple
fut gouverné parce qu'il ne pouvait pas se gouverner lui-même
sans précisément cesser d'être un peuple ".
C'est un roman écrit à la première personne du singulier,
qui passe pour une sorte de confession de Joseph Roth sur son époque
et sur la nostalgie qu'il éprouve à propos de l'ancien l'empire
austro-hongrois. La Crypte des capucins est un de ces ouvrages
que les nazis brûleront en 1933 lors de leurs fameux autodafés
en place publique car contraire à "l'esprit allemand"
selon eux.
Catherine,
entre ![]() et
et
![]()
Je connaissais Joseph Roth de nom, mais n'avais
jamais lu ses livres. J'ai donc commencé par La marche de Radetzky,
avant de lire La Crypte des capucins, un peu dans l'idée
que l'un était la suite de l'autre, ce qui n'est pas vraiment le
cas en fait. Les périodes se chevauchent et il s'agit de deux branches
différentes de la famille Trotta. Dans les deux cas, on assiste
à la fin de l'empire austro-hongrois, mais l'ambiance est différente,
le style aussi. La Crypte des capucins est un récit à
la première personne ; j'ai apprécié le ton plutôt
nostalgique, et l'ambiance un peu funèbre, comme l'indique le titre,
d'un monde en train de sombrer. Cette fin est annoncée dès
la première page. La mort est régulièrement évoquée,
avec une phrase stéréotypée qui revient régulièrement
comme un leitmotiv, "la
mort croisait déjà ses mains décharnées au-dessus
des verres", contrastant avec le milieu dans lequel évolue
le personnage principal, de jeunes bourgeois, désenchantés,
oisifs et inconscients du fait que la guerre approche et qu'ils vont tout
perdre.
J'ai trouvé le personnage de François-Ferdinand attachant,
avec son côté un peu décalé. On est assez surpris
qu'il soit fasciné par son cousin Joseph, le vendeur de marrons
et de pommes cuites, et par Manès, le cocher de fiacre, au point
qu'il accepte de se faire plumer sans protester, et qu'il aille séjourner
sans hésiter à Zlotogrod. Cela permet à l'auteur
de nous expliquer, via le comte Chojnicki, le rôle essentiel dans
l'empire des États entourant l'Autriche. La vision de Vienne, donnée
par Joseph Roth, m'a parue très différente de celle donnée
par Zweig dans Le
monde d'hier.
Il y a très souvent des moments d'humour, la description des deux
Slovènes, les beignets de quetsches au moment du départ
de François-Ferdinand pour la guerre, le beau-père chapelier
qui se transforme en fabricant de képis lorsque la guerre éclate,
puis se lance dans le commerce des arts décoratifs, la mère
qui devient beaucoup plus gaie quand elle est sourde et qu'elle perd un
peu la tête. Le personnage d'Elisabeth, que l'on retrouve après
la guerre, vivant avec une femme, et qui finit par s'enfuir avec elle,
après être retournée plusieurs fois dans le lit de
son mari, est plus inattendu, surtout pour l'époque.
Le contexte historique m'a beaucoup intéressée, bien qu'il
ne soit qu'ébauché, vu uniquement à travers le vécu
du personnage principal. C'est parfois un peu frustrant mais ce n'est
pas un roman historique. Ça m'a donné l'occasion d'aller
réviser un peu. L'histoire est évoquée par petites
touches. La guerre se limite à une retraite et un séjour
plutôt bref dans un camp russe, la chute de la république
via l'enterrement du fils de Manès, presque incidemment et l'arrivée
des nazis par l'irruption d'un personnage bizarre dans le restaurant où
dînent François-Ferdinand et ses amis. Là encore,
le contraste entre son aspect assez ridicule (son chapeau ressemble à
un pot de chambre et on pourrait le confondre avec un préposé
aux lavabos) et la terreur qu'il inspire à tous les dîneurs
qui s'enfuient, est très réussi.
J'ouvre l'ensemble (Marche et Crypte) entre ½ et
¾.
Claire![]()
J'avais lu La marche de Radetsky dans le groupe il y a 34 ans,
donc je n'en ai aucun souvenir : mes vagues notes indiquent "quelques
scènes fortes", "des bouts de style dans une marée
de grisaille"... J'ai beaucoup aimé voir le film de 3h30 que
nous avons regardé en deux parties, plongeant agréablement
dans l'Histoire et dans l'histoire des Trotta, une bonne introduction
à notre livre, puisque le frère du grand-père de
notre narrateur était le héros était de la bataille
de Solférino qui sauva la vie de l’empereur François-Joseph
et qui d'obscur péquenot et petit lieutenant d’infanterie
devint baron — ce dont découle toute La marche de
Radetzky. Comme Manuel, j'ai pensé aux Buddenbrook
"transgénérationnel sur fond historique" qu'on
a lu l'été dernier. Bref !
La Crypte m'a bien plu. J'ai suivi avec un intérêt
constant :
- la description de sa bande d'aristocrates décadents avec ses
modes et conformismes intéressants : par exemple, notre narrateur
doit cacher qu'il est amoureux car c'est mal vu, mais il frime avec le
gilet à ramages acheté à son cousin slovène
vendeur de marrons
- les deux ploucs auxquels il s'attache, hauts en couleur
- le surgissement de la guerre et les aventures qui s'ensuivent, les nationalismes
qui montent dangereusement
- les relations avec les femmes (gratinée avec sa mère -
j'ai adoré - et surprenantes avec Élisabeth et la vilaine
Yolande) et celle avec le nouveau-né ("l'avoir
engendré ne suffisait plus. J'aurais voulu l'avoir porté
et mis en au monde. Il trottait dans la pièce, vif comme un furet.")
- et le narrateur auquel je me suis vraiment attachée.
La fin est dramatique à souhait. Si je n'ouvre pas en grand, c'est
que j'aurais aimé moins d'ellipses à la fin pour bien tout
comprendre des événements politiques ; la crypte elle-même
m'a laissée un peu... froide.
Enfin, très important, car c'est la raison de la raison de l'intérêt,
j'ai vraiment apprécié l'écriture, la voix, le ton
mêlant :
- dérision ("Tous
auraient eu plaisir à m'acheter mon cousin tout entier, ma parenté,
mon cher Sipolje.")
- vague désespoir ("Nous
savourions notre tristesse avec la même étourderie que notre
plaisir.")
- ou carrément humour ("l'amour
passait pour un égarement, on considérait les fiançailles
comme une espèce d'attaque d'apoplexie, et le mariage comme une
maladie chronique").
Il y a une densité d'événements, de descriptions,
de réactions que j'ai lues avec un très grand plaisir.
Marie-Odile![]()
Jusqu'à la mobilisation, je me suis demandé où voulait
en venir l'auteur même si le leitmotiv "Au-dessus
des verres où nous buvions ensemble, la mort croisait déjà
ses mains décharnées" ne laisse aucun doute
sur la suite. La nostalgie de l'empire, l'attachement à la patrie,
l'opposition entre l'Autriche et les pays de la Couronne imprègnent
la vie du narrateur, mais les événements historiques ne
me sont pas apparus de façon suffisamment claire à travers
ce récit. La nostalgie de la monarchie et de l'aristocratie est
toujours présente mais jamais vraiment justifiée. Que faut-il
regretter de la vie d'avant ? De cette Vienne qui tirait son faste de
"la sève des
peuples asservis" qui "grandissait,
mais sur un sol engraissé par la douleur et l'affliction".
Les lieux, les portraits évoqués m'auraient semblé
plutôt ternes sans le pittoresque et la légère ironie
qui les accompagne souvent. Mais je n'ai à aucun moment éprouvé
de sympathie pour les personnages même pour les personnages féminins
qu'il s'agisse de la mère figée dans son rôle (et
dont la déchéance puis la mort fait écho à
l'écroulement de la monarchie et à
la désintégration de la société), ou d'Elisabeth
au parcours imprévisible et pas vraiment émancipateur dans
les Arts déco ou le cinéma.
Certains aspects m'ont intéressée : l'impact de la guerre
sur la vie dans ce qu'elle a de plus privé, l'idée que la
calamité générale est préférable au
chagrin particulier, l'incapacité du narrateur à se lancer
dans des opérations supposées productives. Mais le ton uniforme
empreint de morosité, de désespoir, ne m'a pas séduite.
L'écriture m'a semblé manquer de relief. Tout est raconté
de la même façon. Je n'ai ressenti aucune émotion.
Même lorsque la décadence et le désenchantement s'infiltrent
partout, dans le couple, la famille, les affaires, la finance, la vieillesse,
etc.
Il s'agit de la fin d'un monde certes, mais rien à voir avec Le
monde d'hier
de S. Zweig, œuvre qui rendait compte du même bouleversement
de façon autrement bouleversante !
En résumé, le texte de Roth ne m'explique rien des
événements historiques. Je n'ai pas réussi à
les cerner vraiment à travers le vécu des personnages et
le parcours de ces derniers ne m'a pas touchée.
J'ouvre à moitié (très petite moitié).
J'ai aimé la postface
et Roth me semble plus intéressant que Trotta.
Soaz![]()
Je n'avais pas d'attente, concernant ce livre.
J'ai apprécié l'écriture à la première
personne du singulier, elle permet de s'identifier au narrateur. Lecture
facile.
Je n'ai pas apprécié les répétitions de phrase,
qui alourdissent le texte.
De nombreuses similitudes entre la vie et les événements
entre Trotta et Roth : est-ce la même personne ?
Vienne qui rayonne n'est pas l'Autriche, pays constitué de nombreuses
provinces - Slovénie, Galicie, Bosnie, Moravie, Transylvanie -,
ce qui fait sa diversité, sa force, sa richesse, mais aussi sa
perte par abandon des populations laissées pour compte.
La première partie, description de la jeunesse dorée, dissolue,
inconsciente d'une guerre proche et longue de Vienne ne m'a procuré
aucun plaisir de lecture. La décadence et la mort sont omniprésentes
: "c'est une époque
gaie, la mort il est vrai croisait déjà ses mains décharnées
au-dessus des verres que nous vidions". Il se détache
de son entourage frivole à la suite de la rencontre de son cousin
Joseph et du cocher Manès : un moment d'humanité, de retour
vers la réalité. Aucune démonstration affective de
la part de sa mère, pas d'émotions, mais une note affective
humoristique !! : "Nous
avons des beignets aux quetsches, manifestation merveilleuse de maternité,
en guise d'au revoir pour mes préparatifs vers la mort".
Le mariage avec Elizabeth, en toute hâte, avant le départ
à la guerre, pour concrétiser son amour, est une erreur
: "j'eus la soudaine
certitude que nous ne nous aimions pas".
Deuxième partie, il part à la guerre (la Première
Guerre mondiale) sans connaissance des faits et sans lucidité.
Il est fait prisonnier, il ne combattra pas, il vivra l'épreuve
de la solitude. Il y a peu de détails sur les faits de guerre,
par contre ce récit a ouvert ma curiosité sur l'histoire
de l'empire austro-hongrois.
Troisième partie, le retour : c'est la période que je préfère,
elle nous donne une description du quotidien, des mœurs, des évolutions.
Il n'a plus de codes, il est ruiné, il doit se refaire une place
dans un monde qu'il ne reconnaît plus. Il a perdu son rang et son
argent. Il est impropre à la mort. Sa femme, distante, émancipée,
vit avec une autre femme. Elle créée des bijoux art déco,
elle est chef d'entreprise. Après la naissance de son fils, il
reste seul. Sa mère son fardeau chéri décède
et il abandonne son fils chéri... L'arrivée des nazis provoque
une cassure définitive, il est juif. Son seul refuge, la crypte
des capucins, tombeau de tous les dirigeants des Habsbourg. Il erre seul,
avec un chien, perdu, c'est la fin…
Cindy (au téléphone)![]()
Le livre était moins dense que j'espérais et j'ouvre un
petit demi.
Mais j'ai eu un plaisir de lecture, on y entre comme dans une histoire
contemporaine, racontée de manière réaliste, avec
ses trois parties : une vie insouciante, la guerre et là on est
porté par l'Histoire, et enfin alors que ça pourrait s'arranger,
quelque chose de terrible va arriver.
J'ai apprécié les descriptions de la vie au quotidien, des
paysages, par exemple "Souvent, la nuit, j'entendais les cris rauques
et fréquemment interrompus
de vols d'oies sauvages qui passaient très haut dans le ciel. Mais
les marronniers imposants et vénérables commençaient
à se dépouiller déjà de leurs feuilles dures,
dorées et joliment dentelées."
J'ai trouvé le livre très humaniste.
Dans la vie du narrateur avec ses amis, on sent le coté très
humain, sa préférence pour des personnages pittoresques.
Il y a aussi une dimension tragique, avec cette fin d'un monde, où
quelque chose de grave va s'installer, qui va changer la vie des peuples.
On commémore plutôt des événements à
partir de la Seconde Guerre mondiale et là, ça m'a plu qu'on
se situe avant le début du siècle, dans un tout autre monde.
On est assez ému et bouleversé, avec ce retour à
la vie irrévocable du narrateur à la fin.
J'aurais aimé aller plus profondément dans les histoires
racontées, par exemple quand il est prisonnier : "On
eût dit que chacun d'eux, et chacun pour son propre compte puisqu'ils
étaient brouillés, voulait me témoigner son mépris
de ma non-intervention dans leur querelle. Ils s'attelèrent tous
les deux à un travail superflu. L'un aiguisait un couteau mais
sans rien de menaçant, l'autre mettait de la neige dans une marmite,
allumait le feu, y jetait de petites bûchettes, posait le chaudron
sur le foyer et gardait les yeux fixés sur la flamme. Une agréable
tiédeur se répandit. La chaleur se réverbérait
sur la fenêtre d'en face. Le reflet du feu bleuissait, rougissait,
violaçait les fleurs de glace. Les gouttes d'eau gelées,
par terre, juste sous la croisée, commencèrent à
fondre".
On sent que toute chose est au bord du gouffre. Ça a été
trop vite, j'aurais voulu rester encore.
Je suis sensible à la traduction et le livre m'a semblé
très bien traduit.
J'ai appris des choses, j'ai bien aimé avoir ce livre en main.
C'est un livre que je prêterais volontiers.
Et quelle coïncidence, un ami vient de me prêter un récit
d'Elise Fontenaille N'Diaye Blue
Book qui tombe bien après La Crypte : ce livre raconte
une page bien sombre de l'Allemagne, puissante colonisatrice qui occupa
l'actuelle Namibie de 1883 en 1916. On avait oublié que cette colonie
fut le théâtre d'un premier génocide du 20e siècle,
massacre des Hereros
et des Namas. Et je découvre avec surprise malheureuse qu'un
Von Trotha (Lothar), officier prussien, incarnation du militaire dans
toute sa brutalité, est à l'origine de cette armée
exterminatrice ! Voilà aussi quelque part, entre désert
et presqu'île de Shark
Island, une terrible préfiguration des exterminations à
venir…
| DES
INFOS AUTOUR DU LIVRE • Repères biographiques • Livres écrits en français • Traducteurs • Radio • Sur et avec Joseph Roth • Pourquoi lire Joseph Roth |
| La Marche de Radetzky, à
travers l'histoire de la famille Trotta sur trois générations,
commence en 1859 et va de l'apogée de l'empire austro-hongrois
à son déclin annoncé par la guerre de 1914 ;
le roman commence ainsi : "Les Trotta n'étaient pas
de vieille noblesse. Le grand-père avait été
anobli après la bataille de Solferino. Il était slovène
et avait pris le nom de son village natal, Sipolje". La Crypte des capucins commence à la veille de la guerre de 14 ainsi : "Nous nous appelons Trotta. Notre race est originaire de Sipolje, en Slovénie". Afin de se mettre historiquement et visuellement dans le bain austro-hongrois, nous avons regardé le film austro-franco-allemande La Marche de Radetzky d'Axel Corti, adapté du roman en 1994, avec Max von Sydow, Charlotte Rampling et Claude Rich (deux soirées d'1h 45). Voici ce qu'en disait Le Monde, enthousiaste, quand le film est passé en deux parties en 1995 sur France 2 › "La Marche de Radetzky, deux soirées d'exception". |
| REPÈRES BIOGRAPHIQUES |
Joseph Roth est né en Galicie (l'Ukraine aujourd'hui)
en 1894, sous le règne de l'empereur François-Joseph, dans
une famille juive modeste de langue allemande.
Au début de la première guerre mondiale, il travaille dans
le service de presse des armées impériales. Après
la guerre, il devient chroniqueur à Vienne et à Berlin.
Ses articles très demandés, traduisent un regard lucide
sur son époque et un monde qui disparaît.
Parallèlement, il entame une carrière de romancier. Son
œuvre la plus connue est La Marche de Radetzky, publié
en 1932, histoire de plusieurs générations d’une famille
sous la Monarchie austro-hongroise finissante. Exilé en France
dès l’arrivée au pouvoir des nazis – qui détruisent
ses livres –, il s’installe à Paris en 1934. Malade,
alcoolique et sans ressources il y meurt en 1939.
Pour des détails, voir la chronologie
du Cahier de l'Herne consacré à à Joseph
Roth ; voir aussi ›wikipedia.
Une
photo de la réalité... : cortège
funèbre de l'Empereur François-Joseph
se dirigeant vers la crypte des Capucins le 30 novembre 1916

| LIVRES PUBLIÉS |
On recense 13 romans, 8 longs récits
(la frontière entre les romans et les récits est parfois
difficile à établir), 3 volumes d'essais et de grands reportages
et un millier d'articles de journaux. Et la création de cette œuvre
n'a duré qu'une vingtaine d'années...
• Romans (présentés en ordre
chronologique de publication en allemand, avec pour certains des adaptations
au cinéma)
- 1923 : La
Toile d'araignée, trad. Marie-France Charrasse, Gallimard,
1970 ; rééd. L'Etrangère, 1991
; rééd. L'Imaginaire, 2004.
=>film allemand de Bernhard Wicki, adapté du roman en 1989 :
La
Toile d'araignée.
- 1924 : Hôtel
Savoy, trad. Françoise Bresson, Gallimard, 1969 ; rééd.
L'Imaginaire, 1987.
- 1924 : La Révolte, trad. de Charles Reber, Valois, 1930
; La Rébellion, trad. Dominique Dubuy et Claude Riehl, Seuil,
1988 ; rééd. Points, 1991.
- 1926 : Le
miroir aveugle, trad. et préface Nicolas Waquet , Rivages
poche, 2023.
- 1927 : Juifs
en errance,
suivi de L’Antéchrist
(publié en 1934), trad. de Michel-François Demet, Seuil,
1986.
- 1927 : La
Fuite sans fin, trad. Romana Altdorf et René Jouglet, Gallimard,
1929 ; rééd. L'Imaginaire, 1985.
- 1928 : Zipper
et son père, trad. de Jean Ruffet, Seuil, 2004.
- 1929 : Gauche
et droite, trad. de Jean Ruffet, Seuil,
2000 ; Les Belles Lettres,
2017.
- 1929 : Le
Prophète muet, trad. Michel-François Demet, postface
de Werner Lengning, Gallimard, 1972.
- 1930 : Incroyable ! Quatre traductions pour ce livre
:
›Première traduction Job : roman d’un simple juif,
trad. de Charles Reber, Valois, 1931
›Deuxième traduction
sous le titre Le
Poids de la grâce, trad. Paule Hofer-Bury, Calmann-Lévy,
1965 ; rééd. Biblio, 1984 ; Presses
Pocket, 1989 ; Livre de poche, 1992.
›Troisième
traduction : Job
: roman d'un
homme simple, trad. Silke Hass et Jean-Pierre Boyer, Tours, éditions
Panoptikum, 2011 ; puis Genève, éd.
Héros Limite, 2018.
›Quatrième
traduction Job
: roman d'un homme simple, trad. Stéphane Pesnel, Seuil,
2012 ; Points, 2013.
=>film américain d'Otto Brower,
adapté du roman en 1936 : Le
Chant des cloches
- 1930 : Le
Cabinet des figures de cire, précédé d'Images
viennoises : esquisses et portraits, trad. Stéphane
Pesnel, Seuil, 2009.
- 1932 : La
Marche de Radetzky, trad.
de Blanche Gidon, Plon et Nourrit, 1934 ; Plon,
1957 ; Le Cercle du bibliophile, 1971 ; traduction revue par Alain Huriot,
Seuil, 1982 ; Seuil, 1995 ; France Loisirs, 1995 ; Points,
2008 ; préface
de Stéphane Pesnel, Seuil,
2013.
=> mini-série
austro-franco-allemande d'Axel
Corti et Gernot Rollen trois épisodes, adapté
du roman en 1994 : La
Marche de Radetzky, avec Max von Sydow, Charlotte Rampling et
Claude Rich.
- 1934 : Tarabas
: un hôte sur cette terre, trad. de Michel-François
Demet, Seuil, 1985 ; Points, 1990 ; Points, 2009.
- 1934 : Juifs en errance (publié en 1927) suivi de
L'Antéchrist, trad. Michel-François Demet,
Seuil, 1986 ; rééd. 2009.
- 1935 : Le
Roman des Cent-Jours, trad. de Blanche Gidon, Grasset, 1937 ;
rééd. Seuil, 2004.
- 1936 : Notre
assassin, trad. de Blanche Gidon, R. Laffont,
1947 ; rééd. Christian Bourgois, 1994
; rééd. Folies d'encre,
2008 ; nouvelle traduction Confession
d'un assassin racontée en une nuit, Pierre Deshusses, Rivages,
2014.
- 1937 : Les
Fausses Mesures, trad. Blanche Gidon, éd. du Bateau ivre,
1946 ; trad. Brice Germain, Sillage, 2009.
- 1938 : La
Crypte des capucins, trad. Blanche Gidon, Plon,
1940 ; Seuil, 1983 ; Points, 1986 ; Points, 1994 ; un
coffret comportant La Marche de Radetzky, La Crypte
des capucins, La Rébellion, Points, 1994 ; Points
1996 avec préface
de
Dominique Hernandez ; Points,
2010 ; Seuil,
2014. Selon les éditions, un
texte de Blanche Gidon, la traductrice, figure en préface ou
postface.
=>film
allemand de Johannes Schaaf, adapté
du roman en 1971 : Trotta
- 1939 : Conte
de la 1002e nuit, trad. Françoise Bresson, Gallimard, 1973
; rééd. 1990 ; L'Imaginaire, 2003.
- 1940
: Léviathan,
trad. Brice Germain, Sillage, 2011.
• Nouvelles
- 1929 : Fraises,
trad. Alexis Tautou, L'Herne, 2015.
- 1929 : Viens
à Vienne je t'attends, trad. et préface Alexis Tautou,
L'Herne, 2015.
- 1934 : Le
Marchand de corail, trad. de Blanche Gidon et Stéphane
Pesnel, Seuil, 1996. Ce recueil comporte deux des nouvelles Le
Triomphe de la beauté et Le
Buste de l'empereur publiées en allemand
en 1934 et republiées dans Le
Buste de l'empereur, trad. par Blanche Gidon, Toulouse, éd.
Ombres, 2014.
- 1939 : La Légende
du saint buveur, trad. de Dominique Dubuy et Claude Riehl, Seuil,
1986 ; trad. Maël Renouard, Sillage, 2016.
=>film italo-français
d'Ermanno Olmi, adapté de cette nouvelle en 1988
: La
Légende du saint buveur.
- posthume : avant de fuir le nazisme, Roth avait remis
à son ami et éditeur Kiepenheuer deux cartons d'archives
ficelés qui, 40 ans plus tard, ont été exhumés
à Berlin-Est : ils contenaient un roman inachevé qui fut
publié en 1978, ainsi que 8 nouvelles écrites entre
1920 et 1929 : Perlefter,
histoire d'un bourgeois, trad. Pierre Deshusses, Robert Laffont,
2020.
• Chroniques, articles, essais
- À
Berlin, trad. Pierre Gallissaires, Monaco, Anatolia/Éd.
du Rocher, 2003 ; Les
Belles Lettres, 2021.
- Automne
à Berlin, trad. de Nicole Casanova, préface
de Patrick Modiano, La Quinzaine littéraire/Louis Vuitton,
2000 ; Les Belles Lettres, 2021.
- Croquis
de voyage, trad. de Jean Ruffet, Seuil, 1994 ; Points, 2016.
-
La
Filiale de l'enfer : écrits de l'émigration, trad.
Claire de Oliveira, Seuil, 2005.
- Le
genre féminin, trad. de Nicole Casanova, Liana Levi, 2006.
- Symptômes
viennois, trad. de Nicole Casanova, Liana Levi, 2004.
- Une
heure avant la fin du monde, trad. de Nicole Casanova, Liana Levi,
2009 ; recueil d'articles politiques écrits entre 1924 et 1938.
- Le
Deuxième Amour : histoires et portraits, trad. de Jean
Ruffet, Monaco, Anatolia/Éd. du Rocher, 2005.
- L'autodafé
de l'esprit, éd. Allia, 2019.
- Au
bistrot après minuit, trad. et préface, Pierre Deshusses,
Rivages, 2021.
- Poème
des livres disparus
& autres textes, trad. Jean-Pierre Boyer, Silke Hass, Genève,
Héros Limite, 2017.
- Joseph
Roth, journaliste : une anthologie (1919-1926), trad. Hugues Van
Besien, éd. Nouveau Monde, 2016.
• Correspondance
- Lettres
choisies (1911 - 1939), traduites, présentées
et annotées par Stéphane Pesnel, Seuil,
2007.
- Correspondance
Stefan
Zweig, Joseph Roth, trad. Gisella Hauer, préface Roland
Jaccard, Rivages, 2013.
| LES TRADUCTEURS |
Les traducteurs sont très nombreux.
La traductrice historique, amie de Joseph Roth, est Blanche Gidon (6 romans,
des nouvelles) : La
Marche de Radetzky (publié en 1932,
traduit en 1934), Le
Roman des Cent-Jours (publié en
1935, traduit en 1937), Notre
assassin (publié en 1936, traduit
en 1947), La
Crypte des capucins
(publié en 1938, traduit en 1940),
Les Fausses
Mesures (publié en 1937,
traduit en 1946), nouvelles "Le triomphe de la beauté"
et "Le buste de l'empereur", "Le marchand de corail",
parues dans Le
Marchand de corail.
Viennent ensuite des traducteurs spécialistes : Stéphane
Pesnel (4), Pierre Deshusses (3 livres et des nouvelles).
Puis Nicole Casanova (4), Jean Ruffet (4) et Michel-François Demet
(3), Brice Germain (2), Charles Reber (2), Claude Riehl (2), Jean-Pierre
Boyer (2), Dominique Dubuy (2), Silke Hass (2), Alexis Tautou (2 nouvelles).
Et n'ayant traduit qu'un seul texte : Maël Renouard, Marie-France
Charrasse, Paule Hofer-Bury, Claire de Oliveira, Pierre Bec, Pierre Gallissaires,
René Jouglet , Romana Altdorf. Alain Huriot a effectué la
révision de traduction de La marche de Radetzky.
| RADIO |
Trois émissions de radio très intéressantes
:
- "Spéciale
Odéon : Joseph Roth", Paula Jacques, Cosmopolitaine,
France Inter, 27 janvier 2013, enregistrée au Théâtre
de L'Odéon , le 10 décembre 2012, 54 min, avec Florence
Noiville et des textes lus par Michel Vuillermoz. Le dialogue Paula Jacques/Florence
Noiville a été publié dans le Cahier
de L'Herne consacré à Joseph Roth : voir ›ici.
- "Joseph
Roth, l'écrivain aux patries de papier (1894-1939)", Perrine
Kervran, Toute une vie, France Culture, 20 février 2016,
1h, avec des universitaires spécialistes de la littérature
de langue allemande : Erika Tunner, Carole Matheron, Stéphane Pesnel
(auteur de la préface à
La marche de Radetzky), et Jacques Le Rider, historien spécialiste
de l'Autriche, ancien directeur de l'institut français de Vienne,
ainsi que Valérie Zenatti, autrice et traductrice.
- "L'amitié
de Stefan Zweig et Joseph Roth", Alain Finkielkraut, Répliques,
France Culture, 8 février 2014, 52 min, avec Pierre Deshusses traducteur
et écrivain, et Philippe Lançon, écrivain et critique
à Libération.
| SUR et AVEC JOSEPH ROTH |
- Un entretien chez la traductrice Blanche Gidon avec Joseph Roth, par le critique Frédéric Lefèvre, Les Nouvelles Littéraires, 2 juin 1934. Tout l'article vaut la lecture. Roth raconte ses débuts :
"J’avais vingt ans à la déclaration de la guerre. Je me suis engagé. Je me suis battu sur le front russe. J’ai été très fier d’être nommé sous-lieutenant. Fait prisonnier, je me suis évadé après trois mois de captivité.
En 1918, la guerre finie, je me suis trouvé désemparé. Plus d’armée, pas de métier. Je suis devenu journaliste. Au Neuer Tag, de Vienne, j’ai fait les "chiens crevés". Pendant deux ans, dans les commissariats de police, j’ai coudoyé des assassins, des communistes.
L’inflation m’a chassé de Vienne, on n’y pouvait plus vivre. Je suis parti pour Berlin où il y avait "quelque chose à gagner". Là, j’ai été l’unique rédacteur d’une petite feuille sur laquelle j’aime mieux ne pas m’appesantir. Quand elle était imprimée, j’allais la vendre dans la rue…"[Et plus tard j'ai] "publié Job en 1931. Le roman eut du succès, j’ai commencé à gagner beaucoup d’argent. Mon éditeur Kiepenheuer me donnait 3 000 marks par mois, ce qui, joint à mes appointements de journaliste, faisait une assez jolie somme. Pourtant je n’en avais jamais assez. Mes goûts de grand seigneur sont ruineux. Et maintenant les hitlériens m’ont fait perdre le plus sûr de mes ressources, ils ont aussi confisqué les 30 000 marks qui restaient chez mon éditeur parce que j’ai écrit un article contre eux. Le national-socialisme m’est odieux comme toute mystique collectiviste, quelle que soit son étiquette. Je suis individualiste.
Je n’ai pas consenti à être adopté par Hitler comme écrivain allemand bien qu’on me l’ait offert.
Je suis autrichien, j’ai une mère juive, je ne puis pardonner aux nationaux-socialistes leur attitude vis-à-vis de l’Autriche, ni les persécutions juives : on ne crache pas sur la tombe de sa mère.
Job a tiré à 30 000, La Marche de Radetzky à 40 000. Hitler interdit mes livres parce que je suis légitimiste. Restaurer les Habsbourg empêcherait définitivement la mainmise du Reich sur l’Autriche."
-
La
traductrice Banche Gidon
évoque Joseph Roth et éclaire La Crypte des capucins,
en une préface ou postface selon les éditions : à
lire ›ici.
Voir
également :
- la préface de Dominique
Fernandez à La Crypte des capucins
- la préface
de Stéphane Pesnel à La
Marche de Radetzky.
Jean-Louis
de Rambures (1930-2006) qui contribua à la diffusion de la
littérature allemande en France chronique pour Le Monde,
où il écrivit pendant 25 ans, les deux romans de Joseph
Roth réédités alors :
- "La
Marche de Radetzky : Joseph Roth et la nostalgie de l’empire",
par Jean-Louis de Rambures, Le Monde, 5 novembre 1982
- L'agonie de l'Autriche dépeinte
par Joseph Roth", Jean-Louis de Rambures, Le Monde, 9
décembre 1983 (sur La Crypte des capucins).
- Soma Morgenstern, journaliste, ami de Joseph Roth,
Stefan Zweig et Alban Berg, fuit le nazisme et se réfugie à
Paris en 1938, où il habite, comme Joseph Roth, à l'Hôtel
de la Poste, 18 rue de Tournon, dans le 6e arrondissement de Paris. Il
fait le récit de son amitié avec Roth dans le livre Fuite
et fin de Joseph Roth, trad. Denis Authier, Liana Levi, 1997.
- Le Cahier
de L'Herne Joseph Roth, 2015 est une mine : voir le sommaire ›ici
et un texte de Roth intitulé "Dans
la crypte des Capucins".
- Voir ›ici la (longue) préface
de Patrick Modiano au livre de Joseph Roth
Automne
à Berlin, trad. de Nicole Casanova, La Quinzaine littéraire/Louis
Vuitton, 2000 ; rééd. Les Belles Lettres, 2021.
| POURQUOI LIRE JOSEPH ROTH ? |
Cette idée vient de l'Est... et de notre lecture il y a quelques mois du Mage du Kremlin qui se réfère à Joseph Roth dans les circonstances suivantes : Baranov, le "mage du Kremlin", de temps en temps écrit un essai sous un pseudonyme :
Le pseudonyme derrière lequel il se cachait à ces occasions, Nicolas Brandeis, ajoutait un élément de confusion ultérieure. Les plus zélés avaient reconnu sous ce nom le personnage mineur d’un roman secondaire de Joseph Roth. Un Tartare, sorte de deus ex machina qui faisait son apparition dans les moments décisifs de la narration pour s’éclipser aussitôt. "Il ne faut aucune vigueur pour conquérir quoi que ce soit, disait-il, tout est pourri et se rend, mais lâcher, savoir laisser aller, c’est cela qui compte." Ainsi, de même que les personnages du roman de Roth s’interrogeaient sur les actions du Tartare dont la formidable indifférence était la garantie de tout succès, les hiérarques du Kremlin, et ceux qui les entouraient, allaient à la chasse du moindre indice susceptible de révéler la pensée de Baranov et, à travers celle-ci, les intentions du Tsar. Une mission d’autant plus désespérée que le mage du Kremlin était convaincu que le plagiat était la base du progrès : raison pour laquelle on ne comprenait jamais jusqu’à quel point il exprimait ses propres idées ou jouait avec celles d’un autre. (Ch. 1, p. 15-16)
Le roman publié en 1929 où apparaît
Nikolas Brandeis s'intitule Gauche
et droite : ce roman politique entrecroise les destins de deux
frères ennemis, Paul et Theodor Bernheim, qui incarnent chacun
une facette de l'Allemagne de Weimar, et celui d'un émigré
russe juif, Nikolas Brandeis.
À ce roman, nous avons préféré, dans le nouveau
groupe La marche
de Radetzky et dans l'ancien - où nous avions déjà
lu ce livre le plus connu de Roth - La Crypte des capucins...
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
||||
| |
||||
|
à
la folie
grand ouvert |
beaucoup
¾ ouvert |
moyennement
à moitié |
un
peu
ouvert ¼ |
pas
du tout
fermé ! |
![]() Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens