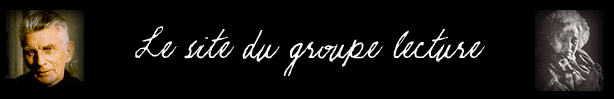
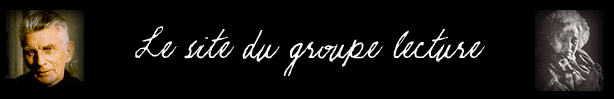 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième de
couverture : Abe Ravelstein est un brillant professeur de l'université
de Chicago et un homme qui se targue d'avoir formé tous les hommes
qui comptent dans le monde politique. Il a vécu sur un grand
pied - largement au-dessus de ses moyens. Son ami Chick, le narrateur,
lui a suggéré d'exposer sa philosophie politique dans
un livre destiné au grand public. À sa propre surprise,
Ravelstein le fait et devient millionnaire. Durant un séjour
à Paris destiné à célébrer ce succès,
Ravelstein suggère à son tour à Chick d'écrire
un livre sur lui et tous deux échangent des pensées sur
la mort, la philosophie et l'histoire, les amours et les amis, et des
anecdotes du passé. L'humeur s'assombrit à leur retour
dans le Midwest et Ravelstein succombe au sida tandis que Chick lui-même
frôle la mort de peu.
|
Saul Bellow (1915-2005)
|
||||||||||||||||||||||||||
|
Large
éventail des 23 cotes d'amour des deux groupes,
des plus vaches aux plus enthousiastes |
|
|
| DES
INFOS AUTOUR DU LIVRE • Les textes de Saul Bellow • Radio et film documentaire • Articles et entretiens • Repères biographiques |
Katell![]() (avis
lu à haute voix comme les suivants)
(avis
lu à haute voix comme les suivants)
Mais qui a pu proposer un tel livre ? Ravelstein : la quintessence
du roman masculin des années 80 ? 90 ? 2000 ? Nombriliste
et vaniteux. Cherchez la femme...
Complètement décousu, sans queue (ha ha !) ni tête,
avec des références auxquelles, si l'on n'est pas juif,
mâle, vieux, américain et universitaire, on ne comprend strictement
rien.
Un livre, qui selon moi, tombera dans les oubliettes du temps (ou sera
vu comme un objet archétypal d'une certaine mentalité patriarcale
de la fin du XXe ou du début du XXIe...)
Fermé.
Claire
Katell a vraiment le sens de la nuance !
Clarisse![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Je ne prends pas la peine d'ouvrir ce livre.
En effet, je n'ai pas réussi à continuer ma lecture au-delà
de la page 130 environ, au moment où le personnage principal revient
de l'hôpital. Je voulais sincèrement continuer ma lecture
mais cela devenait presque douloureux. Les digressions constantes, la
superficialité des personnages, leur étalement de culture,
m'en ont finalement dissuadée. J'imagine que la suite aurait suivi
les mêmes modalités. J'étais curieuse d'explorer davantage
l'amitié entre le narrateur et Ravelstein, mais tant pis.
J'ai été particulièrement choquée par la mauvaise
interprétation du discours d'Aristophane dans le Banquet
de Platon par le narrateur. Platon et Socrate ne soutiennent pas du tout
la théorie des deux moitiés qui sont incomplètes
l'une sans l'autre, bien au contraire, la dialectique platonicienne du
beau et de l'amour est bien plus profonde. Ce livre cite sans cesse des
auteurs, des politiciens et des philosophes sans rien en dire, je ne vois
pas l'intérêt ! Si ces citations futiles sont faites au second
degré, alors je suis passée à côté de
tout le roman.
J'ai hâte de lire les avis positifs, s'il y en a, pour mieux appréhender
ce livre et peut-être un jour retenter ma chance. En attendant,
je lis La
Route de McCarthy, que des membres du groupe ont chaudement recommandé.
Annick L
Je viens de terminer le roman graphique La
route de Manu Larcenet, adapté du roman, vraiment remarquable !
Thomas
J'ai aussi beaucoup apprécié la tétralogie Blast,
ainsi que l'adaptation
graphique que j'avais trouvée très réussie du
Rapport de Brodeck de Claudel.
Fanny![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Voici mon avis, tronqué car je suis aux 2/3 du bouquin.
La sympathie du narrateur pour Ravelstein est manifeste, mais pour ma
part je le trouve assez horripilant, imbu de lui-même et misogyne.
Le style et la forme sont je trouve à l'unisson avec le personnage
: sur la forme un bloc, un monolithe sans espace, qui ne permet pas de
marquer des temps de pause, ni de s'accrocher à des repères
dans la narration. Sur le style, c'est érudit, mais je trouve que
cela frôle parfois le pédantisme.
Il y a des échanges qui pourraient être intéressants
entre les deux protagonistes, mais ils sont noyés dans leurs propres
préoccupations à mon sens nombrilistes.
Malgré tout, je ne sais pas pourquoi mais je persévère.
J'ouvre 1/4 et, comme d'habitude, j'ai hâte de lire vos avis, surtout
ceux qui sont enthousiastes.
(Plus tard, une fois le livre terminé) Je
l'ai lu jusqu'au bout et mon avis reste inchangé. Leurs histoires
et réflexions ne m'ont pas intéressée.
Sabine
entre ![]() et
et
![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Mon (petit ) avis : j'ai lu un ou deux livres de Saul Bellow, et je n'en
garde pas un souvenir précis si ce n'est que je l'avais catalogué
dans "lectures pas faciles".
C'est un peu le sentiment que j'ai aujourd'hui avec Ravelstein
: j'ai été traversée par de forts moments d'énervement,
dus simplement au personnage odieux de ce "vieil homosexuel juif",
débordant de vanité, de suffisance, et de morgue. J'ai même
balancé un soir le livre par terre en me disant : "J'abandonne !".
Pour autant, peut-on lâcher un livre au seul motif que le personnage
est puant ? C'est sans doute parce qu'il m'a rappelé un vieil amant
roumain abject (chut !)...
J'ai cependant apprécié l'art des dialogues et le va-et-vient
entre l'Amérique et la France. J'attends vos avis avec impatience.
J'ouvre un tiers.
Monique
L![]() (en
direct comme les avis qui suivent)
(en
direct comme les avis qui suivent)
C'est une sorte de non-histoire d'un personnage érudit, philosophe,
riche, gay, juif... Pourquoi le narrateur est-il à ce point subjugué
par ce professeur égocentrique dont l'esprit ne saute pas aux yeux
? C'est un vieil intello qui vit entouré d'une cour de fidèles.
Il est rustre, vaniteux, riche, prétentieux, élitiste, iconoclaste,
imprévisible, avec des goûts de luxe, mais fidèle
et généreux pour ses amis.
C'est une discussion à bâtons rompus dans laquelle de nombreux
sujets sont abordés : la Shoah, les Juifs, les grandes institutions
d'enseignement, l'establishment US, Paris, les jeunes, les vieux, le sida,
la mort, etc.
L'écriture fait que l'on ne s'ennuie pas, mais cela part trop dans
tous les sens. C'est empreint de cynisme, ce qui n'est pas déplaisant.
J'ai eu l'impression d'un bavardage sans réelle construction.
J'ai eu du mal à me replonger dans ma lecture après chaque
arrêt, car je n'arrivais pas à y trouver un intérêt.
Ce qui aurait pu m'intéresser, c'est la culture des deux personnages
et leurs discours sur les œuvres qu'ils ont aimées et qui
les ont guidés. Il y a beaucoup de références. J'ai
pu en suivre certaines, assez classiques comme Platon et son Banquet.
Mais je n'ai pas lu Anna
Livia Plurabelle de Joyce et n'ai aucune connaissance de Allan
Bloom. Je passe donc à côté d'un certain nombre
de références et n'ai pas cherché à les étudier.
Malgré les dires de la 4e de couverture, je n'ai pas vu d'humour.
Il s'agit peut-être d'une caricature amusante pour les lecteurs
qui connaîtraient les célébrités représentées,
mais là aussi j'avoue mon ignorance, ainsi que ma méconnaissance
de l'idéologie néoconservatrice.
J'ai préféré le personnage de Chick parce qu'il prend
un peu de distance.
Le fil rouge de l'histoire est sans doute la mort, la lente et inéluctable
dégénérescence vers la fin.
J'ouvre au ¼.
Jacqueline![]()
Ouf ! un roman ! Du texte !
Au début, pas facile d'y rentrer ! Alors, je suis loin d'avoir
fini, je n'ai pas eu le temps ! J'avais d'autres préoccupations
et puis l'humour n'est pas le même pour tout le monde, c'est une
question de culture comme la BD ou le roman graphique…
Et là ça me dépassait un peu : Lloyd Georges qui
c'est ? (Pour Keynes, heureusement pour moi, Voix au chapitre
a consacré un
été à Bloomsbury !) Nietzsche, Plutarque, on
m'en a parlé mais je n'ai jamais lu ! L'histoire mondiale et Michael
Jackson, faudrait que j'arrive à m'y intéresser ! May West,
une actrice, mais dans quels vieux films ? Je n'en ai vu aucun…
Tout ça caractérise bien le personnage, mais ça me
fatigue !
Tiens ! le poulet en croûte de sel, là je me représente
très bien, mais au Crillon ? Ce n'est pas exactement comme ça
que je m'imaginais le Crillon ! Pour retrouver une recette antique ? J'ai
des doutes…, c'est bizarrement incongru.
Ensuite j'ai adoré le récit de la rupture du narrateur avec
sa première femme et les interventions de Ravenstein. J'ai commencé
à m'amuser…
Je n'en suis qu'au premier tiers et voilà le récit cocasse
d'une vie de panache au-dessus de ses moyens, qu'ils soient physiques
ou financiers. J'y trouve ce dérisoire qui fait le sel de toute
vie.
Je n'ai pas terminé mais j'ai envie de le faire ! Est-ce que la
suite va m'amuser ?
J'ai emprunté des nouvelles, Mémoires
de Mosby : ça n'a plus du tout l'air de se passer dans
le monde universitaire et il y a des personnages très différents
; je suis curieuse !
Comment ouvrir celui-là ? Difficile de me prononcer puisque je
n'ai pas terminé et que la suite me réserve sans doute des
surprises…
À moitié ? Pour n'avoir pas apprécié un quart
du quart puis aimé le quart suivant. Finalement aux trois quarts
pour la création littéraire !
Ce serait intéressant aussi de comparer la forme du dialogue dans
ce livre avec Hemingway à peu près contemporain... J'aimerais
pouvoir approfondir tout comme sur la notion de "Juif américain".
Faudrait du temps...
Thomas![]()
Mon avis est mitigé, mais en entendant tant d'avis négatifs,
j'ai envie de défendre le livre. C'est en effet une lecture à
laquelle j'avais toujours envie d'y revenir. Certes, à la fin,
c'était surtout parce que je me réjouissais d'en arriver
au bout et de bientôt pouvoir passer à autre chose... Mais
avant cela, il y a eu un réel plaisir de lecture. Cette découverte
du personnage, par petites touches, où on papillonne, où
on voit le personnage par plein de côtés différents,
je l'ai trouvée très agréable. Et le personnage de
Ravelstein en lui-même, avec tous les défauts qu'il peut
avoir, m'a vraiment plu ! J'aime sa truculence, son rejet moqueur
des conventions sociales (notamment cette scène où il boit
à la canette - ou à la bouteille ? - lors de ce dîner
mondain un peu guindé). On a envie de le voir, ce Ravelstein, dans
la vraie vie (peut-être pas d'avoir affaire à lui, ceci dit,
mais au moins de pouvoir l'observer !). C'est un "personnage"
comme on dit !
Puis, c'est vrai, on s'essouffle, le narrateur finit par se répéter
et nous par nous ennuyer. Il y a notamment ces retours à l'histoire
des deux moitiés de Platon, que j'ai trouvée fort bien raconté
au demeurant, mais qui perd de son intérêt au fur et à
mesure. Et, plus on avance, plus le récit s'éloigne de Ravelstein
pour se rapprocher du narrateur. Or, je n'ai pas trouvé beaucoup
d'intérêt, ni au récit du naufrage de son mariage
avec Vela, ni à celui de son empoisonnement. J'étais frustré
qu'après cette esquisse très réussie de Ravelstein,
on n'aille pas plus loin, qu'on reste assez en surface, finalement. J'ai
eu un court espoir au moment où le sida est mentionné, j'ai
pensé au film Philadelphia,
je me suis dit qu'on aurait peut-être quelque chose d'intéressant
sur la façon dont cette maladie était considérée
à cette époque-là, mais finalement le sujet est à
peine effleuré.
Par ailleurs, j'ai parfois été gêné par cette
difficulté à savoir ce qui relève de la réalité
ou de la fiction. On sent que c'est très autobiographique, les
articles
en font état, mais parfois je me demandais comment je devais l'appréhender
: comme un roman inspiré de personnages réels, mais où
l'auteur a pris des libertés et forcé le trait, ou comme
un réel récit de vie où le seul artifice serait d'anonymiser
(relativement) les personnages ? C'est peut-être la limite de ces
biographies romancées.
Malgré tout, la lecture était agréable, j'ouvre donc
à moitié.
Jérémy entre![]() et
et![]()
Avant la lecture : J'avais
déjà lu du Bellow il y a longtemps, Herzog, que je
n'avais pas terminé. Je n'avais pas été rebuté,
mais pas suffisamment intéressé non plus pour aller jusqu'au
bout ; j'étais mitigé. Le livre m'avait fait penser
à du Philip Roth, dans le style humour juif new-yorkais des années
40-50 et je crois que j'y reste un peu extérieur. J'étais
malgré tout content de retrouver Bellow et de lui donner "une
seconde chance".
Après la lecture : Ce n'est certes pas un grand livre, il
ne me ne me marquera pas profondément et je ne le relirai pas ;
mais je ne pense pas qu'il faille l'aborder comme tel. Ce livre, c'est
comme des bulles de champagne, pétillant et léger. Pas profond,
mais cela donne du plaisir.
La structure n'est pas facile à suivre, avec toutes ces digressions,
ces flash-back, ces récits enchâssés. Lors de la révélation
du VIH de Ravelstein, j'ai eu du mal à cerner la chronologie et
à bien comprendre comment tout cela s'emboîtait entre Paris
et les USA : cela ne me semblait pas très vraisemblable. Mais je
crois que c'est un livre qu'il faut lire en acceptant de se laisser aller,
de se laisser glisser. Malgré ses redondances et ses répétitions,
je l'ai toujours repris avec plaisir, car il y a pas mal de pépites,
de fulgurances, d'aphorismes qui aident à vivre ou font réfléchir,
et c'est aussi ce que je recherche et ce que j'aime dans un livre :
"Celui qui veut gouverner
le pays doit d'abord le divertir" (p. 11)
: on pense à Trump, et à Reagan avant lui !
À la fin d'une soirée : ''Nous
étions arrivés à l'estuaire de la fête et faisions
de nouveau face au golfe du régime ordinaire'' (p. 39),
c'est joli.
Un peu plus loin : "De
longues années durant, il avait été un touriste,
un honnête adorateur de la civilisation française - mais
à l'ombre d'un nuage budgétaire -, rêvant de rouler
carrosse, mais sans le sou".
"L'âme de l'autre
est une sombre forêt, comme disent les Russes."
(p. 125)
"Quatre-vingt-dix pour
cent de l'innocence moderne n'est guère plus que de l'indifférence
au vice, une résolution à ne pas se laisser affecter par
ce qu'on pourrait lire, entendre ou voir." (p. 158)
"Tous les gens instruits
font la même erreur - ils croient que la nature et la solitude sont
bons pour eux. La nature et la solitude sont un poison, dit Ravelstein."
(p. 210)
J'ai aussi aimé les références à la France
et aux Français, qui donnent bien sûr dans le cliché
mais qui revêtent, comme tous les poncifs, leur part de vérité,
et puis il ne faut pas se prendre trop au sérieux :
"Ce à quoi ils
restaient bons étaient les arts de l'intimité. Le manger
continuait de bien coter (…). Et, aussi, les grands étalages
de lingerie. L'amour éhonté des parures de lit. 'Viens,
viens dans mes bras, je te donne du chocolat'"
(p. 51). C'est très drôle !
"Les Français
étaient authentiquement cultivés - ou l'avaient été
autrefois."(p. 69)
Oui, il y a beaucoup de références, mais cela ne m'a pas
semblé envahissant. En tout cas, je ne me suis pas senti submergé
et le fait de ne pas toutes les avoir n'a pas entravé ma lecture.
Elles ne m'ont pas semblé gratuites et relever de l'étalage
et de la pédanterie. Je ne peux pas reprocher à un narrateur
d'être plus érudit et cultivé que moi et je prends
plutôt les références que je n'ai pas comme autant
de chances et de cadeaux. J'avais pensé la même chose sur
ce point de L'écriture
et la vie.
J'ai bien aimé le personnage de Ravelstein, truculent, une sorte
de DSK ou de Depardieu, dans le sens du bagout, de la faconde, de l'envergure,
fort en gueule, qui prend de la place, qui bouffe la vie et la brûle
par les deux bouts, qui n'est pas dans la demi-mesure, "hors cadre"
en quelque sorte. Je l'ai trouvé attachant, il s'intéresse
profondément aux gens qui l'entourent, à ses amis, à
leur vie, à leurs affects, et j'ai trouvé drôle son
côté marieur, entremetteur, ainsi que le décalage
entre la haute culture qui l'anime et son côté très
matérialiste. Ce n'est pas un pur esprit éthéré.
Je n'ai pas trouvé le livre misogyne. Oui le personnage de Vela
peut faire office de repoussoir. Pour simplifier, on pourrait dire que
c'est une garce. Et alors ? Cela n'est-il pas possible dans la vraie vie
? Les femmes sont-elles toutes des anges ? Ne doivent-elles tenir que
des beaux rôles ? Est-ce que le fait de dépeindre un personnage
féminin peu aimable suffit à taxer un livre de misogyne
? Je trouve que c'est un raccourci et une facilité. Que l'on n'aime
pas l'image que renvoie des femmes un personnage en particulier est une
chose, mais que l'on tire d'un fait particulier une telle accusation générale
est autre chose. Et puis les romans ne sont pas là pour nous renvoyer
l'image aimable de nous que nous souhaiterions voir et nous complaire,
encore moins pour servir des causes. Dirait-on de Lolita
qu'il est un livre misandre ? Non, c'est un livre qui raconte l'histoire
d'un prédateur sexuel pédophile, c'est tout. Je trouvais
autrement plus dérangeantes les assertions essentialisantes de
Hardy dans Loin de la foule déchaînée
du type "Les femmes
sont comme ceci ou comme cela" ou "La
réaction de Bethsabée était bien typiquement féminine."
Enfin, j'ai bien aimé l'humour de certains passages, comme lorsque
l'un des personnages se meurt et que les derniers mots qu'il prononce
sont : "Restons calmes
!" ou lorsque Ravelstein demande, à propos des
perroquets qui font un vacarme infernal si l'hiver ne les a pas "flingués".
J'ouvre entre ½ et ¾.
Thomas
Et celle-ci... : "J'aime
à dire, quand on m'interroge sur Finnegans Wake, que je
me le garde pour la maison de retraite."
Catherine![]()
N'ayant jamais lu de livre de Saul Bellow, j'étais contente de
ce choix et plutôt impatiente de lire le livre. Mais je suis carrément
passée à côté et mes deux impressions principales
ont été la déception, puis l'ennui.
J'ai assez aimé les toutes premières pages et le nigaudus
americanus, mais je n'ai pas réussi à m'intéresser
au héros principal, Ravelstein. C'est un universitaire devenu richissime
après avoir écrit un seul livre, qui vit aux USA et à
Paris dans une suite au Crillon, achète frénétiquement
des produits de grand luxe, a une couverture en vison sur son lit, etc.
C'est un trublion iconoclaste, plutôt rustre. Il se moque de toutes
les conventions, affiche son homosexualité à une époque
où ça n'était pas si facile, il assume totalement
ce qu'il est. Tout ça est plutôt positif, mais ça
n'a pas suffi à éveiller mon intérêt. Il est
présenté comme un grand esprit, il conseille les grands
de ce monde, mais je ne trouve pas que son génie soit si apparent
que ça dans le livre…
Je le trouvais peu crédible jusqu'à ce que je découvre
qu'il est très fortement inspiré d'un personnage tout à
fait réel, Allan Bloom, que je ne connaissais pas, honte à
moi. Il y a d'ailleurs, tout au long du livre, de nombreux noms qui sont
cités, que le lecteur est sans doute censé connaître,
mais ce n'était pas mon cas. C'est assez centré sur le monde
universitaire américain : j'ai cherché systématiquement
au début, puis je me suis lassée et ça ne m'intéresse
pas beaucoup. Il y a aussi de nombreuses références littéraires,
un peu trop nombreuses peut-être. Je n'ai pas réussi à
m'intéresser davantage au narrateur, aux quelques personnages féminins,
plutôt secondaires. Au passage, entre Vela et Rosamund, les femmes
ne sont pas très gâtées, même si Vela est une
femme brillante. Elles m'ont paru très caricaturales.
Une grande partie du livre consiste en des entretiens à bâtons
rompus, sans véritable fil conducteur (en tout cas, je ne l'ai
pas vraiment identifié), il y a des redites et des retours en arrière
incessants. Par-ci, par-là, il y a des phrases ou des idées
intéressantes, Bellow a un vrai sens de la formule, mais noyées
dans un foule de détails du quotidien inintéressants. De
nombreux thèmes - la maladie, la mort, l'amitié, la Shoah,
les Juifs - sont évoqués, mais plutôt effleurés
qu'autre chose. Quant au dernier quart du livre, centré sur la
maladie, puis la guérison de Chick, amoureusement veillé
par sa 3e femme qui doit avoir 40 ans de moins que lui, j'ai trouvé
ça carrément assommant.
J'ai dû vraiment passer à côté de quelque chose,
même l'humour m'a échappé, à part quelques
exceptions. J'ai lu, après avoir fini le livre, une partie des
critiques,
presque toutes élogieuses ; je me dis que j'aurais dû
aimer, mais ça n'a pas vraiment été le cas. Je suis
intéressée par les avis positifs du groupe, il y en aura
sûrement et comme a dit un des critiques du Masque et la Plume récemment,
après avoir descendu en flammes un bouquin, c'est celui qui aime
qui a raison.
Du coup, Bellow étant quand même un prix Nobel de littérature,
pour ne pas en rester là, j'ai commencé Herzog,
considéré comme un de ses chefs-d'œuvre. Je l'ai trouvé
mieux, son héros m'a davantage intéressée, un universitaire
névrosé largué par sa femme, qui écrit des
lettres à la terre entière, ça me plaît davantage,
il y a beaucoup d'humour, ça m'a fait penser à Woody Allen
mais je n'en ai lu qu'un un tiers pour l'instant et je sens que ça
va me paraître long.
Pour Ravelstein, j'ouvre un quart. Mais c'est toujours intéressant
malgré tout de découvrir un auteur.
Claire
entre![]() et
et![]()
Mon avis a oscillé en quatre phases, accompagnées de la
discipline constante de ne pas aller aux renseignements sur le livre et
l'auteur avant d'avoir fermé la dernière page, car j'avais
très envie d'en savoir plus sur le contexte du livre et l'auteur
qui écrivait ça, dont je n'avais jamais lu une ligne :
- d'abord l'étonnement, la curiosité, la surprise forte
: mais de quoi s'agit-il ?!
- puis la lassitude, l'énervement : il va pas me tenir avec cette
logorrhée jusqu'au bout sans intrigue juste autour de ce mec !
- il se passe des choses, un peu, et sans m'en rendre compte, me voilà
complètement embobinée, à un moment je me dis pas
question de le lâcher alors qu'on ne parle toujours que de ce mec
- une fois aux Antilles et qu'on a le droit au menu des vacances j'ai
lâché. Je suis entre ½ et ¾.
Au début, j'ai trouvé ça brillant, original, crépitant.
J'ai même aimé la première note du traducteur à
la première page et ai d'ailleurs apprécié la traduction
en remarquant des expressions qui faisaient tilt : chercher des crosses,
potasser, être en bisbille…
Le début m'a semblé très actuel, très anti
Trump, avec le créationnisme, le nigaudus americanus. Et
romanesque m'a paru ce personnage dont "l'intellect
avait fait de lui un millionnaire", ça change du
foot ou du CAC 40. J'ai apprécié le naturel pour parler
de l'homosexualité et j'ai beaucoup aimé la silhouette de
Nikki, jamais au premier plan, mais dans une relation visiblement très
forte avec Ravelstein : "Il
avait, qui plus est, le courage d’affirmer son droit à être
exactement ce qu’il semblait être". Je ne partage
pas l'impression de misogynie et j'ai bien aimé comment vont et
viennent les deux figures de femmes, oui ! Et bien souri quand Ravelstein,
qui pourtant adore Rousseau, mais se fout de la campagne ("Il
mangeait la salade, mais ne voyait pas l’intérêt de
méditer dessus"), rend visite au narrateur pour
lui démontrer qu'il s'est "enterré
au fond des bois" à tort et "fourré"
dans cette situation à cause de sa femme.
C'est l'humour que j'ai apprécié, la distance permanente,
l'esprit et les formules qui font mouche : "Bien
que d’une formation supérieure — un
doctorat, trop fine pour se faire rouler —, elle aimait son mari",
"À Paris, même
les embarras étaient haut de gamme."
Le fil conducteur dont l'absence a été regrettée
est pour moi celui-ci : le narrateur est chargé de faire une biographie
et le livre est l'histoire de ce projet, de cette tentative, de cette
biographie en train
de se faire, plutôt un portrait
d'ailleurs, par quel bout prendre le modèle, il lui tourne autour,
on a même
le modèle admiré de biographie qui est évoqué
(j'aimerais bien la lire) et, en cours de route, le sujet de la biographie
crève et le livre se finit par l'histoire du narrateur... Je vois
donc le livre comme une audace littéraire, expérimental,
le roman d'une biographie impossible à faire - un portrait car
on n'a pas l'histoire du personnage ou juste sa fin.
J'ai lu un autre livre, un court roman, Une
affinité véritable, mais que j'ai trouvé
moins extraordinaire.
Voici le
fameux livre qui a rendu Ravelstein-Bloom millionnaire -
je ne l'ai que feuilleté - mais le long avant-propos
de Saul Bellow est marrant : il commence ainsi "Le
professeur Bloom est tout le contraire d'un conformiste"
et on s'attend à une présentation de l'auteur ; or Bellow
raconte ensuite sa propre histoire, ce que j'ai trouvé rigolo comme
avant-propos, en pendant à notre roman.
Ce qui est impressionnant quand le livre paraît, c'est la pléthore
d'articles en France, avant même d'ailleurs que le livre soit
traduit. Et le fait qu'aujourd'hui Bellow ne semble guère lu, à
part par nous... Par contre deux livres d'Allan Bloom viennent d'être
réédités ›ici
dont le fameux essai et son livre sur L'Amour
et l'Amitié dédié au vrai Nikki. Ravelstein-Bloom
reste d'actualité...
Annick L![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
J'ai trouvé ce livre sans intérêt !
C'est écrit à la va comme j'te pousse, plein de répétitions,
de retours en arrière, comme si le narrateur ressassait.
L'évocation de ce petit monde d'intellectuels juifs fonctionne
comme un entre-soi, plein de références qui m'échappent.
Quel pédantisme ! Ravelstein est certes un personnage extra-ordinaire,
truculent, non conformiste, et un grand penseur qui a marqué des
générations entières. Mais tout cela est très
daté et m'a profondément ennuyée.
Les romans de Philip Roth sont autrement denses. Et, si l'on cherche une
critique du monde universitaire, on peut lire la formidable trilogie du
britannique David
Lodge, pleine d'humour.
En plus le ton général est assez cynique, et très
misogyne : la première épouse évoquée
a certes de l'étoffe (grande scientifique...), mais elle est décrite
comme un monstre, quant à la dernière, cette jeune femme
adoratrice de son mari…
Cela fait longtemps que je n'avais pas lu - en entier - un livre qui m'énerve
autant.
Mais l'on peut reconnaître, vu la diversité des points de
vue, que c'est bien "un livre pour le groupe lecture".
Fermé.
Brigitte
entre![]() et
et![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
Saul Bellow a reçu le Prix Nobel de littérature, ce qu'il
écrit vaut donc la peine d'être lu : voilà quel était
mon état d'esprit quand j'ai entamé ce livre.
Le début a été très laborieux : ce personnage
prétentieux qui portait une veste hors de prix, qu'il n'hésitait
pas à tacher en renversant sa tasse de café, ne m'intéressait
pas. J'ai, néanmoins, persisté dans ma lecture, parce qu'il
s'agissait d'un Prix Nobel !
Mon intérêt s'est enfin éveillé à partir
du moment où Ravelstein commence à être malade. Je
parvenais à m'y retrouver au milieu des personnages et à
comprendre de quoi il s'agissait. Au fur et à mesure, j'entrais
dans cette lecture, qui présente la vie d'un groupe d'intellectuels
américains de milieu aisé rattrapés par le SIDA.
Ravelstein meurt plus jeune que ses vieux parents, que ses amis. Leurs
réflexions philosophiques sur le sens de la vie et de la mort deviennent
pour eux un sujet de préoccupation actuel et urgent.
L'écriture sans fioritures est parfois superbe. J'ai vraiment aimé
tout le passage où Chick, le narrateur, raconte sa très
grave maladie lors d'un voyage à Saint-Martin.
J'ouvre entre la moitié et ¾.
Renée![]() (avis
transmis après la séance)
(avis
transmis après la séance)
Chick, le narrateur, raconte son amitié avec Ravelstein, brillant
professeur d'université devenu millionnaire grâce à
un livre de philosophie politique que l'a poussé à écrire
Chick.
Il y a une trentaine d'années j'avais lu Au
jour le jour, puis plus récemment Les
aventures d'Augie March : mon souvenir, c'était que Bellow
est un très grand écrivain.
J'ai adoré Ravelstein car ce livre me donne l'impression
que je suis intelligente. Cependant, Chick le narrateur me rappelle que
je ne suis, comme lui, intelligente "qu'à
l'occasion, par accès". En effet, grâce à
Ravelstein, l'intelligence et la culture irriguent ce livre. C'est un
esthète et un philosophe. Il est généreux avec ses
amis et même avec les antisémites qui ont du talent : il
est contre la mise à l'index juif (il refuse de renoncer à
Céline).
Pourtant il est obsédé par ce qu'il appelle "le grand
mal" : "presque
tous étaient d’accord que les Juifs n’avaient pas le
droit de vivre". Cependant il faut rester témoin,
conserver la mémoire, transmettre, donc se revendiquer juif.
Ravelstein dénonce "des
élitistes déguisés en égalitaires" :
on en connaît un paquet !
"Je n’aurais jamais
imaginé que la mort soit un aussi étrange aphrodisiaque"
: c'est connu que dans les sanatoriums le sexe occupait la première
place....
"Frayez avec les personnes
les plus nobles que vous puissiez trouver ; lisez les meilleurs livres
(...) ; mais apprenez à être heureux seul."
Bellow regrette qu'aux USA la philosophie soit méprisée
au profit de la technologie, au contraire de Paris. Ravelstein
aime s'entourer de belles choses, comme Jean Des Esseintes, le héros
de À
rebours de Huysmans, et j'adore ce genre de personnages.
Niki explose : "Tu as
payé dix mille dollars pour tous ces trous et ces effilochures
— parce que les trous sont la preuve que c’est une véritable
antiquité ? Qu’est-ce qu’il t’a raconté,
que c’était le tapis dans lequel ils avaient emballé
Cléopâtre toute nue ?"
Il aime la musique sur des instruments originaux du 17e sauf que l'Italienne
à Alger de Rossini a été écrit au début
du 19e : donc c'est une hérésie de la jouer sur des instruments
anciens, je n'y crois pas... Mais aux USA tout est possible.
Juste un peu long le rêve de Chick à la fin. Mais avec une
dernière phrase magnifique : "On
n'abandonne pas facilement un être tel que Ravelstein à la
mort ".
J'ouvre ce livre en entier.
Rozenn![]() (avis
transmis avant de découvrir nos avis)
(avis
transmis avant de découvrir nos avis)
Je regrette d'autant plus de ne pas être des vôtres que j'ai
eu un immense plaisir à lire ce livre.
D'accord il faut accepter le principe d'un discours sur un autre
Et quel autre…
Aucun des deux personnages n'est follement sympathique et les personnages
secondaires sont falots, mais à part les longueurs quand le narrateur
ne parvient pas à écrire et tombe malade, je me suis régalée
tout du long.
J'ai adoré cet humour.
J'ai commencé deux autres livres du même auteur : Les
aventures de Augie March et
le Don de Humboldt et je m'ennuie !
J'ai hâte de lire vos avis !
Martin Amis![]()
Ravelstein constitue à mon sens un chef-d'œuvre
inégalé. Jamais auparavant le monde n'a entendu pareille
prose : une prose d'une beauté frémissante et cristallisée.
Françoise![]() (après
la séance)
(après
la séance)
Je suis dans la catégorie "fermés", la catégorie
"m'est tombé des mains"...
|
Les
cotes d'amour du groupe breton réuni le 30 mai |
Les Bretons aiment commencer par le pire (l'avis le plus vache) pour
finir en apothéose...
Marie-Odile![]()
De ce roman je n'ai aimé ni le contenu, ni le style, ni la composition.
Les personnages ne m'ont pas intéressée. J'ai remarqué
la grande quantité de noms propres et à chaque fois j'ai
eu l'impression d'entendre parler de gens que je ne connaissais pas et
dont le sort me laissait totalement indifférente.
Il est très souvent question de fric et de fringues, sujets peu
attractifs pour moi, du moins lorsqu'ils sont présentés
sans originalité. Je n'ai rien perçu du génie de
Ravelstein, ni de son prétendu sens du comique. Impossible de me
faire une idée claire de son fameux livre. Je n'ai pas aimé
ses affirmations gratuites sur les scientifiques chez qui il n'y aurait
pas d'âme supérieure (second degré ?), ni sa
façon de s'occuper du couple du narrateur (de quoi il s'occupe ?).
Je n'ai pas aimé le ton monocorde, l'humour que je trouve stupide,
un vocabulaire qui se veut peut-être drôle ? : "elle
a une paire d'amortisseurs", "barjo",
"hénaurme",
des phrases que personne n'oserait écrire : "ses
pieds étaient posés l'un à côté de l'autre"
(portrait de Battle).
J'ai parfois eu l'impression d'une suite de phrases sans lien les unes
avec les autres. Je me suis demandé en vain ce qui régissait
la construction d'ensemble et où voulait en venir l'auteur.
Bref, j'ai eu l'impression de n'apprendre rien sur rien et de m'ennuyer
auprès de personnages qui ne suscitaient en moi aucune émotion.
J'ai abdiqué à la page 194 pour me tourner vers Paul Auster
qui venait de mourir et j'ai trouvé chez lui ce qu'il n'y avait
pas chez Saul.
Je laisse fermé.
Jean![]()
Ô Nombril, mon beau nombril !…, tel pourrait être le
titre de cet ouvrage qui égrène les clichés de philo
empruntés à de mauvais manuels et passe du coq-à-l'âne
: de la Shoah, aux institutions d'enseignement et l'establishment américain,
Paris, jeunes, vieux, sida, etc. tout y passe !
Alors pourquoi s'intéresser à ce dandy excentrique, professeur
américain devenu riche écrivain qui passe son temps à
errer dans les capitales européennes, à disserter sur Périclès
et les tailleurs chics ?... Bon, on ne lit pas que des livres dont on
aime les héros, même si Saul Bellow a reçu le Nobel
de littérature en 1976 pour Herzog, je n'ai pas eu beaucoup
de plaisir à parcourir cet ouvrage !
L'histoire : Abe Ravenstein est un professeur de philosophie de l'Université
de Chicago qui demande à son ami d'écrire sa vie pour lui
rendre hommage après sa mort. Cet ami, Chick, est en fait un double
de Saul Bellow. Abe Ravenstein fera fortune grâce à sa vulgarisation
de la philosophie politique, tout en menant une vie flamboyante à
Chicago ou dans les hôtels de luxe parisiens. En fait c'est la vie
d'un gros riche, prétentieux, élitiste, avec des goûts
de luxe, qui a existé : celle d'Allan Bloom, philosophe homosexuel
américain.
C'est un roman qui parle de croyances, d'influences, de politique et d'une
Amérique nombriliste, raciste, souveraine, celle d'un vieil intello
entouré de fans dont l'intelligence se mesure à l'aune de
l'admiration qu'ils lui manifestent, et qui s'intronise lui-même
comme "professeur en coaching conjugal", en spécifiant
à ses étudiants quel couple il devait former... : une vie…
par procuration ?
Une histoire drôle... ? On peut voir dans ce dandy aristocrate,
exigeant et cruel, généreux et drôle, un portrait
sur la vieillesse, qui parfois, parfois amuse… Mais si l'éditeur
promet qu'il sera "férocement drôle", je n'ai pas
vraiment ris ni même souri, agacé plus qu'amusé par
cette caricature. Si j'ai ri… c'est "jaune" ! Ceci dit,
pour apprécier, et s'amuser, il faut peut-être une connaissance
du monde des célébrités que je n'ai pas.
On peut aimer... :
- la description sans concessions de ce professeur vaniteux qui ne s'achète
que des vêtements de marque, mais qui les ruine rapidement par sa
négligence et par des éclaboussures maladroites
- le côté fidèle et généreux de sa relation
avec Chick, et leurs grandes discussions sur la vie et sur la mort
- la documentation historique sur la façon dont une pensée
philosophie politique distinguée de haut niveau s'est propagée
dans les cercles snob et les leaders d'opinion
- les références aux philosophes antiques, aux romanciers
français du 19e siècle, et la liberté que l'auteur
s'accorde avec la chronologie des faits historiques.
On peut ne pas aimer :
- l'absence d'intrigue, l'arrogance caricaturale des personnages, un catalogue
"humaniste" plutôt qu'un roman
- l'absence de fil conducteur dans la suite des paragraphes... sinon la
mort ! Une dégénérescence vers la fin inéluctable,
la perte de soi, la fin de l'humanité, la dépossession,
la disparition de l'humain…
- des propos lourds qui font que l'humour de Bellow rate sa cible
- l'abondance des propos qui finit par tuer le roman et... le lecteur
: plongé cette logorrhée sans maîtrise, il n'est plus
à même d'apprécier les saillies vitriolées
de l'auteur.
En résumé : "Il
n'est pas facile d'abandonner une créature telle que Ravelstein
à la mort" : c'est ainsi que se termine le roman
de Saul Bellow. On peut y voir une sorte de chronique des derniers instants
d'un personnage, érudit, philosophe, riche, gay, juif. Roman plutôt
sombre…S'il y avait de l'humour, ce n'est pas "férocement
drôle". Bref, pour moi, une lecture assez décevante...
une "non-histoire" !
Marie-Thé![]()
J'ouvre au ¼ ce livre que j'ai tenu à lire (péniblement)
jusqu'au bout : je pensais que je finirais par y trouver un quelconque
intérêt, j'attendais... Rien de cela, et impression de réellement
perdre mon temps. Pourquoi, pour qui, toutes ces pages ? Je suis restée
en dehors de cette histoire, me suis régulièrement demandé
qui avait bien pu la proposer.
Parler de mon chemin dans le livre m'est cependant nécessaire.
Tout d'abord je dirai que sur la forme je n'ai vraiment pas été
séduite, et si j'avais aimé l'écriture mon regard
sur le livre aurait pu être différent.
Ravelstein est un personnage que je n'aime pas, son parcours sinueux,
cet étalage inouï de luxe, de mondanités (avec Madame
Glyph on se croirait chez les Verdurin). Je retiens cependant le dîner
incroyable, donné en remerciement à Chick pour son soutien,
une "célébration"... J'ai aimé les références
à Platon, au Banquet", avec l'évocation du
mythe d'Aristophane. Je retrouve là un peu de l'esprit du livre.
Ravelstein m'est antipathique, je note encore le mépris pour la
société en général, de celui qui "n'avait
que faire de la gentillesse", même si je suis sensible
à ces paroles : "Aucune
véritable éducation n'était possible dans les universités
américaines, sinon pour les ingénieurs en aéronautique,
les informaticiens et autres." ou "La
philosophie était morte." Par ailleurs, la haine
de sa famille conduit Ravelstein à "détourner
ses étudiants doués de leur propre famille."
Ses élèves, son enseignement, la politique de l'Antiquité
à aujourd'hui, son train de vie, ses fréquentations, son
assurance, etc. : je sature. Si j'ajoute toutes ces énumérations
de politiques ou d'intellectuels dont (à part Max Weber) je n'ai
jamais entendu parler, la coupe est pleine !
Au début j'aurais dû me méfier d'un Ravelstein très
critique : "Les intellectuels
de Bloomsbury (...) cirque pédé (...) ce n'étaient
pas des penseurs, mais des snobs."..., me méfier
de ses propos sur l'économiste Meynard Keynes (du groupe Bloomsbury
aussi) : ce dernier "avait
exagéré la dureté des Alliés et fait le jeu
des généraux allemands et, par-delà, des nazis."
D'ailleurs Ravelstein n'est pas avare de reproches. Ainsi "Les
médecins étaient les alliés de la bourgeoisie hantée
par la mort." Plus grave à mes yeux, la nature
pour Ravelstein : "une
perte de temps pour un homme supérieur" (!)
Des propos misogynes émergent ici et là genre : "Les
femmes qui portaient des vêtements de marque et du rouge à
lèvres flamboyant n'avaient généralement pas d'opinions
politiques." Interminable passage sur les déboires
de Vela, opportuniste et malhonnête. Ce qu'en dit Ravelstein peut
paraître juste : "elle
n'était pas prête à être vue."
Je note encore dans ces pages racisme, antisémitisme, peu de cas
de Ravelstein pour "les
perdants habituels".
J'ai plutôt aimé me retrouver chez Ulysse de Joyce,
avec Léopold et Molly Bloom, sans vraiment comprendre pourquoi
l'auteur nous emmenait là, idem pour Ivan Ilitch avec la métaphore
de la pierre, lente ascension et descente accélérée
: le temps de la vieillesse file à toute allure... "Notre
précipitation élimine les détails qui enchantent,
retiennent ou retardent les enfants. L'art est un moyen d'échapper
à cette accélération chaotique. Le mètre en
poésie, le tempo en musique, la forme et la couleur en peinture"...
: j'adore ce passage.
Pour revenir à l'antisémitisme, Le
Protocole des Sages de Sion me fait penser aux fausses informations
qui circulent aujourd'hui. Lorsque Chick, alias le narrateur, évoque
ses rencontres avec Grielescu, roumain au passé lourd, violent
avec les Juifs, "en
rapport étroit avec C. G. Jung, qui se voyait lui-même comme
une sorte de Christ aryen", malaise... Je n'ai pas apprécié
de retrouver les pamphlets antisémites de Céline. J'en ai
finalement eu assez d'aller d'un écrivain à l'autre, Kipling
contre Einstein, etc. Incroyable, j'ai cru me retrouver chez Saer avec
L'ancêtre,
du "copier-coller", ça n'en finit pas.
Et puis, le meilleur pour la fin, la dengue de Chick à Saint Martin
aux Antilles a failli me rendre dingue : ces lamentations à n'en
plus finir, quel intérêt ?
De ces divagations je retiens quelques paroles : "Je
suis de ceux qui croient en la capacité des travaux inachevés
à vous maintenir en vie." Et : "Rosamund
me retenait de mourir."
"Vous pourriez réellement
composer un excellent portrait (...) Je vous en charge comme d'une obligation"
Enfin ! Espoir ! Mémoire en vue pour Chick : "On
n'abandonne pas facilement un être tel que Ravelstein à la
mort." Le roman de Saul Bellow serait "un
hymne à l'amitié et à la vie", je
n'ai pas cet avis.
Je terminerai par deux questions qui se posent à moi : j'aime Proust
dont les personnages me sont souvent insupportables, et je n'aime guère
ici Saul Bellow en grande partie à cause de ses personnages qui
me sont justement insupportables...
Ce livre dont la lecture m'a été pénible a fait son
chemin en moi et m'est devenu plutôt intéressant, du coup
je revois mon avis et l'ouvre à moitié.
Suzanne![]()
J'avais jadis lu Herzog
qui m'avait beaucoup plu. J'avais donc un a priori favorable.
Ravelstein charge Chuck son ami, son aîné, de faire sa biographie.
En fait, ce roman nous offre une double biographie, celle de Ravelstein
et celle de Chick qui l'accompagne jusqu'à la mort. C'est une histoire
d'amitié.
C'est le portrait d'un personnage excentrique, ce professeur apprécié
de ses étudiants, élitiste, qui s'intéresse seulement
aux plus doués d'entre eux - certains occupant ensuite des postes
importants dans la politique -, qui dénonce la culture américaine
trop axée sur les matières scientifiques, où littérature
et philosophie sont négligées - dénonciation qui
fera le succès de son livre, le rendra très riche, jalousé
par ses collègues universitaires.
Ravelstein est un amoureux de la vie, ne craint pas les excès.
J'aime bien son côté provocateur, il se moque des convenances
: "la bonne conduite
en toutes circonstances est un très mauvais signe".
Ce roman à clé fera scandale lors de sa parution en 2000,
Saul Bellow s'étant inspiré d'Allan Bloom, son collègue
à l'Université de Chicago.
Le ton du roman est humoristique, tout en étant châtié
(valétudinaire). Très érudit, Ravelstein convoque
Platon, lit Thucydide, historien grec, dans le texte, Xénophon,
mais aussi bien Freud et Jung.
C'est un livre plutôt léger, qui réussit à
rendre agaçant Ravelstein de par son côté élitiste,
commère, son goût du luxe, mais aussi attachant par son côté
bouffon, fantasque, mais non moins sérieux quand il s'agit de pensées,
de réflexions.
Au cours de la narration, Chick sera confronté à sa propre
mort avant de se consacrer à la biographie de son ami décédé.
J'ai aimé le style du roman, avec le doute de Chick dans sa capacité
à écrire cette biographie, mêlant finalement sa propre
histoire à celle de celui qu'il peint.
J'ouvre à moitié, ma moitié à moi, je n'ouvre
qu'exceptionnellement en grand...
Annie![]()
Là où j'en suis de ma lecture (une soixantaine de pages),
j'ouvrirais à moitié. J'ai envie de continuer, mais mon
avis va être un peu faussé après tout ce que j'ai
entendu !
Edith entre ![]() et
et![]()
Je n'ai pas eu le plaisir de lecture que j'espérais en voulant
découvrir cet écrivain et j'en suis désolée.
Je l'ai lu en deux fois afin de me plonger dans son univers décrit
avec de nombreuses références littéraires et politiques.
Je suis allée rechercher parfois, tels Keynes et son œuvre
d'économiste.
Je n'ai pas été insensible à son humour (j'ai souvent
crayonné les passages) - humour "juif" comme on le disait
de Philip Roth, lu il y a quelques années lointaines.
J'ai été étourdie et confuse de ne pouvoir goûter
aux références des auteurs latins et grecs dont le héros
Ravelstein nous entretient (surtout dans la première moitié
du livre), cela amenuisant considérablement l'intérêt
(trop peu pressant, paresseux) pour ces auteurs et leur philosophie. Dommage
! Je n'ai étudié ni latin ni grec. Saul Bellow me semble
appartenir à ces grands lettrés, maîtrisant les idées
des Anciens, ce qui lui donne les éléments pour traduire
la philosophie (non conventionnelle) du héros Ravelstein.
Je vois en Ravelstein un homme cultivé amoureux de littérature
et cultivant son originalité dans l'utilisation assumée
de ses idées à contrecourant de ses condisciples. Saul Bellow
se livre dans toute sa dimension de penseur et de philosophe.
J'ai bien lu la fascination et la sorte d'emprise exercée par Ravelstein
(bien que prônant la liberté) sur ses élèves
anciens et nouveaux inscrits. Son allure et ses choix de vie luxueux n'en
sont pas non plus étrangers
J'ai de beaucoup préféré la deuxième partie
du récit : celle où il incombe à Chick de réaliser
la biographie de son ami de toujours, Ravelstein, après la mort
de ce dernier.
Rosamund et Vela, les deux compagnes de Chick, sont drôles et bien
dessinées par la plume de Bellow. D'ailleurs, et à plusieurs
reprises, j'ai relu les descriptions morphologiques faites pour Ravelstein,
de Herbst (transplanté cardiaque), de Rakmiel (l'écrivain
à l'encre verte) : "il
écrivait
quotidiennement copieusement interminablement et sans hésitation
de son encre verte" (p. 183)
; j'apprécie le portrait de cet homme "autrefois,
un rouquin, mais la rousseur avait disparu et il ne restait qu'un teint
rougeaud - sanguin dans la physiologie médiéval ; chaud
et sec. Ou, mieux encore, cholérique" ; il y avait
"deux éléments
étrangers dans son tempérament - l'un allemand, l'autre
britannique" ; et aussi celui de Grielescu (nazi dissimulé
par son érudition, antisémite Garde de fer) : "c'était
un fumeur de pipe fébrile qui ne cessait de curer l'objet, de le
bourrer, d'enfoncer de fins écouvillons dans le tuyau ou de gratter
la suie du fourreau" et au crâne "très
différent de de la calvitie blême de melon ovale de Ravelstein."
Quant aux différentes descriptions de Ravelstein, depuis son physique
de géant maigre et souffreteux (en phase terminale du sida) jusqu'aux
objets de son appartement ; objets de marque de luxe, ses accessoires
technologiques (machine à café énorme, un complexe
pupitre d'appareillage téléphonique, etc.), tout au long
des pages, la lecture par ces descriptions devient "régal".
Je n'oublie pas Nikki l'amant de Ravelstein et ses exigences de luxe (cf.
la Bmw offerte !), décrit comme "conception
exotique de lui-même" ; je n'oublie pas non plus
Berdier le restaurateur guadeloupéen et son funeste plat de vive.
Autant de personnages réels, contemporains (Thatcher, Hitler, Churchill)
que créés par l'imagination de Saul Bellow me semble-t-il
pour théoriser le Juif/les Juifs.
Par ailleurs, le réalisme des deux malades, Ravelstein puis Chick,
est dérangeant, avec la vérité de leur mort à
venir, et de véritables portraits de mourants, leur corps et leurs
pensées, avec des récits tranchants, sincèrement
cruels l'un envers l'autre, mais où l'humour n'est jamais absent.
J'ai essayé de saisir la démarche de l'auteur tout au long
du récit à propos des Juifs dans le monde, surtout les USA,
l'Europe dont Paris, avec leur présence dans le passé européen
et les guerres dernières, la Shoah, Dieu très souvent évoqué.
Trait insolent et drôle de Ravelstein quand il se dit frère
de Dieu, ce dernier étant représenté sur une gravure
avec la raie au milieu à la façon de son propre frère !
La mort et le mystère de "l'après", la religion
juive et catholique, sont des thèmes récurrents ; Ravelstein
doit continuer à vivre de la mémoire "biographique"
imposée à Chick du vivant de Ravelstein et dont Chick ne
cesse de repousser l'écriture.
Livre testament ? "On n'abandonne pas facilement un être
tel que Ravelstein à la mort"
En terminant, je me rends compte - car je viens de rapidement relire le
livre - qu'il me plaît mieux. OUVERT moitié plus.
Brigitte![]()
Livre grand ouvert. J'étais dans l'attente quand j'ai noté
dans les premières pages : "Les
écrivains sont censés nous faire rire ou pleurer."
J'ai aimé le sérieux entremêlé avec des touches
d'humour. Le narrateur m'a intéressée sans m'ennuyer. Beaucoup
de pistes de réflexion sur notre relation à la vie, à
autrui, à la mort dont il est difficile de parler en quelques lignes.
Mais je peux dire que ces idées résonnent en moi.
Il me faut un certain temps pour bien assimiler que Bellow fait revivre
au travers de Ravelstein Allan Bloom, son ami le philosophe excentrique
mort du sida. Un hommage à ce grand homme curieux, savant et truculent…
Selon ce que j'ai pu lire !
Première impression : de l'humour dès les premières
lignes. Pour exemple cette vision des présidents aux USA : "Celui
qui veut gouverner le pays doit d'abord le divertir".
Toujours d'actualité avec Trump !! Puis rapidement je me dis :
pas facile.
Pas facile le vocabulaire juste et riche - l'auteur est un prix Nobel
de littérature ! - qui me fait rechercher le sens des mots
parfois plusieurs fois par page : histrions, apologétique, shogun,
recension, scrofule, Uranien, coterie, mordacité, zélote,
habeas corpus, ingénuité, sybaritisme, transcendantaliste,
talbin, quiddité, méplat…
Pas facile les références nombreuses à la littérature
américaine (le poète Robert Frost), aux philosophes britanniques
(Whitehead et Russel), à la littérature et philosophie antique
(Plutarque, Platon), à la littérature anglaise (Shakespeare,
Hamlet), mais aussi référence à Nietzsche, à
Jean-Jacques Rousseau théoricien politique et réformateur
cité plusieurs fois (cf. p. 191 l'avis de Ravelstein sur cet
homme qu'il appelle un "génie
novateur"). Mais aussi des références à
la Bible, à l'art avec Picasso, avec Judith décapitant Holopherne
peint par Caravage, à la poésie (est-ce l'enfant dans la
discorde de Lawrence ?), au violoniste israélien Itzhak Perlman.
Je fais des découvertes. Curieuse, j'ai fait de nombreuses recherches
très intéressantes. À ce propos je note la phrase
de Bellow très juste en ce qui me concerne : "Mais
tout le monde a ses plates-bandes de connaissances éparses, et
c'est très agréable qu'on les entretienne et les arrose
à votre place."
Pas facile au début de la lecture de trouver le fil conducteur
outre l'amitié. Je reprends deux fois la lecture des vingt premières
pages pour entrer dans le récit. Pourrais-je en faire un pêle-mêle
et le lire en désordre ? Pourrais-je faire un puzzle jusqu'à
voir le portrait de Ravelstein ? Les deux personnages de fiction
sont des amis profondément attachés. Chick, le narrateur
aborde Ravelstein en procédant "au coup par coup" comme
il le dit. C'est sans doute pourquoi certaines parties me donnent l'impression
d'être écrites si je peux me permettre… dans un grand
désordre. Le basket se mêle au jazz, le téléphone
nous mène aux cérémonies de masse organisées
sous Hitler, son altruisme nous mène dans un court paragraphe à
la pose d'implants dentaires, son syndrome de Guillain-Barré à
sa vision des flics… Je me dis : c'est comme dans la "vraie"
vie ! C'est plaisant et c'est sans doute pourquoi la lecture peut paraître
facile.
Je cherche qui est Ravelstein et pourquoi lui porter tout cet intérêt ?
Un Américain amoureux de Paris, "un
de ses plus grands plaisirs". Un homme juif très
complexe selon Chick : un savant, un philosophe, un enseignant qui
agit avec ses étudiants comme un Pygmalion, un universitaire qui
aurait formé les grands personnages des USA et qui se réjouit
d'avoir les "tuyaux de la première heure", autrement
dit, il est averti de décisions géopolitiques majeures.
C'est un éducateur non conservateur avec ses propres idées
sur l'économie, la politique, les questions morales. Il est financièrement
riche et dépensier : "l'argent
était un truc qu'on jetait d'un express filant à toute allure".
Non puritain, disciple de Rousseau et de Platon. Je comprends que l'amour
est important tant l'amour de soi que l'amour de la beauté ;
il ne prône pas réellement la fidélité à
son ami. Je citerais quelques phrases sur ce thème : "Au
cœur de l'âme siège Éros." "Il voyait
en l'amour peut-être la plus grande bénédiction de
l'humanité"; "L'amour est une des plus hautes fonctions
de notre espèce - sa vocation." "Comme le bétail
a besoin de sel à lécher, j'ai parfois besoin de contacts
physiques". C'est un homme sensible aux belles choses
comme le cristal, comme les habits de grands couturiers et les montres
de luxe… Par contre, il a peu de rapport avec l'hygiène et
néglige sa santé ; il ne se refuse pas les excès:
"Il traitait son corps
comme un véhicule - une mobylette qu'il faisait filer plein gaz
sur la corniche du Grand Canyon." Je ne le vois pas gastronome
: "Quand Ravelstein
mangeait, il alimentait sa chaudière et nourrissait ses idées".
Puis dans une seconde partie du livre, j'apprends que Ravelstein se meurt
des complications du VIH. La mort et ses questions existentielles le rendent
dur et pour autant plein d'humanité. Cette phrase résume
bien ce que je ressens à la lecture : "Souvent
les mourants deviennent extrêmement durs. Nous serons toujours là
quand ils seront partis et il ne leur est pas facile de nous pardonner."
L'approche de la mort est inévitable et la fuite du temps non maîtrisable
: "La vie s'écoule
à toute vitesse. Vos jours filent plus vite que la navette du tisserand."
Alors, Ravelstein se plaît à parler de son amour, de son
homosexualité et de ses besoins sexuels. Avec son ami, ils échangent
sur la place de la spiritualité, la place du plaisir, l'influence
de son éducation et de la société libérale
qui infantilise selon lui. Il compose avec sa perte d'autonomie et avec
les changements physiques qui l'accompagnent : "Ses
jambes nues étaient comme des courges de concours, parce que ses
chevilles étaient enflées". Il pose des
questions. L'homme n'amène rien dans sa tombe, que deviendront
ces beaux objets qu'il collectionne ? Dans la mort, la propriété
ne veut plus rien dire. Il anticipe la transmission tant de son histoire
juive que du savoir.
Je vois Ravelstein comme un personnage qui peut se révéler
pour un ami comme attachant, opiniâtre, voire déstabilisant…
Ravelstein chemine avec son ami sur la mort et l'après. Je trouve
qu'il impose habilement à Chick de songer à sa propre mort.
Par exemple lorsqu'il lui suggère qu'il sera le premier ami à
le suivre de près dans l'au-delà. "Au-delà"
auquel il ne croirait pas.
Il peut me paraître agaçant et intrusif car il se mêle
de la vie de Chick ; il ne manque pas d'argumenter jusqu'à
des considérations les plus intimes. Où sont les limites
de l'amitié ? Il demande à Chick d'écrire son
portrait et le récit de sa vie : "Je
veux que vous me montriez tel que je suis, sans adoucissant ni assouplissant".
Gravement malade après la disparition de son ami, Chick refuse
la mort et il interroge la part du mental sur la maladie somatique. Cet
engagement à écrire pris avec son ami américain est-il
la raison a priori essentielle qui permet à Chick de survivre à
une étrange maladie tropicale avec atteinte neurologique, une intoxication
par une toxine de poisson : la cigua ? Sans oublier l'amour de sa
jeune femme Rosamund qui le tient "debout" comme un tuteur.
Enfin, j'aime bien l'idée de renvoyer la maladie et la mort à
leur place pour parler de la guérison.
Pour terminer, j'ai envie de partager le regard des deux amis sur les
Français : "les
Français étaient authentiquement cultivés - ou l'avaient
été autrefois… Ils conservaient néanmoins une
réelle sensibilité à la beauté, aux loisirs,
à la lecture et à la conversation ; ils ne méprisaient
pas les besoins matériels - les fondamentaux de l'humain".
Qu'en penser une vingtaine d'années après que Bellow l'a
écrit ?
Je ferme le livre contente d'avoir découvert Saul Bellow. Livre
à relire et à offrir.
Cindy![]()
Roman passionné, pétulant qui aborde des thèmes forts
poignants, surtout à la fin. Hymne à la vie, à la
mort, à l'amitié, à travers la complicité
des deux personnages érudits et drôles, tantôt sombre,
tantôt joyeux.
Ce livre est aussi tout en subtilité grâce au dialogue, vivant
spontané. Tout un art chez Saul Bellow.
Le personnage de Chick m'a beaucoup plu dans sa quête de "savoirs"
sur Ravelstein pour écrire sa biographie. Sensible, bienveillant,
ne se heurtant jamais devant la personnalité extravagante et singulière
de Ravelstein. Au contraire.
J'y ai vu aussi un intérêt pour comprendre sa propre vie,
son couple et se rapprocher de lui, qui, on le lira par la suite, sera
un soutien moral pour supporter sa maladie à l'hôpital et
cela par les nombreux souvenirs recueillis.
Toutes leurs discussions à bâtons rompus, sautant du coq
à l'âne, se placent bien dans une lecture dynamique ; et
les chapitres s'enchaînent, sublimés par les innombrables
citations. On aborde des sujets passés, culturels, brillants à
travers des références à de multiples intellectuels,
écrivains, philosophes.
C'est un voyage culturel ! Et difficile d'arrêter la lecture, me
situant comme dans une conversation de salon. C'est du "vivant"
ce livre ! Et dans la réalité des instants, chacun se livrant
tout naturellement avec toujours de la drôlerie.
Et par ailleurs, ces deux-là s'admirent parce qu'ils ont tous les
deux une intelligence humaniste et philosophique.
Tout chez eux force l'admiration ! Ravelstein, personnalité riche
au sens propre et figuré dans une telle démesure, ne m'a
pas choquée, car c'est d'un naturel plaisant !
Pour toutes ces raisons, j'ai beaucoup aimé ce dernier roman de
Saul Bellow, d'une grande culture et comme il est dit en première
page : "Étrange
que les bienfaiteurs de l'humanité soient des gens amusants."
Certaines citations font aussi échos à l'actualité
d'aujourd'hui : "Vivez
avec votre siècle mais ne soyez pas sa créature."
J'ai trouvé aussi de la compassion et de l'ironie.
C'est un livre spirituel, intelligent, à travers un personnage
certes extravagant, mais tellement brillant et joyeux ; et dès
les premières pages, comme quand Ravelstein demande à Chick
d'écrire sa biographie : "pas
de vulgarisation, pas de combines intellectuelles pas, d'apologétique,
pas d'airs supérieurs".
Et pourtant, on plonge dans un univers universitaire qui aurait pu rendre
la lecture ennuyeuse et trop sérieuse, mais rien de tout cela,
à mon heureuse surprise, je me suis amusée !
Au cours de la lecture, on revient souvent à ce qui définit
le livre, cette histoire d'amitiés intellectuelles, d'admirations.
Jusqu'à la fin Chick se rapprochera et comprendra son ami "j'avais
rendu visite à Ravelstein (…) dans les services de réanimation
(…) avec la stupidité du bien portant, j'avais imaginé
que je pourrais un jour être la personne qui était sanglée
là branchée sur un respirateur artificiel."
Encore ici, la complicité de ces deux êtres qui poursuit
Chick jusque dans sa maladie.
Saul Bellow met aussi en lumière des femmes remarquables qui sont
comme des piliers indispensables et le livre est donc aussi un plébiscite
sur les couples ; et celui de Rosamund est touchant, singulier comme le
personnage de Véra dont le souvenir jaillit chez Chick à
la fin du livre, avec le souvenir de sa rencontre et du sujet de la cryogénisation
: "tu te fais congeler
et mettre en réserve."
Le couple Abe Ravelstein-Nikki est un modèle pour Chick : "à
ce stade de ma vie je n'avais plus la ressource de changer mais c'était
une excellente chose (…) que mes fautes et manquements fussent relevés
par quelqu'un qui se souciait de moi."
Pour finir, j'ai trouvé dans les dernières pages de l'intérêt
à la description de la vie d'un service hospitalier, à travers
le regard et l'intelligence sensible du narrateur ; cela m'a beaucoup
touchée.
En conclusion c'est un livre sublime et joyeux : "sublime
(…) comme la musique (…) il s'aime dans une musique sublime
une musique dans laquelle les idées se dissolvent se reflétant
sous la forme de sentiments".
Et joyeux jusqu'à la mort : "Ravelstein
me dévisage riant de plaisir et d'étonnement (…) on
n'abandonne pas facilement un être tel que Ravelstein à la
mort".
Et moi je n'ai pas laissé facilement Saul Bellow : livre grand
grand ouvert ! (Voir l'avis complet de Cindy
avec d'autres citations soutenant son avis.)
Chantal
Je n'ai pas pu lire le livre, mais en vous entendant, c'est le livre de
Ravelstein, autrement dit d'Allan Bloom, que j'aurais envie de lire...
| DES
INFOS AUTOUR DU LIVRE • Les textes de Saul Bellow • Radio et film documentaire • Articles et entretiens • Repères biographiques |
| LES TEXTES de Saul BELLOW |
Voici les romans, nouvelles et essais publiés. Et des remarques sur l'édition française des livres de Bellow, la mention des livres non traduits (quel genre donc ?), la liste de ses prix (Bellow est un cumulard, Nobel compris). Voyons aussi qui sont ses traducteurs.
•
Romans
Voici les romans traduits avec, en tête, la date
de la publication américaine, puis la date de la traduction française
:
- 1944 : L'homme
de Buridan, trad. Michel Déon, 1954 ; retraduit sous
le titre Un homme en
suspens, 1981 (épuisés)
- 1947 : La
victime, trad. Jean Rosenthal, 1964 (épuisé)
- 1953 : Les aventures d'Augie March, trad. Jean Rosenthal, 1959,
National Book Award ; Les
aventures d'Augie March, trad. Michel Lederer, 2014
- 1959 : Le
Faiseur de pluie, trad. Jean Rosenthal, 1961
- 1964 : Herzog,
trad. Jean Rosenthal, 1966, Prix international de littérature (qui
récompense l'année précédente Les Fruits
d'or de Nathalie Sarraute), National Book Award ; Herzog,
trad. Michel Lederer, 2012
- 1970 : La
planète de M. Sammler, trad. Henri Robillot, 1972, National
Book Award ; La
planète de M. Sammler, trad. Michel Lederer, 2012
- 1975 : Le don de Humboldt,
trad. Anne Rabinovitch et Henri Robillot, 1978, Prix Pulitzer de la fiction,
annonce du Prix Nobel ; Le
don de Humboldt, trad. Michel Lederer, 2014
- 1982 : L'hiver du doyen,
trad. D. Guinsbourg, 1982 (épuisé)
- 1987 : Le
cœur à bout de souffle, trad. Henri Robillot, 1989
- 1989 : Un
larcin (novella), trad. Claire Malroux, 1991 ; Pavillon poche,
2015
- 1989 : La
Bellarosa Connection, trad. Robert Pépin, 1991
- 1997 : Une
affinité véritable, trad. Rémy Lambrechts,
1998
- 2000 : Ravelstein,
trad. Rémy Lambrechts, 2002.
•
Nouvelles
Saul Bellow a publié des textes courts dans des revues, dont certains
rassemblés dans quelques recueils de nouvelles :
- 1956 :
Au jour le jour, trad. Danielle Planel, 1962, cinq nouvelles ;
Un
futur père, trois nouvelles extraites de ce recueil
- 1968 : Mémoires
de Mosby et autres nouvelles, trad. Jean Rosenthal, 1975 ; Les
manuscrits de Gonzaga, trad. David Guinsbourg, 1981 (épuisé)
- 1984 : Him With His Foot in His Mouth and Other Stories -
Le Gaffeur, trad. Marie-Christine Lemardeley-Cunci, bilingue,
1992 ; La journée
s'est-elle bien passée ?, trad. Henri Robillot, 1992 (épuisés)
- 1990 : En souvenir
de moi, trad. Pierre Grandjouan, 1995 (épuisé)
•
Non
fiction (essais, conversation,
préface)
- 1976 : Retour de
Jérusalem : une enquête, trad. Henri Robillot et
Anne Rabinovitch, 1977 (épuisé)
- 1994 : Tout compte
fait : du passé indistinct à l'avenir incertain
(essais), trad. Philippe Delamare, 1995 (épuisé).
- 1999 : Avant
de s'en aller : Saul Bellow, une conversation avec Norman Manea,
trad. de l'anglais et du roumain Marie-France Courriol et Florica Courriol,
La Baconnière, Suisse, 2021 (voir l'article
de Florence Noiville, "Avant
de s’en aller,
de Saul Bellow et Norman Manea : conversation entre deux géants
de la littérature", Le Monde,
25 novembre 2021)
- 1987 : préface à l'essai
qui fit date
L'âme désarmée : essai sur le déclin de la
culture générale de Allan David Bloom, Les Belles
lettres, 2018. Ce livre, d'abord
publié chez Julliard
en 1987 (alors amputé de la dernière partie) fut un
"phénoménal succès de librairie" international,
commentera
Le Monde, traduit
en français l’année même de sa publication.
•
L'édition française des
livres de Saul Bellow
Les romans de Bellow ont été
traduits en France dès 1954. Ils ont été publiés
chez Plon d'abord, ensuite chez Gallimard.
Mais en 2012, les romans sont pour la plupart épuisés. Les
nouvelles également. Les essais itou. Qui lit Saul Bellow, à
part nous ?
Gallimard publie alors, en collection Quarto, 4 romans retraduits par
Michel Lederer, présentés par Philip Roth qui admire Saul
Bellow (1700 pages en deux tomes) : en 2012, Herzog
et La Planète de Mr. Sammler ; puis en 2014
: Les
aventures d'Augie March et Le don de Humboldt, Grand Prix
SGDL de la traduction (voir ›ici la
préface de Roth).
De même, en 2015, Robert Laffont republie en collection Pavillon
poche trois textes, plus récents : Le
cœur à bout de souffle, Un
larcin et La
Bellarosa Connection.
•
Non traduits en français
Saul Bellow a aussi écrit des pièces
de théâtre, mais le théâtre ne semble "pas
son genre" : Le démolisseur, Le soufflé
à l'orange, Un grain de beauté et La dernière
analyse, jouée à Broadway et assassinée par la
critique.
Il a également collaboré à de nombreux journaux :
Harper's Bazaar, The New Yorker, Esquire, Partisan Review, The New
York Times, Book Review, Horizon, Encounter, etc.) et fut, pendant
la guerre des Six-Jours en 1967, correspondant spécial de Newsday.
•
Les prix
L'attribution répétée de prix prestigieux font de
Saul Bellow une exception. Et il les a tous :
- trois fois le National
Book Award :
›en 1954 à 39 ans pour Les
aventures d'Augie March
›en 1965 pour Herzog
›en 1971 pour La
planète de M. Sammler
- le Prix Pulitzer en 1976 pour Le
don de Humboldt
- le prix Nobel en 1976 : le comité
le recommanda "pour la compréhension
humaine et l'analyse subtile de la culture contemporaine qui se manifestent
dans son œuvre", pour son remarquable portrait d’"un
homme qui continue à chercher à assurer son pas en errant
dans un monde chancelant, qui ne peut jamais renoncer à sa foi
en une vie dont la valeur dépend de la dignité et non du
succès, qui croit que la vérité doit finalement triompher."
Avant le prix : quand Steinbeck reçoit le Prix Nobel en 1962, il
envoie un exemplaire de son discours à Saul Bellow, avec la mention
: “You’re next”...
Après le prix : alors que T.S. Eliot avait prétendu que
recevoir le Nobel était une invitation à son propre enterrement,
Saul Bellow lui répondra : "Il y a un préjugé
qui veut que celui qui a reçu le prix Nobel soit vidé, fini,
prêt à mordre la poussière, plus rien ne sortira de
son stylo ou de sa machine à écrire. J'ai défié
ce préjugé-là. Je ne l'ai pas défié
par goût du défi, je l'ai fait posément car je pensais
que c'était un non-sens."
•
Le discours
du Prix Nobel
Où le trouve-t-on ? Dans la "Bible" : Tous
les discours de réception des Prix Nobel de littérature,
Flammarion, 2013.
Et voici, mis en ligne pour nous, le ›Discours
de Saul Bellow lors de la remise du prix Nobel de littérature
le 12 décembre 1976.
Extrait : il définit le roman comme "une
sorte d'accoudoir moderne, un cabanon dans lequel l'esprit peut se réfugier.
Un roman est partagé entre quelques impressions vraies et la multitude
des impressions fausses qui forment la plus grosse part de ce que nous
appelons la vie. Il nous dit que pour chaque vie humaine il existe toute
une diversité d'existences, que l'existence individuelle elle-même
est en partie illusion, que toutes ces existences signifient quelque chose,
tendent à quelque chose, accomplissent quelque chose ; il nous
promet une raison d'être, une harmonie, et même une justice.
Ce que Conrad disait était vrai : l'art tente
de découvrir au sein de l'univers, aussi bien dans l'existence
que dans la matière, ce qui est fondamental, permanent, et essentiel."
Ce discours, étonnamment, se réfère 9 fois à
Robbe-Grillet, à un article de 1957 retrouvé pour Voix
au chapitre, intitulé "Sur
quelques notions périmées"... très intéressant
!
Et Proust, s'y réfère-t-il ? Bien entendu ! Voici ›ici l'extrait dans le discours du Nobel et aussi une allusion gratinée dans un autre texte.
•
Les traducteurs
Mentionnons d'abord que Saul Bellow a été traducteur
d'œuvres d'Isaac Bashevis Singer : ainsi, Gimpel
le naïf, programmé dans le groupe en... 1988, avait
d'abord été traduit du yiddish en anglais par Saul Bellow.
Parmi les traducteurs de Saul Bellow, on mettra en valeur les deux traducteurs "historiques", Jean Rosenthal et Henri Robillot (qui se relayèrent de 1959 à 1992), puis Michel Lederer, qui a retraduit quatre grands romans après 2010.
5 livres traduits :
- Jean Rosenthal : Les Aventures d'Augie March (1959), Le
Faiseur de pluie (1961), La
victime (1964), Herzog
(1966), Mémoires
de Mosby et autres nouvelles (1975)
- Henri Robillot : La
planète de M. Sammler (1972), Retour
de Jérusalem : une enquête (avec Anne Rabinovitch,
1977), Le don de Humboldt
(avec Anne Rabinovitch, 1978), Le
cœur à bout de souffle (1989), La
journée s'est-elle bien passée ? (1992)
4 livres traduits :
- Michel Lederer : Herzog
et La Planète de Mr. Sammler (2012), Les
aventures d'Augie March et Le don de Humboldt (2014)
2 livres traduits :
- Anne Rabinovitch (avec Henri Robillot) : Retour
de Jérusalem : une enquête (1977), Le don de Humboldt
(1978)
- David Guinsbourg : Les
manuscrits de Gonzaga (1981), L'hiver
du doyen (1982). Précisions qu'il fut le traducteur du
Discours du Nobel, qui fut adjoint au livre
Les manuscrits de Gonzaga
1 livre traduit :
- Michel Déon : L'homme
de Buridan (1954)
- Danielle Planel : Au
jour le jour (1962)
- Claire Malroux : Un
larcin (1991)
- Robert Pépin : La
Bellarosa Connection (1991)
- Marie-Christine Lemardeley-Cunci : Le
Gaffeur (1992)
- Pierre Grandjouan : En
souvenir de moi (1995)
- Philippe Delamare :
Tout compte fait (1995).
| RADIO ET FILM DOCUMENTAIRE |
Le peu de documents
audio et vidéo en français sur Saul Bellow est significatif.
Saul Bellow n'est pas (encore) tendance, mais grâce à Voix
au chapitre, ça peut changer...
•
France Culture
- Entretien avec Saul Bellow qu'on entend
parler (très bien) en français : Jean Montalbetti, dans
l'émission L'homme en jeu, a rencontré Saul Bellow
sur le campus de l'Université de Chicago, où il dirige le
Comité de Pensée sociale, France
Culture, 12 mai 1983 (rediffusé dans
Les Nuits de France Culture)
Une trentaine d'années plus tard...
- "Bellow,
Yiddishkeit sur les bords du Michigan", Brice Couturier, Les
idées claires, 3 septembre 2015, 3 min 38
- "Saul
Bellow et le renouveau de la littérature américaine",
Caroline Broué, La Grande Table, 3 octobre 2012 :
Geneviève Brisac : "Il a subi les effets paradoxaux de la gloire. En France, nous lisions Bellow comme un écrivain potentiellement classique et traditionnel alors qu’il est incroyablement contemporain, musclé, drôle, expérimental, oral et que sa façon d’inventer son personnage Herzog a eu des conséquences énormes sur les écrivains des décennies suivantes."
Christophe Prochasson : "L’image de Bellow a été brouillée à cause de sa relation à Allan Bloom et de ce qu’il a représenté dans la culture politique américaine. Tout ceci a fait basculer Bellow du côté de la réaction et de la conservation. Mais au fond, ce sont aussi des gens extraordinairement non-conformistes, en rupture avec leur milieu d’origine, et même d’une certaine façon aux appartenances politiques auxquelles ils sont renvoyés."
•
Documentaire (en anglais,
sans sous-titres)
Diffusé sur PBS, dans la série American
Masters, The
Adventures of Saul Bellow (85 min) a été tourné
par le réalisateur
israélien Asaf Galay, entre 2016 et 2019, avec des entretiens avec
la famille et les amis de Saul Bellow, dont la
toute dernière interview de Philip Roth (qui admirait Bellow).
La bande annonce sur ›youtube.
| ARTICLES ET ENTRETIENS (avec des extraits) |
•
Sur Ravelstein
avant la publication en français
- Pour faire le lien avec un autre auteur
lu dans le groupe il y a quelques mois, Martin Amis
:
Ravelstein (2000) constitue à mon sens un chef-d'œuvre inégalé. Jamais auparavant le monde n'a entendu partielle prose : une prose d'une beauté frémissante et cristallisée. (Martin Amis, Guerre au cliché : essais et critiques)
- Sur Ravelstein dans la critique anglo-saxonne : vous pouvez consulter des extraits traduits pour Voix au chapitre d'une dizaine de journaux à la sortie du livre : The New York Times (plusieurs articles), The Village Voice, Salon, The Guardian, le Financial Times, le Sunday Times, l'Independent on Sunday, le Mail on Sunday, The Nation : ›ici la revue de presse
- Roth ou Bellow ? Un article original qui chronique ensemble La tache de Philip Roth et Ravelstein de Bellow (30 avril 2000 "The Ins and Outs of Bellow and Roth". Long extrait :
Dans une interview en 1981, Philip Roth a rapidement rejeté l'idée selon laquelle lui et Saul Bellow appartenaient ensemble à n'importe quelle "école" d'écriture judéo-américaine. Leurs similitudes sont minimes, dit-il, "quand on pense à tout ce qui doit découler de nos différences d'âge, d'éducation…, intérêts intellectuels, idéologies morales, antécédents littéraires et buts et ambitions artistiques".
Roth avait certainement raison : lui et Bellow ont moins de points communs en tant qu'écrivains qu'on le suppose souvent, et bien que les regrouper sur la base de leur origine religieuse puisse être sociologiquement pratique, cela ne nous approche pas d'une compréhension de leur travail..
La chose la plus intéressante que Roth et Bellow ont en commun n'a rien à voir avec l'origine juive. De manière plus convaincante que tout autre écrivain américain contemporain, les deux hommes ont transformé leur propre vie en fiction. Roth aurait pu parler au nom des deux lorsqu'il a décrit sa méthode littéraire comme "créer une fausse biographie, une fausse histoire, concocter une existence à moitié imaginaire à partir du drame réel de ma vie". À cet égard, ils sont les principaux représentants actuels d'une tradition centrale de la littérature américaine, une tradition qui remonte à la poésie de Walt Whitman et aux écrits philosophiques et autobiographiques d'Henry David Thoreau.
La fiction dans laquelle l'écrivain reste proche de lui-même court certains dangers évidents. Bellow et Roth n'ont pas toujours résisté à la tentation de donner à leurs alter ego les meilleures répliques, d'écrire des romans dans lesquels ils semblaient trop manifestement déterminés à régler leurs comptes avec d'anciens ennemis ou ex-femmes. La romancière et philosophe Iris Murdoch a écrit que "nous jugeons les grands romanciers par la qualité de leur conscience des autres... pour le romancier, c'est au plus haut niveau le test le plus crucial." Il serait difficile de dire que tous les romans de Bellow et de Roth réussissent ce test avec brio.
À cela s'ajoute - à leur réticence occasionnelle à tenter de voir au-delà de soi - l'absence relative de personnages féminins intéressants dans leur travail. Ces deux écrivains sont si doués qu'il semble parfois qu'il n'y a rien qu'ils ne peuvent faire. Il est donc étonnant qu'aucun d'eux ne nous ait donné un personnage féminin aussi mémorable que leurs protagonistes masculins. Bien que leur œuvre soit remplie de femmes aux dessins saisissants, elles sont pour la plupart des personnages secondaires. Il n'y a pas d'Anna Karénine, pas d'Isabel Archers, pas d'Emma Bovary dans les romans de Bellow et Roth.
- Suivent des articles en français, avant la traduction du livre : "Requiem pour un ami", Dinitia Smith, Courrier International, n° 489, 16 au 22 mars 2000. Extrait :
Bellow a toujours intégré des éléments de sa vie dans ses romans. Il a brossé un portrait de son ami Delmore Schwartz dans Humboldt's Gift [Le Don de Humboldt, éd. Flammarion, 1978], publié en 1975. Son roman de 1964, Herzog [éd. Gallimard, 1986], est censé s'appuyer sur la liaison de la deuxième femme de Saul Bellow avec l'un de ses meilleurs amis. Ravelstein est également une sorte de traité sur l'art de la biographie. Ravelstein y pousse Chickie, le narrateur (qui ressemble à Bellow), à écrire l'histoire de sa vie.
- "États-Unis : trahison ou inspiration ?", Le Monde, 28 avril 2000
Bloom et Bellow étaient amis, Saul Bellow avait préfacé l'ouvrage de Bloom. Mais dans Ravelstein, Bellow retrace l'amitié entre deux écrivains et il est clair que c'est de son amitié avec Bloom qu'il parle. Jusque-là, rien de bien étonnant. Sauf que Ravelstein est homosexuel sans le dire et meurt du sida, alors que Bloom est mort en 1992, d'un cancer du foie. Pour beaucoup, le roman n'est pas vraiment un roman, mais des Mémoires. Ils accusent Bellow de "betrayal chic", de trahison chic. Bellow a avoué, dans un entretien accordé au New York Times, qu'il n'avait pas du tout eu l'intention de révéler quoi que ce soit sur Bloom, tout en ajoutant qu'il ne s'était pas rendu compte que parler de sida était un sujet aussi sensible et qu'il trouvait que les gens avaient une attitude digne du Moyen Âge.
- "Saul Bellow a-t-il trahi son ami ?", par Henriette Korthals Altes, Lire, 1er février 2001. Extrait :
Ravelstein (Bloom) sied parfaitement à la galerie des personnages belloviens. Brillant, drolatique et pétri de contradictions touchantes, il est une de ces figures rédemptrices au cœur de l'Amérique nihiliste. L'ami magnanime est dépeint sous les traits d'un homosexuel hédoniste, d'une curiosité intellectuelle et d'une érudition gargantuesques, d'une prodigalité outrancière, qui jusqu'au seuil de la mort lance ses traits d'esprit et d'autodérision et quitte le monde avec une dignité stoïque.
Pourtant, ce portrait élégiaque n'a pas manqué de secouer la presse américaine et anglo-saxonne. Avant même la publication de Ravelstein (à paraître en 2002 chez Gallimard), Bellow avait laissé entendre à un journaliste du Washington Post que son prochain livre serait inspiré de son amitié avec le célèbre philosophe. Le Toronto Star conclut rapidement que Ravelstein serait une esquisse biographique dans laquelle le Prix Nobel révélerait la pédérastie assumée mais non déclarée de Bloom. Bellow fut accusé d'outing (révélation publique de l'homosexualité d'une personnalité) et les critiques crièrent à la trahison. Il avait depuis toujours nourri sa fiction de sa vie personnelle. Mais il avait franchi là une frontière sacrée entre l'intime et le public en s'appropriant au nom de l'art la vie de celui qui fut d'abord un collègue à l'université de Chicago, puis un ami intime.
•
Sur Ravelstein lors de la publication
en français, les articles prolifèrent...
- "Auguste
Bloom", Alexandre Fillon, Livres Hebdo, n° 457, 15 février 2002
(sortie du livre : le 5 mars 2002). Extraits :
Alors qu’il se sait condamné, Ravelstein aimerait que Chick rédige sa biographie : "Vous pourriez réellement composer un excellent portrait. Ce n’est pas une simple requête, ajouta-t-il. Je vous en charge comme d’une obligation. Faites-le à votre manière de propos de table, quand vous avez bu quelques verres de vin, que vous êtes détendu et livrez vos remarques." Et Chick de répondre : "Il m’était impossible de lui refuser cela. Il ne souhaitait manifestement pas que je parle de ses idées. Il les avait lui-même exposées dans leur ensemble et elles sont accessibles dans ses ouvrages théoriques. Je me tiens donc pour responsable de la personne et, puisque je ne peux le dépeindre sans une certaine part d’implication personnelle, ma présence marginale devra être tolérée." Sans adoucissant, ni assouplissant, Chick va s’acquitter merveilleusement de sa tâche. (…)
Auteur, grâce à l’insistance de Bellow, en 1987 de The Closing of American Mind (devenu en France L’âme désarmée. Essai sur le déclin de la culture générale, sorti chez Julliard en 1987 avec une préface de Bellow), brûlot contre le déclin des valeurs américaines en matière d’éducation qui se vendit comme des petits pains, le truculent Bloom donne à Bellow la matière d’un splendide livre sur l’amitié, la vie et la mort.
- "Héros
et Thanatos", Marc Weitzmann, Les Inrockuptibles,
5 mars 2002. Extrait
:
Il y a quelque chose de difficile pour un lecteur non anglophone, et plus précisément français, dans les livres de Bellow : le baroque yiddisho-sternien de la narration, si on peut l'appeler ainsi. Cette façon désordonnée, en apparence, de faire avancer le récit "au coup par coup", comme le dit l'auteur dans Ravelstein, son dernier roman. C'est-à-dire en fonction des idées et souvenirs qui lui passent par la tête : un coup pour les discussions sur Adam Smith et Trotsky dans un bar de Greenwich Village en 1930, un autre pour les parties de poker mafieuses à Chicago dans les années 70, plus quelques autres encore pour une promenade en hélicoptère au-dessus de New York avec Jack Kennedy, pour les émeutes raciales de Chicago, pour les avocats véreux croisés au gré de divorces multiples. De digression en digression, au gré des livres, chacun des alter ego de l'auteur cherche la même épiphanie moderne : une illumination poétique susceptible de "sauver l'âme" d'un narrateur (comme le dit Ravelstein) cherchant le sens des choses dans l'angoissant chaos du monde.
- "Bellow sans fin", Didier Jacob, Le Nouvel Observateur, 7 mars 2002. Extrait :
Ravelstein est une extraordinaire leçon de littérature et d'humanité, où l'intelligence le dispute à la pudeur, le désespoir à l'humour et le singulier à l'universel.
Dressant l'admirable portrait d'un homosexuel flamboyant, hédoniste, flambeur, Saul Bellow raconte aussi son propre déclin, sa maladie, sa mort annoncée. On séjourne à Paris en compagnie de Bloom-Ravelstein, on fait ses courses chez Lanvin avant d'aller chez Sulka finir d'épuiser le compte en banque, on disserte sur Joyce, Rousseau, Céline, Kojève, le déclin de la culture française, l'humour juif, le désespoir juif, Michael Jackson (un "petit singe à paillettes"), Hitler, l'homosexualité, la nature, l'écriture et la vie. "La règle avec les morts est qu'ils devraient être oubliés", écrit Saul Bellow. Cette règle comportera donc, un jour, au moins une exception.
- "Saul Bellow : l'amitié à mort", Éric Neuhoff, Le Figaro, 14 mars 2002. Extrait :
Ravelstein est le récit d'une amitié jalouse et turbulente, de rapports irrigués par des discussions quotidiennes, d'une estime réciproque et d'une rivalité partagée. Les écrivains ont du mal à supporter le succès des autres. Le narrateur en profite pour se dépeindre lui aussi, son ex-femme Vela, sa dernière épouse à la jeunesse insolente et qui a été l'élève de Ravelstein, ces restaurants de luxe où il allait avec un Roumain ayant appartenu à la Garde de fer et qui pourrait bien être Mircea Eliade. Le roman prend un ton plus grave avec ce voyage aux Caraïbes où Chick est empoisonné par un poisson et manque y passer. La mort n'est pas seulement pour les autres. Chez Bellow, l'angoisse est un bon carburant. Elle est fouettée par un humour rageur, une vitalité déconcertante. Bellow garde cette faculté d'appuyer soudain sur l'accélérateur, ce goût pour les digressions, les ruptures de rythme, les tête-à-queue. Ravelstein semble nous dire qu'on est immortel quand on a un livre à finir, un ami à honorer. Au détour d'un paragraphe, Bellow avoue qu'il se garde Finnegans Wake pour sa retraite. Visiblement, ça n'est pas demain la veille.
- "Saul Bellow descend aux enfers", Le Point, 15 mars 2002. Extraits :
Non sans impatience, on attendait la traduction de Ravelstein. Pourquoi ? Parce que ce serait là le dernier roman de Saul Bellow, le Socrate de Chicago, né en 1915, et que tout critique a le culte morbide du récit testamentaire. (…)
Nous attendions un testament, un memento mori, le cimetière de l'âme américaine par un coriace qui aime la mitraille autant que l'Al Capone de son adolescence à Chicago. Nous avions tort. Bellow refuse la mort, celle symbolique qui ferait de lui un gisant aux côtés de Bloom, celle réelle qui le contamine sur une plage paradisiaque. Sous le sable, le jugement dernier Pour ne pas mourir, semble-t-il dire, attaquons.
Il est question ici de mémoire juive, de ressentiment, de femmes trop maquillées et semeuses de divorce, d'argent qui circule en corrupteur, des morts à qui l'on survit, de ce qu'on leur doit, de la nécessaire trahison. Bellow descend aux enfers : ils ont la couleur bleu pastel et vert lagune des coraux. Ils ont la tendresse d'une couverture en vison, dans laquelle Bloom s'enroule.
Chercherait-on la morale de l'histoire qu'on la trouve dans une fidélité de l'auteur à lui-même. Bellow est un survivant. "Le malheur revigore, le confort relâche", dit-il. À 87 ans, ayant épousé en dernières noces une étudiante de feu Allan Bloom, il semble que Bellow ne se laisse guère attendrir. Tant pis pour ses amis. Tant mieux pour la littérature.
- "Une amitié platonique", Philippe Lançon, Libération, 28 mars 2002 et "Saul Bellow : Ravelstein", 10 septembre 2004. Extraits :
Bloom-Ravelstein sait qu'il va mourir. Il a demandé à Bellow-Chick d'écrire librement son portrait posthume. (...) La seule manière de saisir ce tourbillon est justement de tourbillonner, de bâtir un patchwork qui n'évite ni les répétitions, ni les contradictions.
Bellow recompose ainsi son ami mort avec la liberté qu'il lui doit : désordre apparent des thèmes, légèreté de la touche, profondeur du trait, destruction de tout lien biographique et apparemment logique. Le sens du livre circule dans des scènes parfois brèves, parfois revenant dans le livre entier, parce que la vie et l'amitié sont ainsi : un détail devient un monde et vous hante toute la vie, tandis que des années entières, des moments prétendument importants disparaissent dans un trou. Avec un grand savoir-faire et une fausse négligence, l'écrivain enchaîne les souvenirs, les réflexions, pour mieux les dynamiter : il ne veut pas écrire une biographie à l'anglo-saxonne, genre dont il a lui-même été victime. Il veut faire revivre son ami couture après couture, là, devant lui, sur la page.
Le roman est évidemment à clefs ; les utiliser n'est pas désagréable, puisqu'un lecteur est aussi une joyeuse commère qui cherche à voir sous les masques.
(Les clés du roman à clé : chaque personnage du livre serait "inspiré" d'une véritable personne ? Et alors ? Vous aimeriez savoir de qui ? Cliquez ›ici)
- "Saul Bellow Ravelstein", Alexandra Lemasson, Magazine littéraire, 1er avril 2002. Extrait :
Si Alan Bloom a largement inspiré cet être de papier étincelant qui se moque des chichis de de l'intelligentsia littéraire, il y a fort à parier que Saul Bellow lui-même lui a légué bon nombre de ses réflexions. Roman tour à tour désinvolte et profond, ironique et grave, cocasse et émouvant, Ravelstein tient du manifeste. Par le truchement de ce personnage d'intellectuel tout aussi familier des amuseurs comme Mel Brook ou W.C. Fields que des classiques, le romancier américain réaffirme sa croyance en la suprématie de l'humour. Une arme qu'il manie avec une dextérité jubilatoire et dont il rappelle la nécessité : "Étrange que les bienfaiteurs de l'humanité soient des amuseurs. En Amérique du moins". Sorte de credo dont il ne se départira pas au fil d'un roman peu à peu envahi par les thèmes obsessionnels de la mon et de la maladie auxquels il apporte des réponses empreintes d'humanisme. Sur un sujet grave Saul Bellow a écrit un roman profondément divertissant au sens noble et pascalien. "La mort aiguise le sens de l'humour" rappelle Ravelstein. Il faut croire les personnages de roman : ils disent souvent la vérité. Une sacrée leçon !
- "Ravelstein le magnifique", André Bleikasten, La Quinzaine littéraire, 16 avril 2002. Extrait :
Tout cela, dira-t-on, n'a qu'un intérêt anecdotique. Mais c’est lorsque Chick/Bellow nous parle de sa propre vie et de sa propre mort que sa prose se met à s’animer et à s’échauffer, et l’une des scènes les plus troublantes du livre est celle où Vela nue vient frotter sa toison pubique contre la joue de Chick, puis lui tourne le dos et s'en va, lui signifiant ainsi son congé.
Le lecteur n’entre jamais de cette manière-là dans l'intimité de Ravelstein et son portrait nous laisse au bout du compte sur notre faim. Tel qu’il nous apparaît à travers le regard de Chick, Ravelstein surprend, amuse, agace et parfois émeut. Mais, au rebours de ces ratés sublimes qu’étaient Herzog, Sammler et Humboldt, il est trop poseur, trop sûr et trop content de lui-même pour devenir attachant et lorsque Chick nous dit que "Ravelstein menait une vie intellectuelle de grande ampleur", il faut le croire sur parole.
Ravelstein est bien du Bellow, ronchonneur et vitupérant, toujours aussi fâché avec son siècle, plus que jamais en délicatesse avec l’Amérique, et de temps en temps, au détour d’une phrase ou d’un paragraphe, on y retrouve la griffe du vieux maître. De vrais bonheurs d'écriture encore, de soudaines fulgurances et des rosseries délectables, mais plus de pâte en fusion. Du Bellow à petit feu. On est loin, dans ce treizième et peut-être dernier roman, des logorrhées fébriles et jubilantes de ses meilleurs livres.
- "A la recherche de Ravelstein", Martine Silber, Le Monde, 19 avril 2002. Extrait :
Ravelstein est une des plus belles créatures de Samuel Bellow, brillant, original, éclatant de vie, impérial, fantasque, courageux devant la maladie et la mort, un enseignant incomparable qui dirige ses étudiants "vers une vie plus élevée, pleine de variété et de diversité, régie par la rationalité". Si Platon revient souvent dans le livre, c'est que l'enseignement de Ravelstein ne peut se comparer qu'à celui de Socrate.
Les dernières pages sont éblouissantes dans une sorte de résumé qui fait revivre une dernière fois l'ami, le confident, l'observateur attentif - "On n'abandonne pas facilement un être tel que Ravelstein à la mort". On lui consacre un livre.
•
Sur Ravelstein lors de la réédition
- "Bain
d'Amérique : Saul Bellow en portraitiste magistral avec la réédition
de Ravelstein", Florence Noiville, Le
Monde, 16 septembre 2004. Extraits
:
Pour qui voudrait, avant l'élection du 2 novembre, prendre un bain d'Amérique, cette réédition de Ravelstein tombe à pic. Son auteur, Saul Bellow - né en 1915 de parents juifs émigrés de Russie, couronné par le National Book Award pour Les Aventures d'Augie March et Prix Nobel de littérature en 1976 -, n'est pas seulement l'un des grands écrivains du XXe siècle. Il est aussi l'un des meilleurs peintres de son pays. On jugera de son actualité dès les premières lignes du roman, lorsque, dans une critique féroce du fondamentalisme religieux, Bellow stigmatise, depuis le procès Scopes - aussi célèbre outre-Atlantique que notre affaire Dreyfus -, ce qu'il appelle le "nigaudus americanus". Toute ressemblance avec des situations proches de nous étant bien sûr loin d'être fortuite (...)
Car même après sa disparition, Chick s'interroge encore sur la "persistance" de Ravelstein, sa manière de surgir obliquement en toute circonstance. La dernière phrase du livre donne la clé. "On n'abandonne pas à la mort un être tel que Ravelstein", un être qui disait : "Frayez avec les personnes les plus nobles, lisez les meilleurs livres, vivez avec les puissants, mais apprenez à être heureux seul." Un être qui restera l'un des plus beaux personnages de Bellow.
- "Présentation
et commentaire", André Durand, Comptoir littéraire.
•
Au fait, le narrateur crache le morceau
dans Ravelstein
Page 17 en Folio :
Je peux bien lâcher le morceau : j’ai eu au lycée un professeur d’anglais du nom de Morford ("Morford le dingue", comme nous l’appelions), qui nous faisait lire l’essai de Macaulay sur la Vie de Samuel Johnson de Boswell. Je ne saurais dire si c’était une lubie de Morford ou un article du programme fixé par le Conseil d’Université. L’essai de Macaulay, commande de l’Encyclopedia Britannica au XIXe siècle, était publié dans une édition scolaire américaine par Riverside Press. Cette lecture me mettait en transe. Macaulay me grisait avec sa version de la Vie, avec l’"anfractuosité" de l’esprit de Johnson. J’ai lu depuis de nombreuses critiques pondérées des excès victoriens de Macaulay. Mais je n’ai jamais été guéri — je n’ai jamais voulu être guéri de ma faiblesse pour Macaulay. Grâce à lui, je vois toujours ce pauvre Johnson convulsif effleurant tous les réverbères de la rue et mangeant de la viande avariée et des puddings rances.
Mon problème : comment m’y prendre pour écrire une biographie. Il y avait l’exemple de Johnson lui-même, dans la notice sur son ami Richard Savage. Il y avait Plutarque, bien sûr. Quand je mentionnai Plutarque à un helléniste, il le ravala au rang de "simple littérateur". Mais, sans Plutarque, Shakespeare aurait-il pu écrire Antoine et Cléopâtre ?
Je considérai ensuite les Vies brèves d’Aubrey.
Mais je ne vais pas énumérer toute la liste.
Le modèle de l'entreprise biographique de Chick serait donc La vie de Samuel Johnson de Boswell, une biographie apparemment célèbre... Samuel Johnson (1740-1795) est un grand auteur britannique classique et Boswell (1709-1784) également un écrivain.
•
Entretiens et rencontres
-
Un entretien avec Saul Bellow : "La
culture, c'est de l'esbroufe !", Le Nouvel Observateur,
7 mars 2002. Extraits :
Dans Ravelstein, vous vous êtes inspiré de la vie du sociologue américain Allan Bloom. Peut-on donc considérer votre livre comme un roman à part entière ?
Tout ce que j'écris finit par être une sorte de roman. Ce qui est important, ce n'est d'ailleurs pas le résultat, mais le processus d'écriture. Alberto Moravia m'a dit un jour : "Les romans sont toujours un morceau de la vie du romancier." J'aime bien citer cette phrase.Mais pourquoi raconter, comme Vargas Llosa dans son nouveau livre sur le dictateur Trujillo, la vie d'un homme qui a réellement existé ?
Il y a peut-être l'influence des médias sur le public, qui exigent un travail précis, vérifiable, une sorte de fiabilité technique. Pour moi, c'est autre chose. Certes j'étais ami avec Allan Bloom, il m'avait même demandé d'écrire un jour sa biographie. Mais l'essentiel était de composer un texte narratif rigoureux qui génère ensuite un personnage. Mon ambition n'était pas de dessiner une silhouette, mais, plus modestement, de créer, à partir d'éclats du monde, un univers particulier. Dans le cas d'Allan Bloom, j'ai eu beaucoup de mal à y parvenir, surtout à cause de son homosexualité. Je continue à m'en vouloir un peu de cette révélation posthume ; mais, après tout, c'était un élément de sa personnalité.Votre livre a fait scandale quand il est sorti en Amérique. Est-ce justement parce que l'homosexualité est encore un tabou ?
La société, c'est vrai, continue à réagir comme autrefois quand s'annonçait un lépreux. Cela dit, il fallait en parler, car le livre porte aussi sur ses thèses provocantes. (...)Mais Allan Bloom, votre héros, ne met-il pas justement en cause le déficit culturel de l'Amérique ?
Permettez-moi d'entrer un peu dans les détails. Pour moi, Bloom n'est pas un intellectuel engagé, il ne militait pas pour plus de Mallarmé ou moins de Sigmund Freud. Pour moi, c'est un trophée que l'on vénère. Un personnage aux innombrables facettes, qui connaissait Homère aussi bien que l'hôtel Crillon, aimait les symbolistes autant que la haute couture française, était entiché de culture comme des garçons qu'il draguait dans les rues de Paris. Une personnalité étincelante, idéale à tout point de vue pour réfuter la thèse absurde de la mort du roman. Le succès de mon livre montre d'ailleurs qu'il y a toujours un intérêt, chez le lecteur, pour des personnalités extraordinaires, et que s'il est souvent mis en jachère il ne demande qu'à être réveillé. Bloom était un homme cultivé, mais c'était avant tout un virtuose de la vie. Il détestait la vantardise, les chichis intellectuels.
- "L'ermite du Vermont", Florence Noiville, Le Monde, 8 septembre 1995, repris dans le livre Écrire c'est comme l'amour : portraits littéraires, éd. Autrement, 2016, pour lequel Voix au chapitre l'avait reçue en 2016. Elle lui rend visite chez lui, dans le Vermont. Extraits sur les auteurs et les livres :
Voilà donc le repaire de l'écrivain qui passe pour l'un des plus cultivés des Etats-Unis. Keats, Yeats, Shakespeare... Comme les cailloux du Petit Poucet, des livres, un peu partout, vous conduisent de la cuisine au saint des saints, une forêt de papier imprimé au cœur des arbres. Alliance saisissante entre nature et culture : il y a, dans cette bibliothèque improbable, les nourritures préférées de Saul Bellow : Faulkner, Hemingway, Henry James... Des contemporains aussi, comme Denis Johnson, Ralph Ellison, Philip Roth. "J'aime et j'admire Philip Roth", précise Bellow, tandis que Janis, sa cinquième femme qui fut aussi l'une de ses postgraduate students, apporte du thé et des gâteaux à la cannelle.
Pétri par les livres, Bellow l'est depuis son plus jeune âge, lorsque la littérature faisait "partie intégrante de la vie". "On s'en nourrissait. Pas en connaisseur, en esthète, en amoureux des lettres. Non, c'était une chose que l'on ingérait pour qu'elle devienne notre substance même."La dérision, le sarcasme affleurent sous l'eau qui dort. Évoque-t-on ses "confrères" du voisinage, Bellow s'échauffe : "J. D. Salinger est de l'autre côté de ces collines, dans le New Hampshire. C'est un ours. Ne voit personne. Ne sort jamais. Pire que moi." Soljenitsyne ? "Il habitait là, lui aussi, avant de rentrer dans son royaume ! Il vivait en exil, comme les Stuart à Versailles après la Révolution ! Non, je plaisante. Ses romans ne sont pas très bons. Trop rigides. Mais j'aime ses 'goulag books' !"
Il se moque de bien des choses, Saul Bellow. Des attaques des autres et de son relatif isolement parmi les écrivains américains, des universitaires et des intellectuels, "ces grands prêtres corrompus de la culture" et aussi du "politically correct" qui lui hérisse le poil : "C'est la ligne du parti. Si vous vous en écartez, vous êtes excommunié." Il s'est même, il y a peu, attiré les foudres des bien-pensants qui l'accusaient de relativisme culturel. "J'aurais dit que les Papous n'avaient donné naissance à aucun Proust et qu'il n'y avait jamais eu de Tolstoï chez les Zoulous, ce qui était considéré comme une insulte envers ces deux peuples et comme une preuve que j'étais, au mieux, un être dépourvu de toute sensibilité, au pis, un élitiste, un chauvin, un réactionnaire et un raciste, en un mot un monstre." Et Bellow, de tempêter contre "la dictature du 'PC'", regrettant l'époque de Mark Twain où l'humour avait une "influence salutaire" sur le comportement du "Cretinus americanus".Il vient d'inventer le concept de reader harassment. "Voyez Norman Mailer, dit-il. Il fait beaucoup de bruit, il a des prétentions viriles et révolutionnaires qui ont mal vieilli. Mais quand il est bon, il est vraiment très bon. Ce qui est scandaleux, c'est la longueur de ses romans. Jeter tant de papier à la tête des gens en attendant qu'ils vous lisent... ! "
- "Les paysages de Saul Bellow", par Pierre Dommergues, Le Monde, 18 janvier 1982. Extrait :
- Et pour vous - personnellement - qu'est-ce que la mort ?
- La mort ? Oui, j'en ai entendu parler. Mais, en ce qui me concerne, ce ne sont que des rumeurs. Qu'en dites-vous ?...
- "Trois questions à James Atlas", biographe de Bellow, propos recueillis par Florence Noiville, Le Monde, 6 avril 2005. Extraits :
Vous êtes l'auteur d'une importante biographie de Saul Bellow (Bellow, A Biography, Random House, 2000). Qu'est-ce qui vous a frappé le plus au cours de ce travail ?
La façon dont il s'est arrangé pour être à la fois original (c'est-à-dire pour exprimer son génie) et représentatif. C'est un écrivain sorti de nulle part, qui s'est trouvé au milieu des grands événements historiques et littéraires de son temps : l'américanisation des immigrés, la grande crise, la seconde guerre mondiale, Greenwich Village dans les années 1950, les turbulences des sixties et la "culture de guerre" des années 1980, qui est fort bien évoquée dans le livre de son ami Allan Bloom, The Closing of the American Mind.On dit qu'il est celui qui a fait cesser la domination wasp (White Anglo-Saxon Protestant) sur la littérature américaine ?
Disons qu'il y a puissamment contribué, avec Bernard Malamud, Norman Mailer et plus tard Philip Roth. Voyez le paysage littéraire américain aujourd'hui : Jonathan Franzen, Jeffrey Eugenides, Richard Ford, Jamaica Kincaid. Je ne connais pas leur appartenance religieuse, ils ne se revendiquent ni comme wasp ni comme juifs. Comme Bellow d'ailleurs, qui disait toujours : "Je ne suis pas un écrivain juif : je suis un écrivain américain et il se trouve que je suis juif."
•
Autres articles éclairants généraux
sur Saul Bellow et son œuvre
- Synthèse des caractéristiques
de l'auteur, André
Durand, Comptoir littéraire
- "Saul Bellow, le grand écrivain
de l'autre Amérique, est mort", Lazare Bitoun, Le Monde,
6 avril 2005.
•
Carrément des livres
- Saul
Bellow, Pierre Dommergues, Grasset, 1967
- Saul
Bellow : un regard décalé, Claude Lévy, Belin,
coll. "Voix américaines", 2003
- Autour
de Saul Bellow, dir. Paul Lévy, Presses universitaires
d'Angers, 2011, douze contributions d’universitaires présentées
›ici
| REPÈRES BIOGRAPHIQUES |
• Biographie avec images ›sur le site American Masters
•
Potins : mariages et enfants
(5 mariages et 4 enfants)
- 1938 : mariage avec Anita Goshkin - un fils - séparation 1954,
divorce en 1956
- 1956 : mariage avec Alexandra Tschacbasov - un fils - séparation
en 1959, divorce en 1960
- 1961 : mariage avec Susan Glassman - un fils - divorce en 1966 (tiens,
puisqu'on est à la rubrique potins, en 1962, il est invité
à la Maison Blanche pour un dîner donné en l'honneur
d'André Malraux...)
- 1974 : mariage avec Alexandra Ionescu Tulcea, une professeuse de mathématiques
théoriques à l’Université Northwestern, née
en Roumanie ; divorce en 1985
- 1989 : mariage avec Janis Freedman, qui a été étudiante
d'Allan Bloom ; Bellow, sur le modèle du serial-killer, se décrit
lui-même, à partir de ce cinquième mariage, comme
un serial-mari ; ils ont une fille en 1999 : il a 84 ans et fait remarquer
qu'il est comme "un arrière-grand-père pour mon propre
enfant"...
•
Potins : les thérapies (pour les
connaisseurs.seuses du groupe)
- 1951 : il entreprend une thérapie avec
un analyste dans la mouvance de Wilhelm
Reich, à la recherche d'une énergie "orgonale",
en quête d'épanouissement émotionnel et sexuel...
- 1958 : il entreprend une nouvelle thérapie
- 1960 : il se lance dans une nouvelle thérapie, la troisième,
avec le Dr Albert
Ellis, un sexologue
- 1969 : début d'une nouvelle cure avec Heinz
Kohut, un psychanalyste américain d'origine viennoise en rupture
avec Freud sur la psychopathologie et dont la contribution à la
constitution du Self (le narcissisme) joue un rôle important
dans la théorie analytique.
•
Voyons l'enfance...
- Fils d'Abraham
Belo, un juif orthodoxe de Saint-Pétersbourg qui avait étudié
le Talmud, joué du violon et vendu des oignons d’Égypte
avant d’émigrer en 1913 au Canada, Saul Bellow est né
dans la banlieue de Montréal, à Lachine, qui se trouve de
l’autre côté du Saint-Laurent, en face de la réserve
iroquoise de Kahnawake :
"Quand j'étais enfant à Lachine, une jeune fille de Caughnawaga passait par le pont pour venir prendre soin de moi. Quand elle me faisait manger, m'a raconté ma mère, elle mâchait bien la viande avant de me la mettre dans la bouche. C'est à cause de cela que j'ai réussi dans la vie !"
Il grandit dans la tradition juive la plus stricte, corrigée cependant par la vie de la rue.
La famille vivait "dans une zone aujourd'hui entièrement portoricaine et noire, à l'ouest de Division Street. Mes parents, venus d'Europe, voulaient que je résiste aux désordres de l'entourage. Ils voulaient me donner une bonne connaissance de l'hébreu, une solide éducation religieuse, une excellente formation afin que je fasse carrière dans les affaires ou dans les professions libérales. Mais j'étais attiré par la rue. Le yiddish ? On ne le parlait qu'à la maison. Et l'hébreu au heder, l'école religieuse. J'ai commencé à apprendre l'hébreu à quatre ans. On récitait la Genèse, puis on la traduisait, phrase par phrase, en yiddish. J'ai écrit l'hébreu bien avant l'anglais. Mais j'ai appris à parler l'anglais en même temps que le yiddish. L'anglais était la langue des rues.
Il en retira entre autres la connaissance de quatre langues : le yiddish qu'il parlait à la maison (ses parents parlant le russe entre eux), l'hébreu qu'il apprenait au "heder", l'anglais et le français qu'il entendait dans la rue :
Dans la rue, il y avait l'étrangeté supplémentaire de la langue française. Je ne m'en rendais pas compte, bien sûr. Je n'avais pas de point de comparaison. Montréal était une ville européenne construite sur le modèle britannique. Mais c'était aussi une ville française, et une ville d'émigrants, au moins dans le quartier où j'habitais. Les enfants français marchaient en rang, deux par deux, en plein milieu de la rue, pour aller à l'école des sœurs.
D'ailleurs à Lachine sur les chantiers de la "Dominion
Bridge’’, les ouvriers étaient ukrainiens, russes, hongrois,
grecs, siciliens...
Dans sa biographie, Zachary Leader (The
Life of Saul Bellow: To Fame and Fortune 1915-1964 (2015), raconte
au sujet de la mère de Bellow, que sa distraction préférée
:
"c’était d’aller voir un film en matinée, le week-end. Bellow l’accompagnait parfois et se rappellerait une sorte de bourdonnement dans la salle, les chuchotements de dizaines d’enfants traducteurs, dont lui-même, murmurant en yiddish à leur mère."
Après la mort de son père (qui, n'étant guère habile dans les affaires, fit faillite dans toute une série de métiers, fut même "bootlegger"), la famille s'installa en 1924 à Chicago, celui d'Al Capone.
"J'avais neuf ans en arrivant à Chicago. Ce fut un choc. Tout était plus grossier, plus grand, plus bruyant. Tout était différent : les feuilles aux arbres, les brins d'herbe, le sol. Et même les molécules, c'était du moins le sentiment que j'avais. À peine étais-je devenu adolescent que j'avais pris à bras-le-corps l'idée de devenir américain. C'était une véritable libération. On échappait à l'influence de la famille, du heder, de l'orthodoxie. On se réjouissait de parler anglais. C'était une sorte de joie populaire."
En 1933, le décès de sa mère alors qu'il avait 17 ans fut pour lui un choc émotionnel très profond.
•
Les études
- 1933
: Université de Chicago, où il étudie la littérature.
À titre de conseil amical, le directeur du département d'anglais
de la faculté lui indique qu'il valait mieux pour lui renoncer
à tous ses projets d'études : "Aucun Juif ne peut
véritablement comprendre la littérature anglaise traditionnelle."
- 1935 : son père ne pouvant plus faire face aux frais de l'Université
de Chicago, il intègre Northwestern University où il obtient
un diplôme d'anthropologie et de sociologie.
- 1937 : il poursuit ses études en anthropologie à l’Université
du Wisconsi, commence un doctorat sur les Canadiens français, mais
quitte l'université avant la fin de l'année : "chaque
fois que j'essayais de travailler à ma thèse, je me retrouvais
en train d'écrire une nouvelle de plus". Il décide
de devenir un écrivain. De plus, il tombe amoureux d’une sociologue,
l’épouse et revient à Chicago où il enseigne
à temps partiel. Il bénéficie du programme Federal
Writers Project mis en place par Roosevelt en 1935 pour soutenir les
écrivains.
•
Une carrière mêlant écriture, enseignement, journalisme
- Débuts d'écrivain : en 1941, parution de sa première
nouvelle dans The
partisan review, “Two
morning monologues”. Alors influencé par le groupe d’intellectuels
trotskistes qui animent cette revue, il rejette le modèle du "tough
guy", du "dur", les rituels de la chasse, de la pêche
au gros ou de la tauromachie, tel un défi direct lancé à
Hemingway, dont la stature écrasait depuis vingt ans, la littérature
américaine.
- Guerre, divers travaux dans la presse et l'édition : il
enseigne à l'université du Wisconsin avant de servir dans
la marine durant la Seconde Guerre mondiale en 1944-45, expérience
qui lui inspirera son premier livre. Après sa démobilisation,
il s'établit à New York où, tout en travaillant pour
l'Encyclopædia Britannica (où
il rédige plusieurs monographies d'écrivains
célèbres en tant que responsable du secteur des "Grands
classiques de la littérature"), il enseigne.
- L'enseignement : sa carrière
de professeur de littérature le mènera d'université
en université (Minnesota, New York, Princeton, Porto Rico) jusqu'en
1961, date à laquelle, déçu par les controverses
politico-intellectuelles qui agitaient New York, il revient à l'université
de Chicago où il exercera 30 ans.
- Le
succès : son premier livre, L'homme en suspens, paraît
en 1944 suivi de La victime en 1947, où il analyse la relation
entre juif et non-juif : ces deux premiers romans de Saul Bellow reçoivent
un succès d'estime mais lui apportent la reconnaissance dont il
avait besoin de l'establishment littéraire : il en récolte
les fruits en 1948, sous la forme d'une bourse Guggenheim, grâce
à laquelle il passe deux ans à Paris, où il rencontre
Bataille, Merleau-Ponty, Camus..., où il écrit Les aventures
d'Augie March, qui lui vaut le prestigieux National Book Award en
1954. Herzog, paru en 1964, une biographie intellectuelle et spirituelle,
lui apporte une renommée internationale. La France le fait chevalier
des Arts et des Lettres en 1968, Le don de Humboldt (1975) est primé
par le prix Pulitzer et, en 1976, Saul Bellow se voit attribuer le prix
Nobel de littérature.
- La réalité rejoint le roman que nous lisons :
en 1994, au cours d'un séjour dans les Caraïbes, Bellow, empoisonné
par des crustacées, a une attaque, une double pneumonie, et reste
trois semaines dans le coma. Il publiera Ravelstein en 2000 et
ne meurt qu'en 2005, à 89 ans, enterré dans le cimetière
juif de Brattleboro dans le Vermont. À sa mort, Philip Roth
déclare : "Bellow m’a émancipé. Avec
Faulkner, il est la colonne vertébrale de notre siècle."
|
Nos cotes d'amour, de l'enthousiasme
au rejet :
|
||||
| |
||||
|
à
la folie
grand ouvert |
beaucoup
¾ ouvert |
moyennement
à moitié |
un
peu
ouvert ¼ |
pas
du tout
fermé ! |
![]() Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens