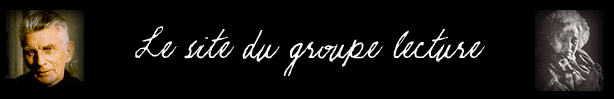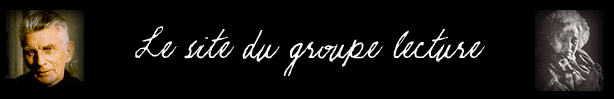|
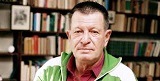
Extrait de
Babelio
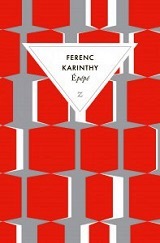
Quatrième de couverture (éd.
Zulma, 2013) :
"Les étranges divagations d'un polyglotte
érudit, Budaï, qui quitte les rives du Danube et croit s'envoler
pour Helsinki afin de participer à un congrès de linguistique.
Hélas ! à la suite d'une erreur d'aiguillage, son avion
atterrit dans une ville peuplée d'allumés qui parlent un
jargon incohérent, parfaitement inintelligible. Sommes-nous aux
portes de Babel ? Sans doute. Quant au malheureux Budaï, il
en perdra son latin : on dirait un petit frère de Zazie égaré
au pays des Houyhnhnms chers à Jonathan Swift. Épatant."
(André Clavel, L'Express)
Un roman culte traduit dans une vingtaine
de langues. »

Quatrième de couverture
(éd. Denoël, 2005) :
"Un linguiste nommé Budaï
s'endort dans l'avion qui le mène à Helsinki pour un congrès.
Mystérieusement, l'appareil atterrit ailleurs, dans une ville immense
et inconnue de lui. Surtout, la langue qu'on y parle lui est parfaitement
inintelligible. Ni la science de Budaï – il maîtrise
plusieurs dizaines de langues – ni ses méthodes de déchiffrement
les plus éprouvées ne lui permettent de saisir un traître
mot du parler local. Tandis qu'il cherche désespérément
à retrouver sa route, le mur d'incompréhension se resserre.
Sous les apparences familières d'une grande cité moderne,
tout paraît étrange et inhumain. Au plus profond de l'incommunicabilité,
Budaï fait un séjour en prison, connaît des amours éphémères
et participe même à une insurrection à laquelle il
ne comprend décidément rien.
Cauchemar oppressant et férocement drôle, Épépé
réveille en nous la plus forte des hantises : devenir étrangers
au monde qui nous est le plus familier."
Couvertures d'éditions étrangères :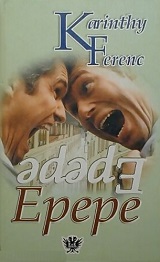
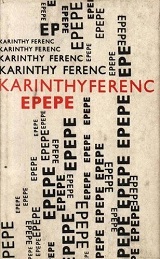
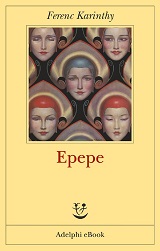
Autres livres
traduits en français :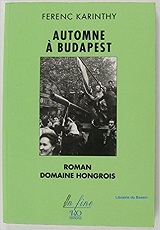


|
|
Ferenc Karinthy (1921-1992)
Épépé (1970)
Nous avons lu ce livre en 2017 (octobre
pour les groupes parisiens et novembre pour le groupe breton).
La préface
d'Emmanuel Carrère : ICI.
Sur l'auteur et son œuvre, voir ci-dessous
quelques
repères biographiques
et une petite revue de presse.
Annick L
J'aurais beaucoup aimé être là ce soir pour vous entendre
parler de cet ovni d'autant que cette lecture m'a "perturbée" !
Je vous lirai donc avec une attention redoublée…
Je crois que je ne me suis jamais sentie aussi perplexe pour donner mon
avis sur un livre… j'éprouve une grande admiration pour cette
œuvre littéraire remarquable qui met en place une mécanique
narrative impitoyable de laquelle le personnage principal, ne peut que
sortir broyé. L'auteur construit avec talent tout un monde parfaitement
crédible, avec plein de détails concrets, à partir
de cette mégapole inhumaine fourmillante d'activité humaine.
Cela m'a fait penser à certains romans dystopiques qui créent
de toutes pièces des sociétés totalitaires dans lesquelles
les citoyens sont condamnés à devenir de purs rouages du
système. Heureusement qu'il y a un épisode de révolte
à la fin, vite réprimé ceci dit (l'insurrection hongroise ?).
Donc j'admire l'œuvre !
Mais je rejette l'épreuve qui m'a été imposée
en tant que lectrice. J'étais désireuse, au début,
d'éprouver un semblant d'empathie avec ce malheureux Budaï,
universitaire pourtant doté a priori des capacités nécessaires
pour se repérer dans cette ville inconnue (il a l'habitude des
voyages) et pour déchiffrer cette langue nouvelle. Mais j'ai ressenti
un malaise grandissant, au fil des épreuves répétées,
voire répétitives, du personnage et je m'accrochais au désir
qu'il se passe enfin quelque chose qui débloque cette situation.
C'était comme un cauchemar éveillé. Au bout de 100
pages je n'en pouvais plus, alors au bout des 285 pages… je commençais
à en vouloir à ce sinistre Budaï et je me suis sentie
très soulagée qu'il disparaisse enfin au fond d'une rivière.
Ce fut pour moi un long parcours, une lecture survol, ménagée
de pauses fréquentes. Je préfère donc ne pas donner
d'avis.
Séverine
(avis transmis)
J'ai commencé ce livre le premier jour de notre voyage
en Grèce. En lisant la première page, j'ai de suite
pu m'imaginer à la place du narrateur : ayant dormi durant
le vol, j'ai pu me projeter sur ce que pouvait avoir de totalement déroutant
le fait de se réveiller dans un pays étrange… même
si la Grèce n'est pas étrange mais plutôt passionnante !
J'ai trouvé le sujet intéressant et je me suis donc plongée
avec grande envie dans ce livre, mais je dois dire que je me suis vite
essoufflée : il faut attendre trop longtemps (plus de 150
pages) pour qu'il y ait un rebondissement, une fois la surprise du lieu
inconnu passée… et nombre de faits nouveaux sont concentrés
en fin de roman (historie d'amour, révolte, etc.) J'ai eu le sentiment
que ça n'avançait pas, qu'on était dans un effet
de répétition. Certes ce rythme peut correspondre à
son avancée progressive dans ce nouveau monde et à sa lente
appropriation d'une situation nouvelle, mais en termes de plaisir de lecture,
je dirais que cela a suscité chez moi de l'ennui. Je n'ai pas apprécié
non plus les passages sur les recherches linguistiques qui m'ont paru
trop artificielles et n'apportant finalement rien à l'histoire.
Qu'il ait été linguiste ou non ne changeait finalement rien…
La préface d'Emmanuel Carrère que je n'avais pas dans mon
édition a confirmé certaines des hypothèses que j'avais
sur ce fameux monde : un monde totalitaire, un monde où l'on
n'est pas compris quand on est hors norme, etc. Mais j'avoue ne pas saisir
la passion, et d'Emmanuel Carrère, et de l'éditeur pour
ce roman (en 4e de couverture, une citation indique que ce roman pourrait
figurer aux côtés du Procès et 1984…
ça me paraît un peu exagéré), qui pour moi
aurait gagné à être beaucoup plus court car en soi
le sujet est intéressant mais il est trop dilué. Une nouvelle
aurait, à mon sens, été plus efficace. Bref, je l'ouvre
un quart.
Nathalie R
Je n'ai pas terminé ce livre. J'y ai mis toute ma bonne volonté
et j'ai essayé à plusieurs reprises. Ce livre m'a complètement
angoissée, je l'ai trouvé très anxiogène et
ne m'a pas fait rire du tout. J'ai été incapable de le prendre
au second degré. Le personnage principal ne m'amuse pas, le propos
ne m'amuse pas, la société qui y est montrée non
plus. Peut-on considérer cette œuvre comme une dystopie ?
Doit-on s'en amuser ? Moi je n'ai pas pu ! J'ai pensé
à des œuvres absurdes comme La
moustache d'Emmanuel Carrère paru en 1986 ou alors à
un très vieux roman d'anticipation que j'ai lu quand j'étais
jeune qui m'avait également beaucoup marquée.
Ce livre m'a exaspérée, je ne lui trouve aucun intérêt.
Je suis allée voir la fin du roman (j'en ai lu 110 pages), mais
quand j'ai pris connaissance de la fin c'est devenu pire, un véritable
pensum, une véritable souffrance de lecteur (ça me fait
penser à des réflexions de jeunes lecteurs quand ils renâclent
à accepter de lire une œuvre intégralement). Je n'ai
pas eu non plus envie de le feuilleter. L'aspect étouffant, minutieux
de la situation décrite ne me semble avoir aucun sens, ni symbolique
ni métaphorique. Je trouve que notre temps libre est tellement
précieux que lui imposer cela est une épreuve injuste. Une
torture.
Le monde décrit est compris en quelques pages, pourquoi en avoir
fait un roman ? Le traiter sous forme de nouvelle aurait largement
suffi à mon goût.
(Par contraste, Nathalie parle d'un
livre d'Alvaro Mutis que nous avons failli lire à la dernière
Semaine lecture...)
Je le ferme. Peut-être pourrais-je aller voir un psy pour comprendre
pourquoi je ne le supporte pas...
Richard
Je dis tout de suite... j'ouvre à moitié. L'idée
était géniale, croit-on au début de la lecture, mais
il faut attendre 2/3 du livre pour que cela avance. Les réflexions
du personnage amènent toujours au même point de départ.
Il persévère, il est têtu. Hormis le thème
original, ce livre pourrait être un mélange de Kafka et Orwell.
J'ai repris mes cours de fac à leur sujet et ce n'est pas à
son avantage : l'auteur ajoute des touches d'amour et de sexe pour égayer
mais cette astuce est trop voyante. La tension dramatique tient dans le
fait de savoir comment il va s'en sortir. J'ai eu peur que cela soit un
rêve ou qu'il trouve une explication rationnelle – ce serait
trop facile. Il aurait pu trouver une issue rationnelle, ce qui aurait
été trop artificiel. Il finit par une note d'espoir, cela
m'a soulagé. Les explications philologiques sont intéressantes.
Je me suis demandé comment j'aurais avancé dans cette même
situation...
Fanny
Le style simple au présent m'a accrochée. Mais avec un effet
soporifique d'ensemble. La description de la ville est bien faite, le
décor est bien planté. Mon hypothèse pendant la lecture :
il est mort (c'est surpeuplé, on ne sait pas comment les gens arrivent).
Il y a une dizaine de pages qui m'ont plu quand il tombe dans la décrépitude
(p. 236, 240) : il lâche alors quelque chose de son identité.
C'est peut-être une part de plaisir sadique qui m'a fait apprécier
ce passage... J'ouvre au quart.
Monique L 
Je me suis posé des questions sur les traducteurs, certains mots
ne correspondant pas au style de l'ouvrage, par exemple "l'homme
aux éphélides" pour parler de taches de rousseur...
Claire (au vocabulaire limité, et ayant justement sauté
ce passage)
Ah bon...
Françoise D 
J'ai commencé par la préface. J'adore Emmanuel Carrère
et ses références m'ont donné envie. Puis j'ai entamé
le bouquin… aïe aïe aïe. La démarche est intéressante,
mais peut-être surtout pour l'auteur… Il a écrit ce
livre au retour du Japon et il était dépressif, c'est peut-être
de là d'où est parti ce livre. Il s'agit d'une démarche
intellectuelle. Si on considère qu'il s'agit d'un conte fantastique,
tout est permis. Mais il y a de nombreuses invraisemblances ; il
n'est pas possible qu'il ne se fasse pas comprendre.
On se perd dans des détails et des descriptions qui n'avancent
pas. C'est désespérant, je n'ai eu aucun plaisir de lecture.
Le postulat de départ est intéressant, mais ce qu'il en
fait est raté. Je ferme le livre.
Jacqueline 
J'ai trouvé ce livre très intéressant.
Françoise
Ce n'est pas ce que tu m'as dit avant d'arriver...
Jacqueline
Dans l'autobus..., j'ai dit que c'était difficile à lire :
je n'ai pas peiné car je lis vite, je suis une lectrice qui "avale".
J'ai été enthousiasmée par le profil du linguiste,
mais j'ai tout de suite perçu des invraisemblances à ce
propos, par exemple pour "Pépé" et "Bébé",
le mouvement des lèvres (ouvert et fermé) n'est pas le même,
c'est impossible de confondre.
Claire
Ce n'est pas qu'il confond, c'est que le langage prononcé est instable.
Jacqueline
J'ai trouvé très intéressant le sentiment causé
chez le lecteur. Budaï est dans une impasse, tantôt il laisse
couler, tantôt il cherche à s'en sortir. J'ai marché,
peut-être en écho à ce que je vis en ce moment...
Mais cela fait un livre très pesant et un peu angoissant. Le personnage
réagit toujours. Je me suis demandé comment cela allait
finir. Il y va de l'espoir à la fin comme des espoirs précédents,
mais j'ai envie d'y croire avec lui. Cela me paraît comme une parabole
de l'existence humaine. Je relirais volontiers le passage de la manifestation
pour y trouver des sens à donner. Je "l'ouvre" aux ¾,
j'ai préféré ce livre à Topor.
J'ai apprécié le caractère inhabituel du livre.
Richard
Cela pourrait faire une série télé.
Manu
C'est la série Le
Prisonnier.
Nathalie R
L'enfer ce n'est pas de mourir, c'est l'idée qu'à chaque
fois on repousse.
Claire
J'ai été très contente de lire ce livre dont la préface
est passionnante. Je me souviens que Denis en avait parlé de façon
très convaincante en disant que ça l'avait beaucoup fait
rigoler (mais que sa femme ne l'avait pas aimé).
Françoise D
Il faudra bien écrire pour l'avis de Denis "Denis, QUI A PROPOSÉ
CE LIVRE" et je propose qu'on suive les avis de sa femme…
Claire
J'ai cherché ce qui avait pu faire rigoler Denis : la seule réponse
que j'ai trouvée est la façon dont Épépé
est nommée avec toutes sortes de variations, ça c'est vrai
c'est marrant (mais bon...) : Ébébé, Bébé,
Dédé, Tété, Tchéché, Édédé,
Etyétyé… J'ai été mue par le désir
de comprendre ce qui s'était passé, pourquoi il est là,
et où c'est. Quand j'ai vu qu'on tournait en rond, avec cette minuscule
intrigue avec la femme, je me suis mise à "lire rapidement"...
Je n'ai pas trop ressenti de souffrance. A la fin, quelle déception
avec le petit ru ! Oui c'est un livre phénomène, mais
pour une nouvelle d'accord l'idée est excellente. La déception
à la fin est immense. J'ouvre ¼. Mais j'aime bien l'hypothèse
de Fanny (on est dans le monde des morts) : quel dommage qu'il ne
l'ait pas adoptée et creusée...
L'univers de ce livre communique bien avec celui de Topor
qu'on vient de lire.
Denis
Je fais un rapprochement avec
Perec, pour ce qui concerne des exercices de logique formels (oulipiens).
Mais qui ne sont pas faits pour être lus.
Claire
J'ai lu des articles qui mettent en avant les thèmes kafkaïens
et ont une teneur élogieuse : en cherchant bien je trouve
la formulation d'échos de mes impressions :
- "Épépé
est un tour de force. La situation de départ de Budaï est
déjà si catastrophique qu'elle interdit normalement tout
développement" (Mathieu
Lindon) : je suis bien d'accord et l'effet est emmerdant !
- Karinthy "ressuscite
un vieux cadavre littéraire - l'incommunicabilité - en lui
injectant le sang frais de l'humour" (André
Clavel) : bof, bof, bof !
- "La montée
de l'angoisse ne tient pas au style mais à l'exactitude scientifique
de l'imagination, dont l'effet a tendance, à la longue, à
s'essouffler." (Marion
Van Renterghem) : bien d'accord, ça s'essouffle !
- Karinthy étale "les
hypothèses élaborées par son héros :
certains paragraphes forment ainsi des efflorescences de suppositions
qui s'accumulent, se ramifient, sans rien pour les arrêter, faute
d'interlocuteur." (Raphaëlle
Rérolle) : très jolie l'idée d'efflorescences,
en effet, mais il me perd, moi, comme interlocutrice...
Manuel
J'ai trouvé ça assez épuisant à lire. Je n'ai
pas aimé les énumérations, par exemple dans
le zoo avec les singes ("ils balbutient, ils criaillent, chuintent,
cancanent" etc.), je n'ai pas compris pourquoi il fait cela. Je n'ai
pas terminé le livre, mais il y a la
clé sur l'issue du roman p. 115 lorsqu'il évoque
le port.
En revanche, j'ai trouvé passionnantes les situations où
il cherche où il est, par exemple face au plan de métro.
La clef, c'est le langage et il ne l'a pas. Les pistes m'ont tenu en haleine
pour savoir s'il allait s'en sortir. J'ai été parfois amusé,
par exemple face au personnage du policier en train de manger.
Je poursuis ma lecture, vous ne m'avez pas découragé. Par
le passé, j'avais eu le livre entre les mains, mais ne l'avais
pas fini.
Claire
Cela pourrait vraiment faire un film.
Manuel
Oui, mais alors je ne sais pas où il mettrait son histoire d'amour.
J'ouvre ½.
Catherine
Ce livre m'a fait atrocement flipper, ça a été l'horreur.
Je n'ai pas cherché un livre plausible. Je suis claustrophobe et
je déteste la foule : ce livre est pour moi la peinture de
l'enfer, qui est assez bien rendue.
J'ai aimé la réflexion sur le langage avec la perte de la
vraie communication : ils ne s'écoutent pas, ils ne se parlent
jamais. Il y a cependant un îlot dans lequel le langage réapparaît
lors de la rébellion. Cela a un aspect science fiction, j'ai pensé
à Orwell et à Barjavel.
J'ai fait le lien avec certains patients qui perdent le langage, parlent
un jargon, sans comprendre qu'on ne les comprend pas – ceci est assez
bien rendu.
J'ai trouvé ce livre effrayant. Ils sont déshumanisés,
or c'est le langage qui fait l'humanité. J'ouvre ½.
Denis (qui a proposé ce livre)
(qui a proposé ce livre)
Je savais que le livre était difficile à lire et qu'il était
possible de décrocher. Mais c'est un livre intéressant et
nos discussions sont intéressantes. Il y a certains passages burlesques.
J'ai aimé la réflexion linguistique, tant en ce qui concerne
les phonèmes à l'oral que le langage écrit (l'auteur
a fait des études de linguistique). Il y a dans ce livre une dissolution
des limites auxquelles ont est habitué : au niveau des phonèmes,
au niveau de l'écrit sans ponctuation, au niveau de la ville qui
s'étend à l'infini. Budaï essaie de se constituer des
limites, par exemple en décryptant le plan de métro. La
foule de plus en plus dense m'a fait penser qu'il était mort. Il
y a un côté invraisemblable, on ne sait plus ou est la limite
avec ce qui existe et ce qui est inventé ; les limites entre
la culture et la nature sont également repoussées. La description
de sa situation quand il tombe dans la dèche sont très réalistes.
Le fait qu'il retombe toujours sur les mêmes difficultés
est le signe de son angoisse qu'il communique au lecteur.
La notion de temps renvoie à certains scènes très
longues dans les films hongrois, qui tentent d'inscrire la durée
du réel dans les films, en longs plans-séquences.
J'ai connu ce livre au cours d'une randonnée avec des amis hongrois
du côté de Saint-Véran. Il se trouvait que la patronne
du gîte avait le livre et me l'a donné, ne voulant pas le
lire. Ces Hongrois ont beaucoup parlé du père de l'auteur,
car cela a dû être difficile pour le fils de se faire un nom.
Je me suis interrogé sur la qualité de traduction (par des
personnes de sa famille).
Catherine
Le livre rappelle des régimes asiatiques.
Françoise D
On pense à la Chine.
Monique L
Au sujet des comportements de la foule, je me souviens en Chine, comme
dans le livre, on se fait bousculer, voire on reçoit des coups.
Catherine
Ce Hongrois dont Carrère parle dans la préface, il en parlait
déjà dans Un
roman russe.
Flavia (du
nouveau groupe dont des avis suivent) (du
nouveau groupe dont des avis suivent)
Je suis désolée de ne pouvoir venir,
voici quelques réflexions sur Epépé, à
rajouter aux vôtres (que j’ai hâte de lire !)
En lisant la préface
d’Emmanuel Carrère j’ai été assaillie
par une envie irrésistible de plonger dans ce livre, dont je n’avais
jamais entendu parler. J’ai beaucoup aimé la manière
dont E. Carrère nous présente ce roman : le parallèle
entre l’histoire d’Andras Toma et celle de Budaï attise
la curiosité du lecteur sans rien lui révéler ;
Carrère anticipe peu et ne gâche rien ; en revanche,
il nous donne une clé de lecture essentielle pour comprendre le
livre de Karinthy : l’histoire de Budaï est bien sûr
une fiction, mais des histoires semblables se sont véritablement
passées, et même aujourd’hui, personne n’est à
l’abri de se retrouver catapulté dans un monde devenu impossible
à comprendre.
Bien que ce texte soit ponctué
de passages très bien écrits et qui m’ont beaucoup
émue, j’ai moyennement aimé le style de Karinthy. En
revanche, la trame est passionnante ! Karinthy donne vie à
une histoire originale, bouleversante. Les personnages de Budaï et
d'Epépé sont magnifiquement décrits. Ils m’ont
beaucoup fait penser aux personnages de 1984 :
le même univers dystopique, le même hymne à l’amour,
seul et dernier recours contre un système qui écrase toute
pensée, toute envie, toute joie de vivre, toute personne voulant
revendiquer son individualité. Et, enfin, la même confiance
envers l’homme, source inépuisable d’espoir et d’endurance
lorsque tout semble perdu. Les émotions de Budaï sont décrites
avec énormément de sensibilité et de tendresse, et
cela nous rapproche beaucoup de ce personnage que, jusqu’à
la fin, on a désespérément envie d’aider, de
sauver…
C’est une histoire crue, tragique, qui laisse peu d’espace à
l’espoir, malgré la foi inébranlable de Budaï
de faire retour, un jour, "à la maison". Les dernières
pages m’ont un peu ennuyée. J’ai trouvé la description
des manifestations et des émeutes un peu trop longues et j’ai
décroché plusieurs fois. Tout d’un coup, l’attention
est excessivement tournée vers l’extérieur, le lecteur
perd de vue le personnage principal du romain, l’intimité
construite avec ce dernier est perdue. Mais malgré ce petit
"hic", j’ouvre grand le livre que je vais certainement
conseiller à mon entourage.
Julius
Brillant. J'ai trouvé ce livre brillant. Emporté par un
argumentaire simple, soutenu par un rythme alerte et une langue à
la fois sobre et efficace, je me suis laissé embarquer avec délices
dans un univers d'autant plus déroutant et dérangeant que
l'écart, la distorsion avec la réalité, avec la normalité,
est tout à la fois infime et plausible. C'est tout en finesse :
au premier abord, il semble s'agir juste d'une question de langage et
c'est alors tout le système de la communication qui s'effondre.
J'ai trouvé cela très adroit, car il n'y a pas d'extravagance,
pas de fantastique, pas de science-fiction, pas de dérapage, pas
d'événement ou de situation incroyable, au sens propre du
terme : tout est absolument crédible. Il manque juste l'essentiel,
à savoir ce qui permet à un homme d'être un homme :
la sociabilité, cette sociabilité rendue apparemment impossible
par la barrière de la langue qui maintient l'opacité du
monde autour du personnage de Budaï, un monde qui demeure inintelligible
pour lui dans la mesure où il ne dispose pas de la clé pour
le rendre compréhensible : les mots pour le dire.
L'univers est crédible, le personnage de Budaï est crédible,
il est vivant, il est en chair et en os, il a des émotions et des
sentiments, des peurs et des enthousiasmes, il est tantôt sympathique,
tantôt moins, il se débat comme il peut et c'est qui, pour
moi, le rend émouvant, attachant.
Et cette manière de placer le lecteur au cœur de son monologue
crée un effet de loupe car il nous met en situation. Or c'est bien
parce que nous sommes ainsi mis en situation, au plus près de la
réalité vécue par le personnage que nous sommes amenés
à échafauder toutes les hypothèses possibles pour
trouver un sens à cette situation : rêve ? Mort ?
Pays extra-terrestre ? Voyage dans le temps... ? Et nous échafaudons
tant et plus parce que Budaï lui-même n'échafaude pas.
Pour moi, lecteur, le grand étonnement a été, tout
au long du livre, de constater (non sans effroi) que Budaï, lui,
justement ne s'étonne pas. Sa seule interrogation porte sur l'erreur
de départ à laquelle il cherche une explication. Mais il
n'a pas de questionnement global sur ce monde, juste des interrogations
factuelles, opératoires. Il constate.
Or que constate-t-il ? Que cet univers, au premier abord, n'est pas
très différent du nôtre, à l'exception peut-être
de la foule qui déferle sans arrêt. Autrement dit :
rien. Je me suis alors demandé pourquoi il réagissait ainsi
alors que vous et moi trouveraient étrange cette société
qui repousse ou plutôt enferme malgré soi à l'extérieur
d'elle-même celui qui voudrait la pénétrer. Cette
société fait masse, comme si elle se protégeait du
plus petit fétu de paille susceptible de fausser ses rouages. En
fait, pour moi il y a deux niveaux. Et je ne suis d'ailleurs pas certain,
même s'il comprenait la langue, que Budaï pourrait, pour autant,
communiquer. Car il n'aurait peut-être pas d'autre choix, alors,
que de se fondre dans le système. Je pense que c'est peut-être
justement grâce à sa méconnaissance de la langue qu'il
survit, qu'il conserve son individualité. Car de toute évidence,
si on lit entre les lignes, on se rend compte qu'il n'y a pas de place
pour lui. Avec ou sans langue de communication, il n'y a pas de place
dans cette société-là pour un individu pensant par
lui-même. Au mieux, ce sont des groupes qui s'affrontent comme dans
les scènes révolutionnaires de la fin.
L'univers décrit dans le livre est foisonnant, grouillant, pléthorique,
plein comme un œuf, mais plus l'univers est foisonnant, moins il
y a de place pour l'individu et plus Budaï est seul et de moins en
moins humain, il est emporté, charrié, mais de déconditionnement
trouve ses limites grâce à l'incommunication des langues.
Il y a une réflexion philosophique qui pose la question de l'individu
face au collectif, sur le totalitarisme, sur le conditionnement, sur la
perte de repères, sur la difficulté à se révolter,
sur les moyens de se révolter, sur la langue comme essence même
de l'individualité…
J'ai trouvé la fin étrange et j'en ai d'abord été
déçu, je me disais que je ne l'aurais pas écrite
comme cela. En réalité, la fin laisse un goût doux-amer :
que va faire Budaï lorsque sera rentré chez lui ?? Est-ce
une fuite ? Que faire ? On retrouve le même inachèvement
dans un autre roman très court (plutôt une nouvelle) de Karenthy
qui s'intitule L'âge d'or et qui se termine aussi sans se terminer
en laissant un goût doux-amer.
Sinon, j'ai beaucoup apprécié aussi le style, l'inventivité,
l'extraordinaire richesse des situations, la construction curriculaire
du récit qui oblige Budaï à revenir à chaque
fois au point de départ. A son hôtel, mais aussi au point
de départ de sa réflexion, il y a toute une symbolique :
j'y vois un voyage intérieur, une recherche personnelle… J'ouvre
à 5/5.
François
Étrange lecture au cours de laquelle, je n'ai cessé de me
demander à quel film, tableau ou autre livre elle me faisait penser.
Kafka évidemment. Mais la quête du "héros"
d'Épépé n'est pas celle de Joseph K. ou de l'Arpenteur
du "Château". Dans le cas de Budaï qui a malencontreusement
atterri dans un pays inconnu alors qu'il se rend à un congrès
de linguistique, c'est la langue qui va devenir l'objet de sa quête.
Certes, le pays jamais nommé dans lequel il se retrouve rappelle
le monde glacé d'Orwell dans 1984 et celui des pays du bloc
de l'Est durant la guerre froide. (Manifestement notre l'auteur sait de
quoi il parle.) Mais malgré tout et quelle que soit la triste vérité
de cet ancrage, l'obstacle contre lequel bute son personnage relève
davantage de l'onirique et du fantastique que du politique. Comment rêver
situation plus absurde et étrange que celle de ce linguiste mondialement
connu qui ne parvient pas à déchiffrer la langue du pays
(jamais nommé) dans lequel il se retrouve par hasard ? Il
utilise pourtant tous les moyens que sa grande compétence lui permet.
Mais en vain, les chiffres sont les seuls repères qui lui restent.
Un peu comme Alice, mais dans un tout autre genre, il se raccroche à
tout ce qui peut faire sens pour lui, les notes d'hôtel et le numéro
de sa chambre par exemple. Quant au monde dans lequel il est plongé,
il lui reste hermétiquement clos et ne lui vaut que des rebuffades.
Cf. aussi la librairie ou il ne trouve aucun dictionnaire. Seule embellie
dans son malheur, la liftière de l'ascenseur de l'hôtel dont
il parvient péniblement à déchiffrer le nom et avec
laquelle il aura une aventure susceptible de lui faire oublier sa situation,
voire de combler son plus secret désir et de donner un sens à
sa triste aventure (c'est elle qui donne son titre au roman.) Mais très
vite, il la perdra de vue pour se retrouver mêlé aux manifestations
sauvagement réprimées qui se déroulent dans la ville.
De ces évènements qui renvoient probablement à l'insurrection
hongroise de 1956, Budaï reste avant tout un témoin horrifié
et prisonnier de son idée fixe : parvenir à déchiffrer
la langue qui lui échappe et qui tient du mauvais rêve (de
l'objet persécuteur diraient de plus savants), alors que le monde
autour de lui, aussi horrible soit-il, n'a pas perdu son sens et reste
ce qu'il est. Et c'est bien de cette opposition que surgira cette "l'inquiétante
étrangeté" qui est selon Freud une "variété
particulière de l'effrayant qui remonte au depuis longtemps familier".
Pour qui ne connaissait rien de la vie et de l'œuvre de son l'auteur,
elle est aussi le meilleur d'Épépé qui sa façon,
peut-être un peu trop prévisible, permet au lecteur de renouer
avec des peurs insoupçonnées. En se cognant désespérément
aux mots comme aux murs d'une prison Budaï nous conduit bien dans
les parages de l'indicible. Comme si la langue résistait même
aux linguistes et nous tenait par son essentiel défaut.
Il manque les avis d'Ana-Cristina, Emilie,
Françoise H, Nathalie F.
Synthèse
des avis du groupe breton (suivie
de 4 avis)
 Yolaine Yolaine ¾ :
Édith, Chantal,
Marie-Claire ¾ :
Édith, Chantal,
Marie-Claire
 ½ :
Suzanne, Annie, Jean ½ :
Suzanne, Annie, Jean ¼ :
Marie-Odile, Marithé ¼ :
Marie-Odile, Marithé
Si les appréciations exprimées lors
de cette rencontre sont diverses et pour leur majorité mitigées,
le malaise a été unanimement partagé, les impressions
négatives étant proportionnelles à la souffrance
éprouvée à la lecture. "Assommant, morose,
lassant, répétitif, ennuyeux, oppressant, déstabilisant,
inhumain, incompréhensible, insensé, perturbant",
il s'agit d'une véritable descente aux enfers, d'un cauchemar dans
un huis clos dont le héros n'arrive pas à briser l'enfermement,
malgré son acharnement et ses tentatives quotidiennes, accompagnées
d'autant d'échecs.
Cette histoire de polyglotte distingué, perdu dans un monde où
il est confronté à une langue complètement inconnue,
a évoqué pour certains Babylone, la tour de Babel, les aventures
de Robinson Crusoë, Dom Quichotte, La
Divine Comédie de Dante, et le roman de Cormac McCarthy
La
route. Deux malédictions pèsent sur le destin de
Budaï (dont on peut supposer qu'il a beaucoup de points communs avec
l'auteur) : d'une part la Shoah qui n'est pas évoquée
de façon explicite mais dont on devine l'influence à travers
l'hostilité et l'absurdité du monde auquel il se heurte ;
et d'autre part le régime totalitaire, décrit de façon
symbolique dans cette fable sur un monde sans communication possible,
sur une ville fourmilière étouffante où des foules
font la queue partout, jusqu'à l'explosion de violence finale qui
évoque de façon assez limpide la répression sanglante
des émeutes de 1956 en Hongrie.
Les avis sont également partagés sur le dénouement
de ce roman sans fin et sans issue : la découverte ultime
du cours d'eau qui offre la mince perspective d'atteindre la mer lointaine
est-elle encore une impasse, ou au contraire un espoir, une pirouette
de l'écrivain qui ne sait pas comment finir son récit, ou
une métaphore de la mort ?
Tous se sont accordés à reconnaître que cette lecture,
bien qu'éprouvante, fut originale et intéressante ;
Ferenc Karinthy traite avec beaucoup de maîtrise des thèmes
universels sur la condition humaine, l'incommunicabilité, la folie,
l'amour, la solitude, la mort, ce qui nous a permis un échange
assez riche.
Marie-Odile

En y repensant, ce qui a dû se passer c'est que j'ai été
alléchée par les références à Perec,
Swift, et la ressemblance phonétique entre le titre
Épépé et
le Opopoï de Queneau dans son
Histoire
des trois petits pois. Alors que je devrais être en train
de lire Topor retenu par le groupe breton, je lis donc les aventures de
Budaï, ne sachant pas très bien comment sortir de cette erreur
d'aiguillage littéraire.
Bien sûr, l'idée est intéressante qui place ce Robinson/Budaï
sur une sorte d'île/ville déserte/surpeuplée où
les préoccupations premières sont pour l'un comme pour l'autre
de manger et de repartir au plus vite, de mesurer le temps et d'explorer
les lieux... Mais le texte, entièrement écrit au présent,
me lasse très vite. Rien de l'humour ou de l'ironie attendue, juste
une petite satire de notre monde à travers ce monde étranger
qui ressemble tristement au nôtre. J'erre d'une page à l'autre
avec le même désarroi que le narrateur, me demandant ce que
je fais là. Cependant, je poursuis ma lecture ne sachant pas si
c'est par pur masochisme ou par fidélité à une sorte
d'engagement personnel lié à l'achat du livre, mais en sachant
que j'ai sur Budaï le gros avantage de pouvoir, à chaque instant,
d'un simple geste, revenir au monde normal (Karinthy tu ne m'auras pas,
moi). Je triche un peu au cours de ma lecture, saute des lignes, furète
dans les chapitres suivants pour savoir si quelque espoir est permis,
m'aventure même jusqu'à la dernière page en quête
d'une issue, et reviens inévitablement au point de départ
toujours aussi morose. Pourtant la perspective d'une relation "amoureuse"
salvatrice me garde en éveil et finalement je lis tout pour être
sûre de ne rien rater (Karinthy tu m'as eue). Au fil des pages,
au-delà de l'angoisse liée à l'enfermement, à
l'impossible communication, une certaine compassion naît en moi
lorsque Budaï, dans l'impossibilité de quitter la ville, en
vient à se quitter lui-même. La découverte finale
de l'eau n'efface pas le déferlement de violence insensée
qui la précède et je n'arrive pas à partager la confiance
du personnage. (Karinthy je t'en veux de l'avoir malmené/mal mené
à ce point/point final). J'ouvre ¼.
Chantal  
Quel livre étrange... et quelle lecture fatigante !!
Avant la lecture je l'ai feuilleté : écriture serrée
serrée... pas de paragraphes... peu engageant ! Et puis, bon,
il faut bien le lire ! Et là, pendant toute la lecture, j'ai
SOUFFERT avec Budaï, je manquais d'air littéralement, et d'espace,
trop de gens partout, dedans, dehors... Souffert de ne pas comprendre
leur langage, leur comportement ; souffert encore plus de voir Budaï
essayer encore et encore, lui le linguiste, de décrypter cette
langue inconnue, d'analyser tous les indices possibles et de le voir aller
d'échec en échec, jusqu'à sa dégradation physique
et mentale : une descente aux enfers ! Malgré les petites
lueurs d'espoir avec Épépé ou le lecteur de Vie
théâtrale jamais revu.
Ce thème de l'incommunicabilité est traité magistralement
et le procédé d'écriture est d'une sacrée
efficacité !! Avec, justement, cet aspect "serré",
étouffant, ces 258 pages de répétitions : l'hôtel,
le métro, les rues, et cette tour de Babel en construction sans
fin où les hommes tournent comme des hamsters en cage. Donc, que
va-t-il advenir de lui ? Comment l'auteur va-t-il s'en sortir ?
Du coup la fin m'a parue simpliste, ce ruisseau par où il va pouvoir
s'échapper... peut-être !
Et puis je l'ai relu, ce dernier chapitre, et là je vois tout ce
livre comme une fable, la vie humaine, celle de F. Karinthy, la nôtre,
comme une scène de la "Vie théâtrale", le
quotidien, les violences régulières, les joies, la vie qui
continue la scène nettoyée, les morts oubliés , le
soleil, c'est NOTRE vie !!
Je l'ouvre aux ¾, et, après la discussion, je l'ouvrirais
bien en entier !
Édith 
Combien j'aurais souhaité sortir avec le héros Budaï
de ce pays !!!! Absurde et suffocant, mais évoqué magistralement.
Mais non, juste juste quelques lignes à la dernière page
pour évoquer une boule de papier, celle qui entourait son repas
et qui, jetée, prend le chemin d'un hypothétique cours d'eau,
espérance d'autres lieux... un fleuve, la mer… Comme dans
l'espoir des héros de La
Route de Cormac McCarthy qui s'obstinent à marcher vers
la mer après le cataclysme atomique. Déception donc pour
ma part pour cette fin. Mais régal pour l'ensemble de l'écriture.
Toutefois, je n'ai pas ressenti comme parfois cela m'arrive de "jubilation"
à la lecture, du fait du style : trop d'énumérations,
trop de détails. C'est ce qui fait que je n'ouvre qu'aux ¾
le livre.
Les toutes premières lignes du récit m'impliquent dans le
récit "En
y repensant (L'auteur semble réfléchir sur la
situation et du même coup m'entraîne dans sa réflexion),
ce qui a dû se passer, c'est que dans la cohue de la correspondance,
Budaï s'est trompé de sortie , il est probablement monté
dans un avion pour une autre destination et les employés n'ont
pas remarqué l'erreur"… : le héros
Budaï est décrit face à ses nombreuses péripéties,
dépeint dans ses tentative de comprendre avec sa logique et ses
connaissances universitaires. Mais rien n'aboutit, Karinthy faisant toutefois
montre qu'il maîtrise, lui, des données linguistiques réelles.
Je suis de ce fait moi aussi embarquée dans le constat de l'erreur
de destination et amenée à réfléchir avec
Budaï comment en sortir. Je suis en droit d'attendre l'explication
qui arrivera – je pense – au dénouement…
Déception comme évoqué plus haut ! Alors je
plonge dans le monde de Budaï.
Impression d'inquiétante étrangeté, comme disent
les surréalistes. D'une part des données connues et reconnues
pour des réponses des "services" farfelus : l'hôtel
et son réceptionniste, le métro, les parades, l'ascenseur,
le travail, les bébés, la guerre. Je suis étonnée
par le courage de Budaï. Le temps disparaît, seul à
un moment il évoque l'idée que cela durera jusqu'à
sa mort. Je pense à "L'Enfer c'est les autres" et au
dispositif imposé de présences non choisies jusqu'à
la mort ! La succession des échecs que rencontre Budaï
m'agace et parfois pour connaître le dénouement, j'ai eu
envie de balayer de l'œil les nombreuses descriptions qui sont le
corps du livre. Et d'aller à la fin.
Deux grands moments d'espoir :
- Espoir que cette rencontre avec un "contemporain" qui lit
Vie théâtrale, un homme au loden vert : mais
aussitôt cet homme disparaît… Une rencontre qui aurait
pu permettre une autre fin. Mais non, l'auteur abandonne le propos, laissant
Budaï face à encore sa déception.
- Autre situation potentiellement "positive" sa "relation"
avec la femme de l'ascenseur, mais là aussi échec :
la relation tendre, abordée d'ailleurs si sobrement sinon maladroitement,
ne lui apporte aucune réponse, pire le déstabilise. Il la
perd de vue littéralement… Lui dit d'ailleurs "Adieu
Épépé" à la dernière ligne du
livre !
La préface d'Emmanuel Carrere lue avant, puis relue après
lecture du livre, ne m'apporte pas de lumière. Je constate seulement
son plaisir évident au texte, sans m'en étonner : Emmanuel
Carrère dans Un
roman russe – pour d'autres raisons – se trouve
confronté à son impossible communication liée à
la langue russe qu'il ne peut apprendre, mais aussi entraîné,
si je me souviens bien, dans des aventures non décidées.
En résumé, livre de pure fiction mais qui interroge fortement
les liens sociaux : il n'est pas sûr que le langage pratiqué
par les gens de cet étrange pays soit un moyen de communication
et/ou d'échanges. A plusieurs reprises, Budaï semble dire
que ce n'est pas le cas. Violence... incivilité... ignorance mutuelle…
Est-ce à dire que faute de se comprendre, seule la violence permet
de rétablir un peu d'harmonie ?... Scène du printemps,
la guerre, et à nouveau tout est remis en place comme de rien.
Marie-Claire  (nous a accompagnés virtuellement avec ce texte)
(nous a accompagnés virtuellement avec ce texte)
Épépé !!! Épépé ! Hé
pé pé…
Hé bé bé !…Hé bé bé !…
"Comment me libérer,
Dans ce pays hostile,
Qui ne me comprend pas,
Qui n'en prend pas le temps…
Pour ouvrir ses portes,
Et m'accueillir enfin !
Si le but de ce livre
Est de viser l'enfermement,
Pas que du héros,
Mais du lecteur,
Il est fort réussi,
Car il est source d'angoisse,
D'étouffement !
On croit devenir fou !
Dans toutes ces impasses,
On espère, on rêve
De trouver une issue
Pour pouvoir s'échapper
Trouver un indice,
un repère pour pouvoir se sauver !
Mais, tel un labyrinthe,
dans une ronde folle,
On tourne, on se perd,
On espère, et PAF !
Pas d'issue !
Retour case départ
Epépé !
Serait-elle l'espoir ?
La survie ?
L'échappée ?
Mais, tel un mirage,
Elle s'évanouit,
Souffrance, folie, survie, déchéance !
Est-ce ainsi que l'on fuit ?
Pour aboutir à une non-vie ?
Inconnu dans la rue ?
Comme tous sans logis !
Cette histoire, telle une fable,
N'est-elle qu'un plagiat,
Une interrogation,
de l'imbroglio d'un individu
Qui finit dans la rue ?
DOC SOMMAIRE SUR L'AUTEUR ET SON ŒUVRE
Quelques repères
biographiques
- Ferenc Karinthy est un écrivain
hongrois, linguiste, dramaturge, traducteur, né en 1921, fils d'un
célèbre écrivain et journaliste hongrois, Frigyes
Karinthy, auteur notamment du roman Voyage autour de mon crâne
(éd. Viviane Hamy, 1990 ;
éd. Denoël, 2006).
- Études de littératures hongroise, italienne et anglaise
et de linguistique à Budapest (1941-1945). Bourses d'études
en France, Suisse et Italie (1947).
- Auteur pour le Théâtre national (1949-1950), pour le théâtre
Madách (1953-1956), pour les théâtres de Miskolc,
Szeged et Debrecen (1965-1975).
- Collaborateur aux journaux Szabad Nép et Magyar
Nemzet (1951-1953).
- Nombreux prix (1948 : prestigieux Prix Baumgarten ; 1950,
1954, 1974 : prix Attila József ; 1955 : prix Kossuth)
- Traduit Machiavel et Molière, ainsi que des œuvres d'auteurs
grecs, anglais, italiens et allemands (1957-1960)
- Joueur de haut-niveau de water-polo (1960-1970).
- Conférences aux États-Unis, en Australie, URSS et à
Cuba (1968-1976)
- Mort à Budapest en 1992, après un long état dépressif.
- Il a pour fille Judith Karinthy (la traductrice d'Épépé)
et petite fille Agnès Karinthi-Doyon, auteure aussi (son site
: https://akarinthi.com)
- Un site lui est consacré, incluant toutes ses œuvres accessibles
: http://www.frigyes-karinthy.fr.nf/
Livres de Ferenc Karinthy traduits en français
- Automne à Budapest, éd. In fine, 1992
- L'âge d'Or, Mille Et Une Nuits, 1997 ; Denoël, 2005
- Épépé, éd. in Fine/Austral, 1996 ;
Denoël, 1999, 2005
; Zulma, 2013
avec une préface
d'Emmanuel
Carrère.
Petite
revue de presse
- "Tel père, tel clown", André
Clavel,
L'Express, 19 décembre 1996
- "Les dessous de Budapest. Ferenc Karinthy, L'Age d'or.",
Mathieu Lindon, Libération,
15 mai 1997
- "Patyagya-Gyabbou ? Par Ferenc Karinthy, auteur hongrois mort
en 1992, Épépé ou les aventures d'un linguiste
à l'étranger : cauchemar pour le héros, fou
rire pour le lecteur.", Mathieu Lindon, Libération,
13 juin 1996
- "Un homme dans la foule", Marion Van Renterghem, Le
Monde, 5 juillet 1996
- "Le sexe du désespoir", Edgar Reichmann, Le
Monde, 13 juin 1997
- "La Babel inversée de Karinthy", Raphaëlle Rérolle,
Le Monde,
21 juillet 2005
- "Épépé ou la perte de soi", Maryse Emel,
Non Fiction, 30 juillet 2015
- "Tribulations d'un Hongrois en Utopie", Claire Mazaleyrat,
Lavisdeslivres, 16 octobre 2014
- Une interview
des traducteurs, Judith et Pierre Karinthy, par Guillaume Richez,
Les Imposteurs, 16 février 2017.
Pour accéder à l'ensemble
des articles en un document, cliquez ICI.
Les
mardis hongrois organisés à Paris ont un blog avec plusieurs
pages sur les Karinthy :
- Épépé
- La
saga des Karinthy
- Les œuvres de Frigyes Karinthy ici
puis
là.
Nos
cotes d'amour, de l'enthousiasme au rejet :

  

à la folie, beaucoup,
moyennement, un peu, pas du tout
 Nous écrire
Nous écrire
Accueil | Membres
| Calendrier | Nos
avis | Rencontres | Sorties
| Liens
|