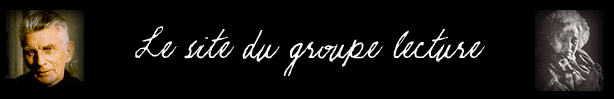
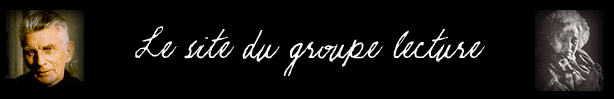 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Quatrième de couverture :
“Placé du côté de la légèreté,
du sourire, le roman de Pouchkine est unique dans la littérature
russe : il n’apprend pas à vivre, ne dénonce pas,
n’accuse pas, n’appelle pas à la révolte, n’impose
pas un point de vue, comme le font, chacun à sa façon, Dostoïevski,
Tolstoï, ou, plus près de nous, Soljénitsyne et tant
d’autres, Tchekhov excepté…
Eugene
Oniéguine, trad. Nata Minor, annexes
et notes de Léonid et Nata Minor, Points Poésie, 2018 Alexandre Pouchkine (1799-1837) est un poète, auteur, dramaturge et romancier russe. Il est notamment l’auteur de La Dame de pique, du Convive de pierre et de La Demoiselle Paysanne. "La littérature russe est née avec
Pouchkine." |
Alexandre Pouchkine (1799-1837)
| ||||||||||||||||||||
|
Les
18 cotes d'amour des groupes parisien et breton |
Des infos autour du livre ›en bas de page.
LIEN AVEC NOTRE SÉANCE PRÉCÉDENTE
Voici un lien tout trouvé
avec notre séance africaine
: Kidi Bebey, invitée spécialiste qui était avec
nous la fois dernière, est l'auteure d'une série publiée
dans Le Monde Afrique l’été 2022 où elle
demande à un écrivain "du continent" quels sont
les ouvrages qui l’ont le plus marqué.
Parmi "les
trois livres qui l’ont marqué", le romancier camerounais
au prénom prédestiné Eugène Ebodé commence
par Eugène Onéguine : "Parce
qu’il me parle tout le temps. Pouchkine produit une sorte d’extension
prémonitoire de lui-même avec ce livre qui raconte presque
sa vie. Eugène Onéguine est l’histoire d’un
duel entre un poète et son ami et rival. Ils sont amoureux de la
même femme. Le poète va mourir lors du duel… et on sait
que Pouchkine est mort de la même façon. Mais dans Eugène
Onéguine, ce qui est extraordinaire à mes yeux, c’est
qu’il chante son Afrique, le continent avec lequel il a un lien ombilical,
on ne le sait et ne le dit jamais assez [né à Moscou
en 1799 dans une famille de la noblesse russe, Pouchkine était
l’arrière-petit-fils d’un Africain dénommé
Abraham Hannibal]. Je connais des extraits de ce roman par cœur.
Par exemple, il écrit :
La liberté me viendra-t-elle ?
Il est temps, j’ai hâte de fuir
Quand passe un vaisseau, je l’appelle
Avec lui je voudrais partir
Quand donc commencera ma quête/
Parmi les vagues, les tempêtes ?
Quand donc braverai-je le vent ?
Oui ! Tout quitter ! Il est grand temps
Quitter ces rives ennuyeuses
Me réfugier dans le lointain
Et là, sous mon ciel africain
Regretter la Russie ombreuse
Où j’ai souffert, où j’ai aimé
Et où mon cœur j’ai inhumé.
Tout au long de ma vie, je reviens sans cesse à ce texte !"
(8 autres auteurs africains indiquent à Kidi Bebey quatre livres qui les ont marqués : Beata Umubyeyi Mairesse, Nétonon Noël Ndjékéry, Emmanuel Dongala, Abdourahman Waberi, Hemley Boum, Chika Unigwe, Tanella Boni, Yamen Manai.)
POUCHKINE, FANNY ET LE CHAMPAGNE
Pouchkine a consacré un certain nombre de poèmes au champagne
Aÿ. Dans Eugène Onéguine, il évoque "le
vin sacré pour le poète, Le Moët ou le Veuve
Cliquot". Et justement, Fanny, qui fête ce soir ses
dix ans à Voix au chapitre, a apporté deux bouteilles du
vin sacré...
NOS AVIS SUR Eugène Onéguine
Manuel![]()
![]()
![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Nous avions Claire et moi assisté à une rencontre avec André
Markowicz pour son Dictionnaire amoureux de Pouchkine. À
la fin de la rencontre, il nous avait récité les premiers
vers d'Eugène Onéguine, en russe, puis en français :
magique ! Je me suis également souvenu de la datcha de Tourguéniev
(lu
l'an dernier) visitée par plusieurs d'entre nous à Bougival.
J'ai appris pendant la visite qu'il y avait un mouvement proeuropéen
en Russie au XIXe : Tourguéniev et Pouchkine en faisait partie,
mais pas Dostoïevski. Ces deux événements ont nourri
ma lecture et relecture (oui je relis !).
Pouchkine me fait plonger dans la Russie du XIXe ! Et ce n'était
pas gagné, au regard de la forme en vers et grâce à
la traduction de A. Markowicz ! Ah les bals, ah les dîners, ah les
saisons, ah la neige, ah la vie à la campagne !
Certains vers me sont restés obscurs, mais j'ai essayé de
passer. Je suis subjugué par la culture de Pouchkine : il n'avait
peut-être que cette activité - celle de lire. Les références
sont nombreuses, Wiki a été mon compagnon de lecture, mais
cela n'a pas empêché mon plaisir de découverte.
La préface et la postface sont remarquables. Je cite Markowicz :
"Sous un régime
où la censure était toute puissante, insérer dans
un roman une chronique historique ou un tant soit peu politique était
de toute façon impossible, même si l'œuvre de Pouchkine
ne peut pas se comprendre sans ce besoin de se situer dans l'histoire
nationale."
Les vers de la strophe XXIII du 5e chapitre
sur les Lumières sont tellement d'actualité ! Et comment
ne pas penser à la Russie qui a annexé Odessa en 2014 avec
le dernier chapitre du journal (qui fut publié à part).
J'étais tellement déçu que ça se termine comme
ça : j'en voulais encore ! J'arrête, je suppose que vous
direz plein de choses intéressantes ! Sur les chapitres manquants
par exemple ! J'ouvre trois fois grand !
Catherine![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Je faisais partie de la team militant pour Eugène Onéguine
après Lermontov
et la visite de la maison Tourgueniev mais j'ai pourtant eu du mal au
début. Les héros romantiques m'assomment un peu. J'avais
déjà eu du mal avec le
jeune Werther, mais là on en a trois à la fois, deux
purs, idéalistes, exaltés et un, sombre, blasé et
mélancolique, ça fait beaucoup. J'ai eu du mal à
m'intéresser à cette histoire pendant un bon moment et je
l'ai même laissé tomber et puis, le déclic s'est fait
lorsque j'ai écouté Ça ne peut pas faire de mal
et que j'ai entendu Guillaume
Gallienne lire les vers d'Eugène Onéguine. Et
là j'ai été vraiment saisie par la beauté
du texte, je l'ai repris au début et je l'ai lu d'une traite. Et
au final, oui c'est un texte magnifique. Je ne suis malheureusement pas
en mesure de l'apprécier en russe, mais la traduction de Markowicz
est extraordinaire.
Il y a la beauté des descriptions de Saint-Pétersbourg,
de Moscou, des paysages de la campagne, la neige, les détails de
la vie quotidienne, les émotions des personnages qui sont finalement
plus complexes qu'ils ne semblent au début.
J'ai aussi aimé les interruptions du narrateur qui interpelle le
lecteur et lui livre ses états d'âme, c'est aussi plein d'humour
et d'ironie et les descriptions des personnages sont parfois même
parfois carrément drôles.
J'ai aimé les rebondissements (le duel mais surtout, lorsqu'on
quitte Tatiana, arrivant, petite provinciale à Moscou, et qu'on
la retrouve un chapitre plus loin, princesse, altière, suivie de
toute une cour et d'Eugène transi d'amour à son tour.
C'est un texte plus profond qu'il n'en a l'air au début, qui aborde
beaucoup de thèmes, l'amour, le destin, la mélancolie, c'est
aussi la peinture d'une société.
Je comprends que ça soit un texte culte de la littérature
russe. Je l'ouvre aux ¾, je l'aurais probablement ouvert en grand
si j'avais commencé par l'écouter.
Ça m'a aussi donné envie d'aller voir l'opéra
de Tchaïkovski que je ne connais pas et qui se joue à
Garnier en février.
Jérémy![]() (avis
transmis)
(avis
transmis)
Avant la lecture : Je n'avais rien lu de Pouchkine. Bien sûr
j'avais entendu parler d'Eugène Onéguine, mais sans
plus. J'étais tiraillé à l'idée de le lire
: d'une part un classique (super !), russe (génial !), d'autre
part un roman en vers (bof !). La versification pour moi ce sont
les poésies qu'il fallait apprendre au collège et étudier
au lycée et ça n'a jamais vraiment été ma
tasse de thé. J'avais peur qu'il faille s'y reprendre à
trois fois pour comprendre ce que j'allais lire.
Après la lecture : J'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu
dans la traduction de Markowicz. J'ai lu qu'il lui avait fallu 20 (vingt !)
ans pour le traduire. Je n'ai pas encore lu la note du traducteur à
la fin, mais j'ai lu la préface et ce qui y est dit sur la différence
entre les métriques française, syllabique, et russe, "syllabo-tonique".
Je comprends donc que traduire cette œuvre relève du tour
de force, surtout en réussissant à lui garder sa légèreté,
en conservant les rimes, et le sens de l'œuvre. Bref, c'est beau,
c'est très beau, c'est très très beau. J'en ai lu
la majeure partie cet après-midi et mis à part quelques
passages, je n'ai pas eu besoin de m'y reprendre à plusieurs fois
pour comprendre le sens. En plus j'ai appris ou réappris plein
de mots, c'est génial : phryné, jocrisse, agreste, églogue,
et j'en passe.
Quelques bémols toutefois :
- C'est extrêmement référencé, qu'il s'agisse
de références classiques, de références picturales,
de références à des auteurs russes tombés
dans l'oubli/inconnus (en tout cas de moi...), ou de références
à des personnages et œuvres européens. Et comme disent
les jeunes, souvent "je n'avais pas la réf" car je suis
un ignare complet. À l'exemple de Lovelace,
auquel il est fait référence à deux reprises, dont
Wikipédia m'apprend qu'il s'agit d'un personnage du roman Clarisse
Harlowe (Clarissa) de Samuel Richardson, utilisé
comme nom commun pour désigner un séducteur, généralement
libertin et peu scrupuleux. Étais-je le seul à ne pas savoir
?
Et quid du "Caton de la critique",
chapitre IV, strophe XXXII ? Et Harold ? Bref, j'en passe ! Cela
m'a fait penser à cet
article du Monde paru dans la série "Lettres
d'Amérique" cet été et dans lequel un professeur
d'université aux US raconte qu'il fait étudier Le Mythe
de Sisyphe et L'Homme révolté à ses étudiants
qui n'ont "pas les réf" (Nietzsche, Saint-Just, Dostoïevski,
Caïn, Abel, Prométhée, etc.). Enfin, quand je n'ai
pas la réf, je n'en veux jamais à l'auteur, mais je me dis
que ce sont autant de portes qu'il m'ouvre. Il faut juste espérer
que j'aurai le courage de les ouvrir...
- Qu'est-ce qu'il a avec les "petits
petons" ? Il était fétichiste des pieds ou quoi
?!
- La succession des saisons et leur description a un peu fini par m'agacer.
Dans un autre registre, il y avait un débat intéressant
mercredi matin sur Inter, grosso modo autour de la question "Faut-il
encore lire les Russes ?" avec William Marx et Victoire Feuillebois,
autrice de Faut-il
brûler Pouchkine ?, au cours duquel j'ai appris qu'il avait
appelé à l'extermination de la Pologne et avait eu des mots
très durs et dénigrants à l'encontre des Ukrainiens,
dans des écrits non traduits en français.
Bref, je suis très content de l'avoir lu et si j'ai le temps/le
courage je vais continuer de l'étudier encore un peu, ne serait-ce
qu'en lisant la note de Markowicz. Je l'ouvre aux ¾.
Brigitte![]() (à
l'écran, qui a aussi entendu l'émission)
(à
l'écran, qui a aussi entendu l'émission)
Même si je connais assez bien la vie de Pouchkine, je n'avais jamais
lu Eugène Onéguine.
C'est un classique de la littérature russe et avec les classiques,
on est rarement déçu. En effet, j'ai beaucoup aimé
cette lecture.
De nombreux Russes savent réciter par cœur plusieurs passages
d'Eugène Onéguine. Mais, jusqu'à maintenant,
lire un roman en vers ne me tentait pas beaucoup. Et voilà qu'André
Markowicz en donne une traduction en vers.
J'ai beaucoup aimé cette lecture. J'admire l'auteur, j'admire le
traducteur, j'admire le résultat de leur travail.
La versification en français est très réussie. Markowicz
parvient à rendre les nuances de la langue parlée dans les
milieux russes élégants de son époque, où
l'on favorisait la langue française aux dépens d'un russe
devenu maladroit.
Ce texte poétique : très belles descriptions des saisons,
du mode de vie dans la campagne russe, des états d'âme des
jeunes amoureux.
Même si l'intrigue romanesque est assez classique, je m'y suis intéressée
: le duel, la symétrie temporelle entre les sentiments de Tania
pour Evguéni et plus tard ceux d'Evguéni pour Tania. La
lettre envoyée par chacun d'eux.
J'ouvre en grand.
Monique
L![]()
Quelle surprise, cette facilité à lire cette œuvre
en vers ! Il faut dire que j'en craignais la lecture : du romantisme en
vers, cela risquait d'être lourd et désuet. Mais pas du tout.
L'auteur s'adresse à nous avec malice. Ne parlant pas russe, je
ne peux savoir ce que le traducteur André Markowicz a pu ajouter
ou enlever à l'œuvre russe, mais le résultat m'a vraiment
séduite par le rythme, la musicalité et la richesse des
rimes ; il y en a une qui m'a fait sourire où la rime est obtenue
en se plaignant de ne pas trouver de rime.
L'intrigue est assez classique pour une œuvre romantique, mais la
façon de la traiter est fluide et sans trémolos. C'est d'une
grande virtuosité. Les digressions malicieuses du narrateur donnent
une certaine légèreté au texte.
La description de la vie mondaine et de sa vacuité est très
bien décrite.
La psychologie des personnages est bien observée : Lenski et son
optimisme et sa joie de vivre, Onéguine le blasé, Olga d'une
grande beauté qui se révèlera infidèle et
Tatiana fidèle et sincère, qui est pour moi le personnage
le plus touchant. J'ai beaucoup aimée la lettre de Tatiana où
elle fait part de son amour à Onéguine. Elle est pleine
de délicatesse, de finesse et d'intelligence.
Le retour d'Onéguine à Saint-Pétersbourg où
il retrouve Tatiana mariée, transfigurée et fidèle
à son mari, malgré son amour toujours présent pour
Onéguine, est d'un romantisme fou.
J'ouvre en entier.
Rozenn![]()
Je ne voulais pas lire ce livre, je ne voulais pas me farcir un roman
en vers qui est apprécié dans le monde soviétique.
Or c'est drôle, léger, plein d'ironie !
J'aurais voulu apprendre le russe pour savoir pourquoi Markowicz l'a retraduit.
J'ai suivi avec lui un atelier d'écriture de traduction de l'anglais,
c'était fabuleux. J'avais essayé à partir du persan,
mais traduire un mot qui correspond à bateau dépend du nombre
de rameurs, s'ils sont esclaves ou pas... ça me paraît impossible
de traduire déjà, alors la poésie !
Onéguine, c'est drôle, c'est touchant. La description
des salons, c'est d'une puissance, et drôle.
Heureusement qu'il y a le groupe pour revenir sur mes préjugés
! Je me suis régalée.
Et le chapitre 10, contre le tsar, c'est incroyable ! Pouchkine faisait
partie des décembristes...

La
révolte des décembristes
le 14 décembre 1825, par Vassili
Timm, Musée de l'Ermitage
Et s'il n'a pas agi, il les a défendus.
Il a en plus deux censures : celle de la censure habituelle + celle
du tsar !
Et qu'il raconte sa future mort !
Tatiana m'a un peu énervée en restant fidèle.
C'est le début de la littérature, ils sont fascinés
par l'Occident, ils ont découvert les romantiques anglais, ils
essaient de faire pareil.
C'est magnifique ! Il faut que je revoie mes préjugés.
Claire
Dis donc, c'est pas facile de repérer ses préjugés
!
Rozenn
Je ne m'attendais pas à être enthousiaste.
Quand je pense qu'en Ukraine, on retire les romans russes des bibliothèques.
Renée![]() (à
l'écran)
(à
l'écran)
J'ai lu pour ma part la traduction
de Charles Weinstein (2010) qui m'a semblé respecter le vocabulaire
du XIXe siècle, donc un peu vieillot. En comparaison, celle de
Markowicz "coule" davantage à
nos oreilles de 2025. Je ne connaissais que vaguement l'opéra
de Tchaïkovski - juste la trame de l'histoire.
Le
texte est très poétique et Pouchkine souligne parfaitement
l'égoïsme d'Onéguine, la pureté et la
droiture de Tatiana.
Il s'amuse à nous raconter cette histoire, nous prenant à
témoin. C'est la première fois que je lis un long poème
où l'auteur s'implique avec des anecdotes personnelles au milieu
de la narration. Le passage où le narrateur relate son
fétichisme pour les pieds des femmes est savoureux, on dirait
du vécu. En revanche le duel est expédié en une phrase.
J'ouvre aux ¾.
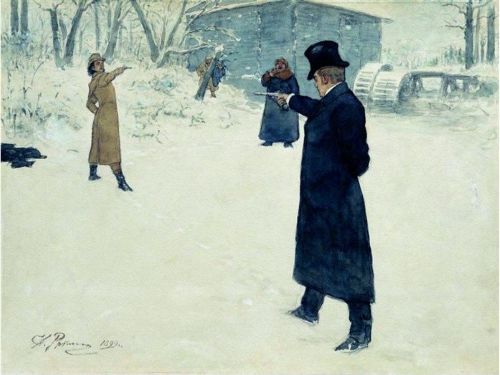
Duel entre Onéguine et Lenski, Ilia Répine, aquarelle, musée
Russe, Saint-Pétersbourg

Duel
entre Onéguine et Lenski, Ilia Répine, 1901, huile, Musée
National Alexandre Pouchkine, Saint-Pétersbourg
Jacqueline![]()
Je pense comme Rozenn que la poésie ne peut pas se traduire.
J'ai commencé à lire la traduction de Markowicz. J'ai été
surprise et j'admire son travail : arriver à traduire en strophes
de quatorze vers octosyllabiques rimant à l'ancienne, ce que Pouchkine
a mis des années à écrire en parallèle avec
autre chose ! Ça se lisait bien. Il y a une certaine légèreté
ironique dans le propos. Cependant, je trouvais parfois le ronron de la
rime pas tout à fait assez naturel pour que ça coule...
En cherchant une autre traduction, je suis tombée sur le CD (Jacqueline
le montre) où
Eugène Onéguine est enregistré, en russe par
sa mère, en français par André Markowicz et Françoise
Morvan, sa compagne : un travail familial touchant qui me renvoyait au
plaisir des sonorités d'enfance… ; j'appréciais surtout
d'entendre la musicalité du texte russe dit sans emphase, avec
un naturel qui me paraissait correspondre à celui que j'avais trouvé
dans le propos de Pouchkine…
J'aurais voulu pouvoir le comprendre directement et j'ai trouvé
une autre traduction de Jean-Louis Backès (Folio
classique, 1996) : c'est avec elle que j'ai fini ma lecture sans,
d'ailleurs, remarquer qu'elle aussi respectait la métrique !
J'ai beaucoup aimé l'humour du texte et qu'il soit constamment
question de littérature et de livres. La mère de Tatiana
pourrait être une Madame Bovary : amoureuse d'un mauvais garçon,
on la marie, l'éloigne à la campagne et elle fait des confitures…
ceci raconté en deux, trois strophes.
J'ai aimé l'humour autour du romantisme, comme autour de la poésie…
C'est un comble que le gentil poète Lenski un peu moqué
soit victime d'un duel tragique, puis oublié … J'ai aimé
le récit des amours d'Eugène et Tatiana dans ce qu'ils ont
de décalé, mais avec leur respect de l'autre comme celui
des mœurs sociales. J'ai pensé à la Princesse
de Clèves
Bref, j'ouvre en grand.
Claire (feuilletant l'intro de la traduction préférée
par Jacqueline, sans rime, et la menaçant d'un duel…)
J'ai mis en ligne le début du cd de 14h que tu évoques,
Jacqueline, et qui vaut la peine en effet d'être écoutée
quelques instants au moins (›ICI).
Je vois que ton Jean-Louis Backès, non seulement évite les
rimes, mais n'hésite pas à prendre des libertés :
"J'ai
tenté d'atteindre à l'aisance, fut-ce aux dépens
de la littéralité. Plutôt ne pas traduire un mot,
deux mots, que de faire une phrase qui me paraitrait pataude.
J'ai choisi le rythme, et oublié la rime."
Au fait, Markowicz, dans ses commentaires, se réfère multe
fois à la traduction d'Eugène Onéguine par
Nabokov, qui lui, était un adepte féroce de la traduction
fidèle.
Jacqueline (y repense et complète après la soirée)
La littéralité ? Comment traduire littéralement des
vers entre des langues de rythmique et de structures différentes ?
Il faut bien prendre des libertés quelque part ! Backès
le signale et pas Markowicz qui ne parle pas de la difficulté de
ses choix. Je l'aime quand même !
J'aurais pu parler de De Luca apprenant le russe pour lire Akhmatova dans
le texte ! Ou de Verlaine qui conseillait de tordre le cou à
la rime (ce qu'il ne faisait pas !) ??c'était d'ailleurs plutôt
à l'éloquence ! Mais il traitait la rime de "bijou
d'un sou".
Il me paraît impossible que la traduction de Markowicz en vers,
aussi respectueuse de la métrique et des rimes, n'ait pas dû
composer avec la littéralité du texte russe... J'ai adoré
écouter un peu la musicalité sans emphase de Madame Markowicz.
J'avais effectivement l'impression de retrouver les délices des
"récitations" de mon enfance ! Et peut-être
aussi le plaisir enfantin d'entendre quelque chose que l'on ne comprend
pas vraiment. Comme en lisant Markowicz, je n'arrivais pas toujours à
ignorer complètement le ronron de la rime, comme je ne connais
pas suffisamment le russe pour y comprendre quoi que ce soit, faute d'un
locuteur russe, j'aurais justement voulu trouver une traduction littérale
du texte. Il m'a fallu un bout de temps pour remarquer que celle de Backès
plus fluide était elle aussi respectueuse des contraintes métriques…
Mais c'est avec elle que j'ai choisi de finir ma lecture sans avoir l'impression
de lire un digest - j'ai souvent comparé
quelques strophes en route ; en plus les notes et les informations
se complétaient…
Fanny![]()
Je me régale à vous entendre.
Monique
Je voyais ton visage... qui montrait au fur et à mesure que tu
ne partageais pas notre enthousiasme.
Fanny
Ces vers... oui. Oui le duel..., oui la critique, la satire... Ai-je lu
le même livre ?
Je n'ai pas réussi à passer de la lecture de poésie
à la lecture d'un roman. Comment il a pu ? C'est stupéfiant
oui. Mais, me laissant porter par la beauté du mot, je perds l'intrigue.
C'est beau, mais c'est un pensum.
Je suis portée, à lire de la poésie, mais 20, 30
pages d'affilée, je sature. Impossible de lire plus d'un chapitre
à la fois, du coup après un chapitre, direct, je commande
un autre bouquin...
Claire
Lequel ?
Fanny
Le livre d'Arnaud Gallais sur l'inceste, J'étais
un enfant - d'autant que je vais peut-être travailler
avec lui.
Ce n'est pourtant pas détendant par rapport à Pouchkine...
J'ai aimé qu'il s'adresse au lecteur. Mais la poésie et
le roman, je n'ai pas réussi à les lier. J'ouvre donc ¼
Rozenn
Pouchkine est peut-être trop dans la prouesse.
Monique
Et Markowicz peut-être en rajoute.
Claire![]()
En tout cas, heureusement qu'il y a Fanny, sinon on allait être
dans une morne unanimité...
Pour ma part, en lisant Eugène Onéguine, je n'ai
pas lu de la poésie, j'ai lu un roman.
C'est
en effet cette rencontre à la librairie
Compagnie dont parle Manuel qui nous avait donné envie de proposer
ce roman, présenté par Markowicz comme un chef-d'œuvre,
et Catherine nous avait emboîté le pas pour le programmer.
J'avais aimé les deux autres Pouchkine que nous avions lus
dans le groupe (La
Dame de pique et La
Fille du capitaine), mais un roman en vers…
Je n'ai rien lu d'abord, ni préface, ni postface. J'ai été
impressionnée par beaucoup de choses. D'abord en trouvant que les
vers coulent et le récit roule.
Le rôle de la culture française m'a époustouflée,
et plus largement européenne ; la littérature française
(Rousseau, Fontenelle), anglaise (Byron, Samuel Richardson), allemande
(Goethe, Schiller), mais aussi la mode, les alcools (Bordeaux, Champagne),
la nourriture. J'attends qu'un jour le groupe programme
Quand l'Europe parlait francais de Marc Fumaroli...
J'ai aimé le ton - peut-être pas de l'humour mais ça
s'en rapproche -, l'aspect primesautier, la complicité avec le
lecteur que vous avez mentionnée : c'est du plaisir.
Question projection au degré zéro de la midinette, le narrateur
m'est extrêmement sympathique. Le personnage de Tatiana est particulièrement
romanesque/romantique - ça vibre... - avec le rôle des livres
avant la rencontre d'Onéguine et bien plus tard dans son cabinet
désert - là, j'ai craqué.
La narration est passionnante, pas question de lire autre chose ;
certaines scènes sont très réussies : fête,
duel.
Je me suis aperçue à peu près au tiers de ma lecture
du jeu exigeant des rimes, embrassées, etc. Et aux deux tiers seulement
du nombre de pieds constant. Quelle virtuosité et je pense que
ça joue dans le coulé !
Et enfin des notes en bas de page ! Sans avoir à faire le cirque
du va-et-vient et qui sont personnelles parfois : médiocre,
charmant, génial. Les références que les notes
nous permettent d'approcher, je me suis demandé quels effets elles
font en russe : ajoutent-elles à la complicité ?
Comme pour Manuel, le livre a réactivé des lectures avec
le groupe, notamment la virée au Caucase dans Un
héros de notre temps de Lermontov.
Comme Jérémy, j'étais ignorante de bien des références,
sans culpabilité... J'ai cherché comme lui à propos
de Samuel Richardson mentionné
et rementionné - un auteur jamais lu à Voix au chapitre
- traduit par l'abbé Prévost.
Rozenn
On le programme !
Claire (a fini de formuler son avis sur le livre et extrapole)
J'ai vu cette année à l'Opéra Onéguine,
un ballet très beau de John Cranko (l'argument ›ici
en trois parties ; le trailer
›là). Je me souviens de la maison-musée Pouchkine
à Saint-Pétersbourg où une femme disait un poème
de lui, les larmes aux yeux.
Après notre roman, j'ai lu le livre de Markowicz L'appartement,
un roman en vers autobiographique mais vraiment rien à voir avec
la fluidité d'Eugène Onéguine : pas de rimes
et les retours à la ligne freinent, aïe aïe aïe
(à Petersbourg, il a hérité de l’appartement
dans lequel vivait sa grand-mère depuis 1918, prétexte d’un
récit mêlant souvenirs familiaux, réflexion sur le
régime sur la littérature sur les intellectuels russes).
Ensuite, je suis allée dans la merveilleuse nouvelle BPI
Lumière consulter le rayon Pouchkine et me suis plongée
dans son Journal
secret où il se montre obsédé : je n'ai
pas été du tout déçue par cette lecture érotique
et érotiquement littéraire (voir
la suite ›ici).
J'ai trouvé aussi la traduction d'Aragon de quelques extraits du
livre, qu'a publiés Elsa Triolet. La voilà avec quelques
autres traductions, en prose, puis en vers, de la première strophe
du roman :
| En 1863 Tourgueniev et Viardot | En 1868 par Paul Béesau |
| Dès qu’il tombe sérieusement malade, mon oncle professe les principes les plus moraux. Il a pu se faire estimer, sans pouvoir inventer rien de mieux. Son exemple est une leçon. Mais, grand Dieu ! quel ennui de rester nuit et jour auprès d’un malade sans le quitter d’un seul pas ! Quelle basse perfidie que d’amuser un moribond ! d’arranger ses coussins, de lui présenter avec recueillement ses remèdes, de pousser de gros soupirs, en même temps que l’on pense à part soi : Quand donc le diable t’emportera-t-il ? | Mon
oncle devint un homme des plus sévères principes lorsqu’il
tomba sérieusement malade ; il obligea tout le monde à
l’estimer, et certes il ne pouvait faire mieux. — Que son
exemple soit une leçon pour les autres ! Mais, grand Dieu ! quel ennui de rester près d’un malade nuit et jour sans le quitter d’un pas ! Quelle félonie de chercher à distraire un moribond, de lui arranger les oreillers, de lui présenter les médecines avec un visage voilé par la tristesse, lorsque, dans le fond du cœur, on se dit : "Quand donc le diable t’emportera-t-il ?" |
| En 1965 Aragon | En 1996 Jean-Louis Backès |
| Mon
oncle avait de la morale, Quand pour de bon il s'alita, Forcer l'estime générale Ce fut le mieux qu'il inventa. Son exemple à tous est science ; Mais, mon Dieu, quelle patience Près du malade et jour, et nuit, Sans s'écarter d'un pas de lui ! Quel subterfuge ridicule Que distraire un mort-à-demi, L'oreiller sous sa tête mis Offrir tristement les pilules, Soupirer et penser à part : Que le diable enfin s'en empare ! |
Mon
oncle a d'excellents principes. Depuis qu'il se sent mal en point. Il exige qu'on le respecte. L'idée est bonne, assurément ! Et l'exemple sera suivi. Mais, Seigneur Dieu, quelle corvée ! Rester au chevet d'un malade Nuit et jour sans pouvoir bouger ! Et quelle vile hypocrisie ! On fait risette à un mourant, On redresse ses oreillers. On arbore un air lamentable Pour lui apporter sa potion ; Et l'on pense qu'il aille au diable ! |
| En 2005 Markowicz | En 2010 Charles Weinstein |
| Mon
oncle, un homme de morale, Lorsqu’il sentit qu’il trépassait, Força l’estime générale Et se tailla un franc succès. L’exemple, certes, nous inspire ; Mais quel ennui peut être pire Que de rester, des nuits durant, Attendre au chevet d’un mourant ? C’est une ignominie perfide Qu’un presque-mort à égayer, Lui arranger ses oreillers, Compter ses gouttes, l’air languide, Et, soupirant, penser tout bas : “Satan ne te prendra-t-il pas ?” |
Mon
oncle, un homme sans reproches. Quand il vit la mort arriver. Força l'estime de ses proches. Ce fut tout ce qu'il put trouver. Qu'il serve donc d'exemple à d'autres. Mais, Dieu ! Quels soucis que les nôtres. Car je restais à le soigner De jour, de nuit, sans m'éloigner. Il fallait, fourbe, que je l'aide. Que je batte son oreiller. Que je tente de l'égayer. Que je lui porte son remède. Et je pensais dans un soupir : Quand diable va-t-on en finir ? |
| Et en anglais, Nabokov | |
|
En 1964, Nabokov, très sévère avec les traductions anglaises du roman, publie sa propre traduction, en quatre volumes. On peut lire le premier chapitre ›ici ; et voici la première strophe :
Hélène
Henry, dans son article sur Vladimir
Nabokov et la traduction, présenté aux Quatorzièmes
Assises de la traduction littéraire à Arles en
1997, analyse la conception particulière que Nabokov avait
de la traduction, une position radicale :
il défend une traduction littérale et hyper fidèle
au texte original, même si cela rend le texte difficile à
lire. |
|