Christiane Vulpius, compagne puis épouse de Goethe à Weimar
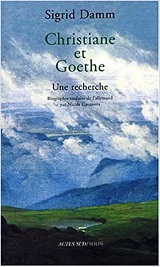
<= Christiane
et Goethe : une recherche,
de Sigrid Damm, publié en 1998 en Allemagne, trad. Nicole Casanova,
Actes Sud/Solin, 440 p.
Voir ci-dessous la présentation du livre, dans un article bien
intéressant.
L'auteure, Sigrid Damm, universitaire spécialiste de la période
classique de Weimar, a également écrit sur la soeur de Goethe,
sur son ami d'enfance Jakob Michael Reinhold Lenz.

dessin de Friedrich Bury, 1800
"Être la femme de Goethe", Jacques Franck, La Libre Belgique, 15 janvier 2004
Goethe avait
trente-huit ans
lorsqu'il rencontra Christiane Vulpius, qui en avait vingt-trois. Ils
devinrent amants presque du jour au lendemain. S'ensuivirent dix-huit
ans d'union libre, dix ans de vie conjugale. Weimar s'en scandalisa à
double titre : en installant sa maîtresse chez lui, officiellement
en tant que gouvernante, sans être unis par les liens du mariage,
il bravait la religion et la loi ; en prenant pour compagne une fille
pauvre, qui gagnait sa vie dans un atelier de fleurs artificielles, le
ministre-conseiller du duc Charles-Auguste déchoyait. Les contemporains
la traitèrent de garce et de putain, de "petite créature"
et de "néant rond". Plus tard, les admirateurs
de Goethe ne se montrèrent pas moins méprisants : "un
bel pezzo di carne (un beau morceau de viande), foncièrement inculte"
(Thomas Mann) ; "une nullité d'esprit" (Romain
Rolland) ; "la célèbre partenaire sexuelle
de l'olympien vieillissant" (Robert Musil). Pourtant Goethe n'a
jamais quitté Christiane, même s'il la tint toujours à
distance de sa vie mondaine et de son activité intellectuelle,
et si, plus tard, ils vécurent quasiment séparés.
Avait-elle donc des qualités ?
UNE ENQUÊTE MINUTIEUSE
Sigrid Damm, spécialiste de la littérature allemande de
la fin du XVIIIe siècle, s'est livrée à un admirable
travail de recherches, dont est sorti un ouvrage superbe. Il se dévore
en même temps qu'il nous fait entrer dans la vie quotidienne de
"Christiane et Goethe", et qu'il projette un éclairage
cru sur la condition féminine dans une petite ville allemande de
leur temps. Historienne, érudite, bon écrivain, Sigrid Damm
a lu tout ce qu'on peut lire sur eux, déniché des documents
demeurés inexploités, et analysé avec attention les
601 lettres conservées du couple (247 de Christiane à Goethe,
354 de lui à elle). Pour découvrir quoi ?
Une femme expressive et exacte, qui trouve une langue pour son corps,
sa féminité, sa sexualité : "C'est inhabituel
à son époque". Une femme inlassablement active,
qui gère remarquablement sa maison, effectue des opérations
financières, travaille au potager et au jardin, sait conduire un
traîneau, adore le champagne et danser, se montre toujours de bonne
humeur. Mais en la lisant de plus près, Sigrid Damm a rencontré
une femme dont le corps a été marqué par cinq grossesses
et une maladie chronique des reins, qui a perdu quatre enfants, ploie
constamment sous un travail harassant. Une femme que la "bonne société"
humilie et brocarde. Une femme terriblement seule.
EROTIKON MAIS SERVANTE
Goethe
avait entretenu une longue liaison avec Charlotte von Stein, épouse
d'un haut dignitaire de la Cour et mère de plusieurs enfants, qui
l'avait "dégrossi" à son arrivée à
Weimar et lui avait appris à se conduire dans la société
aristocratique de la ville. Liaison platonique, toutefois. En 1786, comme
asphyxié par ses tâches politiques et cette relation sentimentale,
il s'était enfui en Italie. Il n'y découvrit pas seulement
les marbres antiques et la peinture de Raphaël, il y connut l'épanouissement
sexuel dans les bras d'une fille du peuple dont nous ne connaissons que
le nom qu'il lui donnait, Faustina.
À son retour à Weimar en 1788, pouvait-il rester sans une
Faustina ? Il la trouva dans la petite ouvrière Christiane Vulpius.
Cela démarra très fort ! "Ils doivent avoir
été un couple à la sensualité joyeuse, doué
d'imagination en amour", écrit Sigrid Damm, qui en voit
une indication dans les nombreuses factures des réparations nécessitées
par... leur lit. À ses amis, Goethe qualifiait son amante d'Erotikon.
Ses sens embrasés lui donnèrent apparemment le cran d'assumer
le scandale de sa liaison, il n'en tint pas moins son Erotikon à
l'écart de sa vie publique. C'est à peine si ses amis les
plus proches l'entrevoyaient.
Cela dura des années. Un fils leur naquit. Christiane conserva
sa position ancillaire. Goethe ne se soucia jamais de l'initier à
l'art et à la poésie, ne l'associa jamais à ses travaux.
Il est vrai qu'à un ami qui le consultait sur l'éducation
à donner à ses filles, l'auteur de "Werther" répondit
: "Rien d'autre que la tenue du ménage. Fais-en de bonnes
cuisinières, ce sera le mieux pour leurs futurs maris".
Christiane en était une excellente. "Trésor" (sic)
aux fourneaux comme au lit. Qu'on la dénigre ou l'humilie à
l'extérieur, il fait mine de ne pas s'en apercevoir. Elle, de son
côté, ne se plaint jamais. A-t-elle pleuré ?,
on ne le saura jamais.
MARIAGE MAIS ÉLOIGNEMENT
En 1806, le monument d'égoïsme qu'est Goethe connut un moment
d'humiliation absolue. Les soldats français, qui viennent d'écraser
la Prusse à Iéna, envahissent et pillent Weimar. Dans sa
maison de la Frauenplan, Goethe, terrorisé, s'enferme à
double tour dans sa chambre. Christiane, elle, affronte la soldatesque,
obtient une sauvegarde, empêche la destruction et le vol des œuvres
d'art et des livres. Le danger passé, Goethe réapparaît.
Deux jours plus tard, il épouse Christiane en catastrophe et en
présence de leur fils de seize ans. Cette légitimation va
paradoxalement favoriser son éloignement de sa femme : "Le
lien juridique de 1806, qui donne une façade extérieure
à leur intimité, lui ouvre une liberté plus large".
Dorénavant, Goethe passera une grande partie de l'année
loin d'elle. Il lui faut être seul pour écrire, explique-t-il.
Quand il revient chez lui, c'est pour se retirer au second étage,
côté jardin. Il lui a offert son nom, il lui offrira encore
une calèche, des chevaux, des séjours dans des villes d'eau.
C'est le prix de ses absences. Elle se fera une raison : elle veille
sur son bien-être, se replie sur quelques amis fidèles qu'elle
amène au théâtre, avec qui elle joue aux cartes au
salon. Il a fui le temps où il notait "d'un doigt léger
j'ai scandé sur son dos mes hexamètres". En 1816,
Christiane meurt d'une crise d'urémie qui la fait atrocement souffrir.
Alléguant un catarrhe, Goethe ne se rendra pas une seule fois à
son chevet. Le spectacle de la maladie et de la mort lui fait trop peur.
Lorsqu'il mourra à son tour, il demandera à être inhumé
auprès de... Schiller !
En conclusion, Sigrid Damm écrit : "la vie de cette femme
a consisté à dominer la grise réalité de tous
les jours. Ce n'est qu'en tentant de représenter cette réalité,
qu'on peut se faire une idée approximative de ce qu'a été
son passage sur la terre". C'est le mérite de cette biographie.
Elle ouvre, en outre, des aperçus surprenants sur le mode de travail
de Goethe. Et sur la part directe et indirecte que Christiane a prise
à l'élaboration de son œuvre.
Rien de romancé. Rien d'inventé pour combler l'ignorance
quand une pièce du puzzle manque. Mais un livre captivant sur le
destin contrasté de la petite ouvrière dont le grand Goethe
fit sa femme.
http://www.voixauchapitre.com/archives/2020/goethe.htm